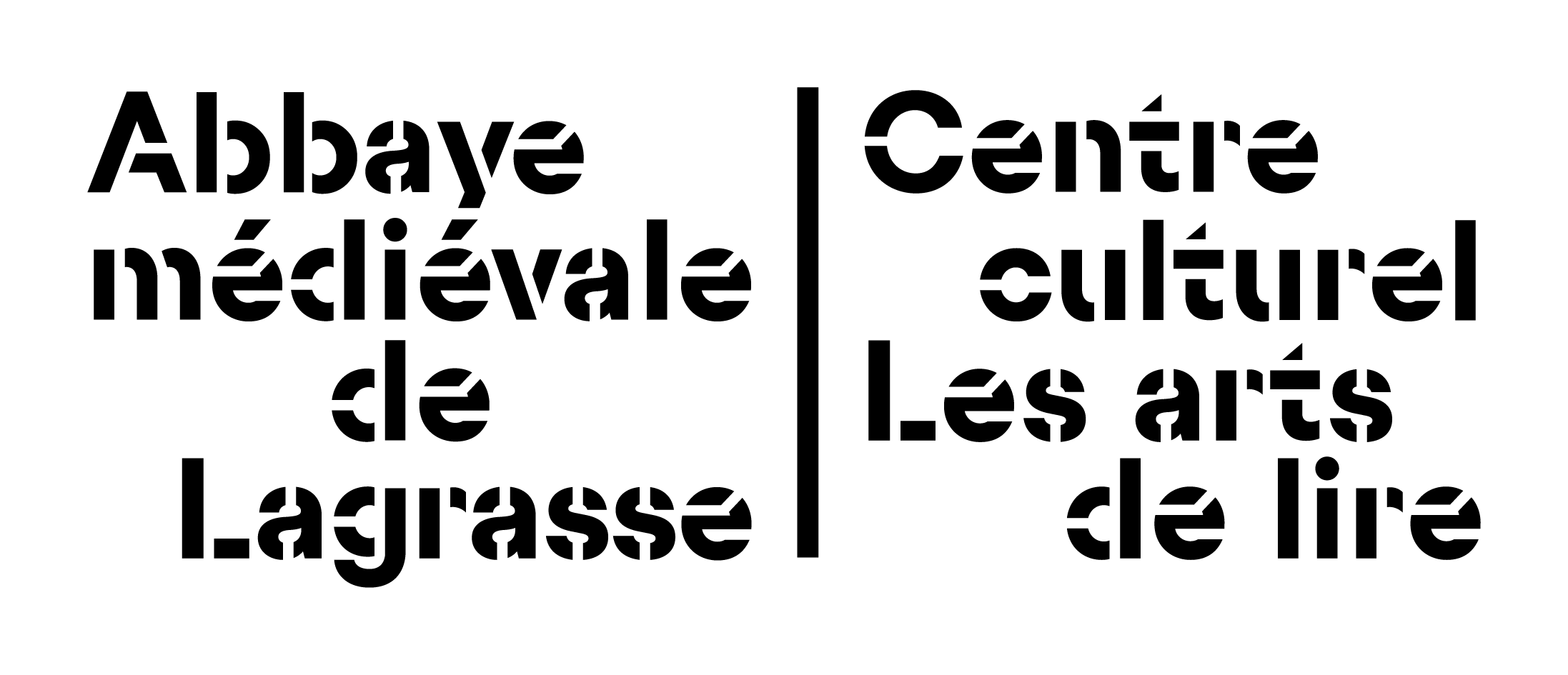Ce que peut… (3/5) l’anthropologie – Les recherches de Benoît Trépied, anthropologue et chargé de recherche au CNRS, s’ancrent dans une longue expérience de terrain en Nouvelle-Calédonie. Ses travaux sur les enjeux contemporains de la décolonisation dans le Pacifique et l’outre-mer français en font un spécialiste des questions de citoyenneté, des relations ethno-raciales et des enjeux de politique locale en Calédonie. Dans le contexte de la crise que traverse actuellement ce territoire, il est intervenu intensément, ces dernières semaines, dans de nombreux médias, et rédige en ce moment un ouvrage à paraître aux éditions Anacharsis.
Benoît Trépied a publié Une mairie dans la France coloniale. Koné, Nouvelle-Calédonie, Paris, Karthala, 2010, et dirigé en 2020 « Sortir du colonial sans décoloniser ? » (avec Marie Salaün, dir.), Outre-Mers. Revue d’histoire, tome 108, n° 406-407.

Comment avez-vous traversé la séquence politique que nous venons de vivre ?
Cette séquence est venue en doubler une autre, car j’étais déjà plongé depuis un mois dans une crise sans précédent sur le dossier calédonien. J’ai été terriblement affecté par ce qui s’est passé, comme tous les gens de Calédonie et toutes celles et ceux qui ont un lien avec ce pays, de près ou de loin. J’étais bouleversé, et l’action a clairement constitué un antidote à l’angoisse : intervenir dans les médias a été une soupape, j’ai pu me dire « au moins j’agis ». La Calédonie étant tellement loin, personne ne comprenant rien, et le gouvernement allumant des contre-feux médiatiques tous plus grotesques les uns que les autres, je me suis dit que rétablir des vérités me ferait du bien. Et je crois qu’en quelques jours, avec quelques collègues qui ont également été en première ligne, nous avons réussi à faire tourner le vent médiatique, c’est-à-dire à faire comprendre au grand public que ce qui se passait n’était pas une question d’émeutes urbaines, de « sauvages » ou d’organisation mafieuse, comme le disait Gérald Darmanin au sujet de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT, principale organisation indépendantiste pointée du doigt), tous ces éléments de langage gouvernementaux que répétaient les journalistes et qui étaient répercutés partout.
Est-ce que vous diriez que votre position d’anthropologue et plus largement de chercheur en sciences sociales est marquée par un engagement politique ? Est -ce que cet engagement a évolué au fil de votre parcours ?
J’ai été à bonne école puisque que j’ai été formé par Alban Bensa, anthropologue qui a dirigé ma thèse, et qui est beaucoup intervenu dans le débat public au moment de la séquence insurrectionnelle des années 1980 en Calédonie. Il a délaissé les cours pour aller porter cette parole, et cela a nourri sa réflexion sur les liens entre recherche et engagement.
Concernant ma propre intervention, je suis d’abord intervenu ici, puis là, et au bout de deux semaines j’ai écrit une tribune dans le Monde qui a pour titre « Nouvelle-Calédonie : La solution de compromis la plus raisonnable est l’indépendance en partenariat ». C’était une vraie prise de position, je ne pouvais pas me contenter d’avoir un retour soi-disant neutre. J’ai mobilisé mes connaissances et mon expertise pour donner un point de vue politique et je l’ai assumé. Je ne l’avais jamais fait à ce point auparavant. D’ailleurs on me le reproche, je reçois régulièrement des messages d’insulte plus ou moins menaçants qui insistent beaucoup sur le thème : « on dirait un discours militant et pas celui d’un chercheur ».
« Je ne crois pas à l’idée que la scientificité du chercheur est la neutralité. »
Justement, est-ce qu’on n’est pas entré dans un contexte politique où on ne peut plus se contenter d’un point de vue « neutre » ou de commentaire distancié ?
Je pense que ça dépend du moment politique qu’on traverse mais aussi de notre conception du métier. Cet engagement du chercheur doit être présent. Je pense qu’on ne doit jamais rogner sur nos exigences méthodiques, scientifiques, épistémologiques, mais quand notre travail aboutit à se construire une opinion, on peut et on doit la défendre. Je ne crois pas à l’idée que la scientificité du chercheur est la neutralité. Il y a quelques années, le travail de Max Weber sur la neutralité axiologique a d’ailleurs fait l’objet d’une nouvelle traduction qui a souligné à quel point la proposition de Weber avait été détournée : elle affirmait non pas que le chercheur devait être neutre mais qu’il devait être impartial dans ses méthodes et dans l’administration de la preuve. Quand ces méthodes débouchent sur la construction d’une opinion informée, on peut la défendre. Je pense que l’opinion politique que je défends se justifie par mes travaux, par la valeur ajoutée de la science. Toutes les opinions ne se valent pas parce que certaines sont informées quand d’autres ne le sont pas. Mon métier consiste à construire cette information, mais aussi à en tirer les conséquences quand le moment l’exige. Donc finalement, on ne peut pas être chercheur en sciences sociales, exercer ce métier-là et ne pas avoir une parole contre la montée de l’extrême droite, parce que tout notre travail nous amène à penser contre cette option politique. Je pense qu’il y a des moments de vérité : soit on prend la parole, soit on dit qu’on ne peut pas se prononcer en tant que chercheur… ce qui revient à tenir un discours de droite. On ne peut pas faire autrement. Bien sûr, cela dépend aussi des conditions matérielles et politiques dans lesquelles s’exercent les activités de certains chercheurs. Je pense à certaines de mes collègues en Calédonie, dont le salaire dépend des institutions locales, qui n’ont pas cette liberté de parole et qui m’écrivent en disant « merci de parler pour nous ».
Quel est l’apport singulier de l’anthropologie dans de telles prises de positions, au cœur d’un débat public brûlant et confus ?
Je n’avais jamais été confronté à une telle sollicitation d’expertise sur la situation politique, et je me suis rendu compte que tout ce savoir, toutes les enquêtes accumulées depuis 20 ans donnaient à ma parole un crédit finalement rare sur la scène publique, lié aussi au fait que relativement peu de personnes travaillent sur la trajectoire coloniale de la Calédonie. Je pense que l’anthropologie et ma pratique ethnographique de chercheur en sciences sociales ont été décisives pour trois raisons.
Premièrement, l’anthropologie est cette discipline de la familiarité avec un terrain sur le temps long, qui donne une profondeur d’expérience peu répandue sur un tel sujet. Dans mon travail d’anthropologue du politique, je réfléchis depuis 25 ans aux enjeux de la situation coloniale et postcoloniale en Calédonie. Cette forme de maturation lente, qui se déroule loin des projecteurs, éclot au moment opportun. C’est cette longue durée, ce luxe de la profondeur, qui apporte une qualité de parole publique singulière, et qui explique que tous les commentateurs, même des journalistes très compétents, se sont tournés vers nous.
Le deuxième point qui découle du premier c’est que dès les premières informations j’ai appelé mes amis en Calédonie. C’est comme si j’avais poursuivi l’enquête à distance avec un point d’entrée que n’ont pas les commentateurs éloignés du dossier. Cette entrée est fondée dans l’ethnographie, dans la familiarité avec des gens, les militants et les citoyens « au ras du sol » et pas seulement les responsables politiques. J’entretiens avec eux une relation de confiance fondée sur des années d’interconnaissance, je fais partie du paysage, je fais partie de leurs très proches comme ils font partie des miens. Je les appelle comme on appellerait sa famille, pour prendre des nouvelles d’eux, savoir de quelles manières ils vivent cette crise, dans leur maison, à leur échelle etc. Cela permet d’avoir un discours beaucoup plus informé que les commentaires politiques.
Enfin, l’anthropologie – comme d’autres sciences sociales – implique la distanciation analytique et l’élaboration théorique. Notre travail nous permet de ne pas avoir le nez sur l’actualité mais de la remettre en perspective. Face à des discours qui décrivaient une explosion de violence incompréhensible, qui s’étonnaient des revendications kanak concernant le corps électoral en disant qu’elles remettaient en cause un principe démocratique, j’ai pu expliquer qu’il s’agissait en fait de la mise en péril d’un processus de décolonisation, découlant d’une histoire particulière en Calédonie, celle de la colonisation de peuplement. Cette histoire singulière a conduit à la minorisation et à la marginalisation des kanaks, et produit la crainte de leur invisibilisation et de leur disparition. C’est ce qui permet de comprendre pourquoi la question électorale est décisive pour les Kanak et de reproblématiser l’actualité à l’aune d’une réflexion au long cours.

Un essai de micro-histoire publié en 2010 dans lequel l’auteur analyse les enjeux sociaux découlant des siècles de colonisation.
Cette expérience d’engagement a été avant tout médiatique. Comment la décrire ?
Tous les chercheurs ne considèrent pas qu’aller dans la sphère médiatique fait partie du métier, et les deux postures se conçoivent. La valeur de cette sphère intellectuelle et scientifique c’est précisément son autonomie conceptuelle, et nous ne sommes pas là pour répondre constamment à une demande publique. Mais que faire quand tout converge, quand le sujet émerge et qu’on vous interpelle dans un moment fatidique ? J’ai toujours pensé que ces interventions faisaient partie de mon travail. D’ailleurs le CNRS et tous mes collègues m’ont soutenu dans cette démarche.
Une grande différence avec ce qui s’est passé dans les années 80, c’est que l’intervention médiatique est prise dans un tourbillon beaucoup plus intense à cause des chaînes d’info en continu et des réseaux sociaux.
Est-ce qu’il y a des choix à faire dans cette profusion des sollicitations médiatiques ? Oui, très clairement. CNews m’a sollicité mais j’ai refusé. A contrario, j’ai sollicité à deux reprises une radio non-indépendantiste de Nouméa pour qu’ils m’interviewent, je voulais m’adresser aux gens de droite de Nouméa, mais ça n’a pas marché, ils n’ont pas répondu, bien que les médias du monde entier me sollicitent. Mais c’est aussi parce que mon propos est clair.
Justement, qu’en est-il aujourd’hui de la liberté d’un anthropologue qui prend la parole comme vous le faites ?
Au sein de certaines institutions publiques, on a assisté à des formes de répression de la liberté d’expression des chercheurs, autour du conflit Israël-Palestine en particulier, qui m’ont beaucoup inquiété. Mais au cours de l’expérience que j’ai eue dans les médias suite au déclenchement de la crise en Calédonie, je ne me suis jamais censuré et je n’ai jamais été censuré. Cependant tous les médias ne se valent pas. Les chaînes d’information continue, notamment, ont un double visage, ce qui est très troublant. L’information continue est un ogre qu’il faut constamment nourrir, les chaînes doivent en permanence remplir leur plateau et le micro est ouvert, ce qui offre une grande liberté de parole et le temps de parler. Les interventions sont mises en ligne et se diffusent via les réseaux sociaux, ce qui est très utile. Mais cette liberté est contrebalancée par le fait qu’on peut être contredit par un discours absolument contraire quelques minutes après être intervenu. Il n’y a aucune ligne éditoriale, ou bien celle qui suit le sens du vent, c’est-à-dire le discours du pouvoir, lui-même calqué sur celui de l’extrême droite ou de CNews. Sur ces chaînes, on est donc en direct et il n’y a aucun filtre, jamais, pour le meilleur et pour le pire. Dans les moments particulièrement intenses de la crise, lorsque j’entendais des énormités, j’attendais avec impatience que BFMTV m’appelle pour pouvoir donner mon avis le plus largement possible et le retweeter ensuite. Par contre, dans les journaux de 20h, qui restent le graal médiatique, seules quelques minutes d’interview sont diffusées dans une séquence que l’on ne maîtrise pas du tout, et où on peut se sentir dépossédé de sa parole. Finalement, les médias où notre parole est la plus respectée sont ceux dans lesquels les émissions sont préparées et qui nous permettent d’ intervenir longuement. Mais on n’est pas toujours sur France Culture…
Recueilli par Agnès Martial