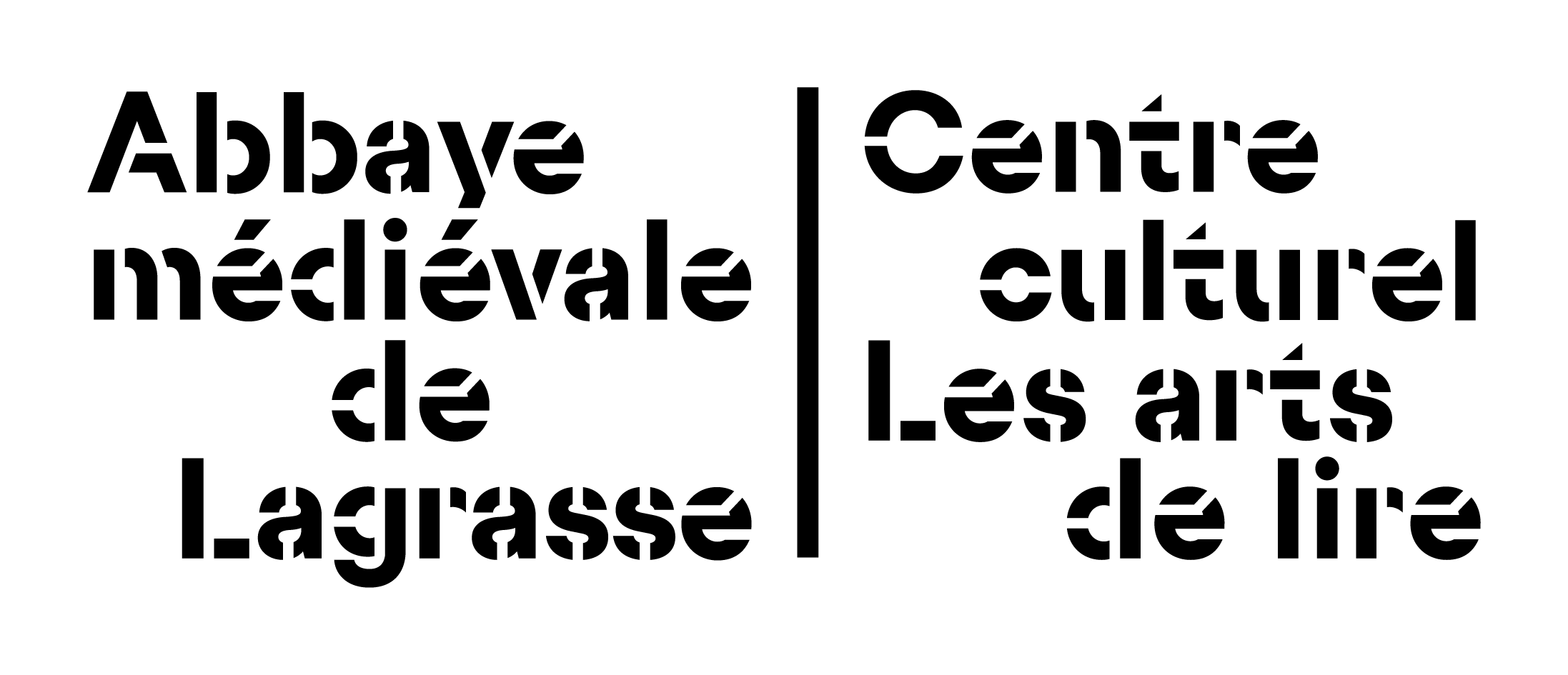Entretien avec l’artiste Fanny Stauff, à l’occasion de l’exposition Résurgences, du 19 juin au 31 octobre 2025, à l’Abbaye médiévale de Lagrasse, Centre culturel Les arts de lire.
Fanny Stauff dévoile une série de toiles puissantes dans les espaces de l’abbaye, crées pour le lieu au cours de l’année 2025. Plongée dans les profondeurs du temps et de la matière, Résurgences nous entraîne au cœur d’un monde en mutation, où les formes émergent des strates du passé pour questionner notre présent catastrophique. Dans cet entretien, Fanny Stauff dévoile les sources de sa création : la tectonique des émotions, les inquiétudes climatiques, les forces telluriques et magmatiques qui traversent ses œuvres.
Propos recueillis par Jean-Sébastien Steil
Commençons par le titre, Résurgences. Que signifie-t-il pour vous ? Et quel a été le point de départ de cette exposition ?
Fanny Stauff : Le mot Résurgences fait d’abord référence pour moi aux phénomènes géologiques : les sources souterraines qui refont surface, les mouvements lents de la Terre, les éruptions. Mais il évoque aussi des formes qui reviennent, qui insistent, pour reprendre un terme d’Agamben : des formes animales, végétales, minérales, ou des archétypes. Ce mot me permettait de relier mes préoccupations plastiques à une pensée du temps non pas linéaire, mais circulaire, souterraine. Un temps fait de remontées, de persistances. C’est souvent de cela que parlent mes peintures : de ce qui resurgit sans prévenir, de ce qui nous traverse malgré nous.
Vous évoquez le thème du temps, effectivement omniprésent dans votre production. Comment le jeu avec le temps s’exprime-t-il ? Est-ce par la résurgence d’éléments engloutis dans l’histoire profonde, géologique ? Ou est-ce aussi par des accélérations, des confrontations entre dynamiques temporelles différentes ?
FS : Avant cette exposition, j’avais commencé à travailler sur des Résurgences, et plus largement sur la confrontation des temps : le temps présent, humain, rapide — celui de la technique —, et le temps long, celui des ères géologiques, des transformations lentes et profondes. Ce choc entre les temporalités produit une forme de tension, parfois de violence, et nourrit une certaine inquiétude. Aujourd’hui, inspirée aussi par le paysage autour de mon atelier, je m’intéresse encore davantage au temps géologique et aux traces qu’il laisse : fossiles, strates, plissements… Autant de formes qui nous rappellent les ères passées.
Ce qui m’importe de plus en plus, est la question des origines : revenir à la source, qu’elle soit chimique — les fonds marins propices à l’apparition de la vie — ou tellurique, avec les forces magmatiques à l’origine des matières minérales, végétales, animales… et humaines.
Le temps renvoie par ailleurs à une inquiétude profonde, qui agit de deux manières. D’abord, une inquiétude personnelle, presque existentielle. Depuis toujours, je suis attirée par le mystère des choses, par ce qui échappe. C’est ce qui me touche dans une peinture, une sculpture, une architecture. Ce mystère résonne avec quelque chose en moi. Et il y a une inquiétude plus collective, objective : celle liée à l’état du monde, au dérèglement climatique, à la destruction du vivant. Quand je dis vivant, j’y inclus aussi bien l’humain, l’animal, le végétal que le minéral. L’homme agit comme s’il dominait ce qui l’entoure, alors même que cela le constitue. Mon travail essaie de transformer cette inquiétude en images, en scènes théâtralisées. J’y mets en tension le sublime de la nature et la menace qu’elle porte en elle aujourd’hui, comme par exemple la glace qui fond, ou les villes à peine suggérées par des lignes droites et froides… Je cherche à dire le sublime, mais aussi le danger.
Le rapport que vous mentionnez à la théâtralité et à la mise en scène n’est pas anodin, puisque vous êtes aussi cheffe décoratrice de cinéma. Quel lien faites-vous entre votre pratique picturale et votre travail de scénographe ?
FS : Il est question, dans les deux domaines, d’espaces en transformation. J’ai une formation en scénographie à l’école des Arts décoratifs. Depuis le début, ce qui m’a passionnée, c’était la création d’atmosphères, de lieux chargés de sens.
Le décor et la peinture sont deux façons de créer des mondes. Chaque décor raconte une histoire, ainsi que chaque peinture. Même si, s’agissant de la peinture, il s’agit de formes condensées, raccourcies.
Dans la série des Résurgences marines, ensemble de quatre toiles qui se font face deux par deux, coexistent, sur chaque toile, les abysses et la surface, la profondeur et la lumière. Chaque image concentre beaucoup de strates et de temporalités. Je ne cherche pas à illustrer, mais à faire appel à des symboles, à des archétypes qui parlent à l’inconscient du regardeur.
Cela produit une triple accélération de la perspective : spatiale, temporelle et symbolique. Dans ces toiles marines, on voit une stratigraphie de l’océan, une coupe latérale presque scientifique. On perçoit aussi un temps cyclique, celui des courants marins ou de la lumière. Et enfin, il y a aussi une dimension quasi mythologique, avec cette lumière qui vient révéler les ténèbres abyssales. On pourrait y voir une forme d’élévation morale ou spirituelle, n’est-ce pas ?
FS: En effet, mais on pourrait à l’inverse dire que la lumière procède des ténèbres. Dans une seule toile, on peut avoir une confrontation de plusieurs temporalités : celle des origines, celle du présent, et aussi un temps spirituel, sans connotation nécessairement religieuse. Il y a cette tension entre une pulsation qui vient du centre de la Terre — du feu, du chaos, de la matière — et parallèlement une légèreté, une évaporation presque aérienne. Une confrontation entre des forces matérielles très puissantes, et quelque chose de plus éthéré, quasiment spirituel.
Votre exposition cohabite avec Monstres et chimères, Images des plafonds peints médiévaux. Cette autre exposition présente des photographies de closoirs peints, et présente des images médiévales de monstres et de chimères. Ce sont des figures démoniaques, sataniques, l’incarnation du mal. Les artistes médiévaux représentaient ce qu’ils croyaient réel – les monstres –, ou inventaient des créatures fantastiques – les chimères – pour figurer des êtres qui n’existent pas. Comment avez-vous abordé la cohabitation avec cette exposition ? A-t-elle nourri votre propos, et de quelle manière ?
FS : Cela m’a en effet énormément nourrie. À la fois l’exposition et le lieu. Je suis très touchée par la pensée médiévale, cette pensée analogique où l’imaginaire n’est pas perçu comme une invention, mais comme une réalité. Michel Pastoureau écrit que « L’imaginaire est une réalité ». À cette époque, on ne séparait pas le réel de l’imaginaire. Le génie des artistes médiévaux m’émerveille : ces formes d’hommes mi-végétaux, mi-animaux, cette profusion d’inventions… En tant qu’artiste, je suis impressionnée par la créativité, mais aussi par la symbolique. Ces créatures n’étaient pas décoratives, elles avaient pour fonction de relier les mondes. Aujourd’hui, dans notre société malade du manque de liens, tout ce qui relie me semble fondamental.
Le lieu m’a par ailleurs beaucoup inspirée. Ce n’est pas un cube blanc neutre, c’est un lieu chargé de mémoire. J’ai voulu dialoguer avec les fantômes du lieu, mais aussi les créatures qui y habitent : les chauves-souris, les sculptures, les peintures médiévales…
Vous avez travaillé par cellule thématique, en fonction des espaces dans lesquels l’exposition est déployée : l’ancienne sacristie, la bibliothèque (ancien transept nord), le haut de l’escalier dans la tour préromane, la galerie haute du logis abbatial. Chaque espace est investi d’une série de toiles correspondant à la même thématique : Résurgences glaciaires, marines, sylvestres et minérales. Chaque « cellule » est enfin composée de diptyques en vis-à-vis, de triptyques ou de quadriptyques. Comment avez-vous pensé le déploiement spatial, très structuré – on pourrait dire architecturé –, de l’exposition ?
FS : J’ai en effet conçu l’exposition en fonction de la circulation des visiteurs, comme un parcours au sein de différents paysages, et dont le séquençage peut s’apparenter à une démarche initiatique. Chaque espace correspond à un élément, mais aussi à un état. Mon travail de scénographe entre en jeu : je pense l’espace, l’histoire et le sens dans le même élan.
À l’intérieur de chaque cellule, le choix des sujets s’est imposé de lui-même. Je voulais par exemple qu’un cerf accueille le visiteur en haut de l’escalier, qu’il le regarde. D’autres animaux viennent du fond des âges, comme cette genette qui surgit d’une souche d’arbre. Je voulais qu’ils aient à la fois une présence immédiate, les saisir en plein surgissement, et qu’ils portent la mémoire d’un passé ancien. L’auroch, au départ, devait être un sanglier. Mais je n’y arrivais pas : le sanglier résistait, je n’arrivais pas à lui donner la personnalité recherchée. Il est devenu tour à tour un dinosaure, une tortue, jusqu’à ce que l’auroch s’impose. La renarde et son petit devaient être sous terre, dans un terrier. Finalement, je les ai fait surgir d’un limon originel, abrités sous une souche d’arbre. C’est aussi lié à mes observations autour de mon atelier : ce sont des animaux que je croise, que je rencontre, qui viennent nourrir mon imaginaire.
Comment avez-vous conçu la scénographie ?
FS : J’ai voulu une scénographie la plus discrète possible. J’ai conçu l’exposition à rebours : au lieu de créer les tableaux d’abord, puis de les disposer dans l’espace d’exposition, je suis d’abord allée repérer le lieu, un peu comme on le fait au cinéma. J’ai écouté ce qu’avaient à me dire les pierres, les chauves-souris. J’ai observé la lumière : d’où elle venait, comment elle frappait le sol, les murs. À partir de là, j’ai pris les mesures et déterminé où chaque toile serait accrochée, sa taille, la direction de la lumière dans la toile en écho à la lumière naturelle du lieu. Les sujets sont nés du lieu lui-même.
L’accrochage était très technique puisqu’on ne peut pas planter de clous dans les murs. L’équipe de l’abbaye a été formidable, très impliquée et à l’écoute. Mon exigence était un accrochage totalement invisible, sans clou ni vis. Tout devait venir du haut, sans que rien ne se voie. C’était un travail d’équipe, comme sur un tournage, où chaque compétence est essentielle pour atteindre un haut niveau d’exigence et de précision.
Faites-vous beaucoup d’esquisses avant de passer à la toile ? Quelle place le dessin occupe-t-il dans votre processus de création ?
FS : Je dessine énormément. Je tords, retords les formes, je cherche le mouvement, la puissance. C’est pareil pour les végétaux, comme les algues macrocystis, que je dessine des dizaines de fois avant que la forme me convienne. Je veux traduire une force tellurique, une vitalité. Pour cela, je fais des dessins, et même parfois des maquettes miniatures en argile. Par exemple, pour représenter les renards émergeant de la boue, il était difficile d’imaginer comment la boue se fracture quand elle est encore fraîche. Je ne trouvais rien dans les livres, ni sur Internet. Alors j’ai fait une maquette avec de l’argile du jardin. J’ai sculpté les formes, créé les fractures, presque comme un dessin en 3D.
Vous procédez donc à partir de l’observation, comme les naturalistes qui cherchent à saisir le mouvement des oiseaux, mais aussi d’expériences. Votre façon de travailler évoque un va-et-vient entre une image mentale et son exécution plastique. Quelle est la place de l’accident, de l’imprévu dans la production de l’œuvre ?
FS: Je construis une image mentale en me recentrant profondément, puis je commence à dessiner. C’est dans le faire que la forme m’échappe, me surprend. Chaque geste amène un choix : dois-je ou non garder ce trait ? Enrichit-il le sens ? La touche ou la couleur provoquent-ils l’effet désiré ? Il y a un langage plastique pur — ce qui me plaît ou non — mais aussi une dimension symbolique.
Vous avez peint en hiver, debout, dans votre atelier non chauffé. Est-ce que cet inconfort était une condition recherchée ?
FS: Absolument. Le froid, l’inconfort, créent une tension essentielle. Si je suis trop bien installée, ma pensée devient molle. Je veux rester en éveil. L’inconfort contribue à la tension qui s’exprime sur la toile. Étudiante en école d’art, je dessinais souvent debout dans le métro. Le refus de toute séduction dans ma peinture est le fruit de cette exigence, qui passe par le corps en action. Auparavant, j’utilisais surtout des bruns, du noir et blanc. Aujourd’hui, et en particulier pour cette exposition, j’ai introduit des couleurs vives. Ce choix était aussi lié au lieu : les murs en pierre de l’abbaye appellent des couleurs qui contrastent avec le gris du calcaire.
Quel place accordez-vous à l’interprétation du regardeur ?
FS: Ce que je cherche à provoquer, c’est un trouble. Je crois en la valeur de l’ambigu. Une peinture ne livre pas tout. Elle appelle une attention lente, une présence. Et c’est dans cette zone trouble qu’il peut se passer quelque chose. Je propose un sens, bien sûr : le merveilleux, la protection du vivant. Mais chacun s’en empare selon sa sensibilité. Mon plus beau cadeau serait qu’un tableau fasse trace, qu’il entre dans l’imaginaire d’un visiteur et ressurgisse plus tard dans sa vie, sous la forme d’une image mentale.
Quelle place occupe, selon vous, la peinture dans le paysage artistique contemporain ?
FS : Une place de plus en plus importante. Pendant vingt ans jusqu’aux années 2000, on a annoncé la mort de la peinture. Mais aujourd’hui, elle est redevenue centrale. Quand on observe les écoles des beaux-arts, c’est ce que veulent faire la majorité des étudiants. Dans les années 1980-90, les profs d’art disaient : « La peinture est has-been, il faut faire de la vidéo, de l’installation. » Aujourd’hui, c’est complètement différent. Je parle ici de la France, parce qu’à l’étranger, la peinture n’a jamais vraiment perdu sa place. En France, elle est revenue en force depuis une vingtaine d’années. Même si les critiques ont longtemps résisté, que certains ricanaient, les étudiants, eux, s’en sont réemparés. Je pense qu’il y a, à travers la peinture, un rapport très sensuel au monde. C’est une forme primitive d’expression. L’art des premiers hommes s’est exprimé par la peinture. Il y a là quelque chose de profondément humain.
On est dans le banquet des corps. Comment le thème du Choix des corps entre-t-il en résonance avec votre travail ?
FS : Rosie Braidotti disait : « Tout corps est une frontière en transformation ». Cette exposition parle justement de mutations des formes et des corps. Les choses sont totalement liées. Les trois dernières toiles évoquent des corps anthropiques, comme échoués à la manière de baleines, de cétacés, ou de dinosaures dont l’humanité serait la descendance géologique. Ce sont des formes qui émergent de l’argile, matière qui évoque à la fois la chair animale et humaine. Ces créatures semblent circuler sous la croûte terrestre, surgir pour échapper à la pression du sol, puis replonger. Elles ont la teinte de chairs à nu. À travers elles, on retrouve une même chair du monde, commune à l’animal, au végétal, à l’humain… et même au minéral et à l’aquatique.
Quelle image, quelle sensation résume pour vous ce travail autour des Résurgences ?
FS : J’utiliserais une citation de Georges Bataille dans Lascaux, la naissance de l’art : « L’art le plus ancien ne racontait pas l’homme, mais les forces. » Il parle des forces auxquelles étaient confrontés les premiers hommes. Il s’agit des forces telluriques, magmatiques, des éléments, mais aussi des animaux. À Lascaux, ce sont les animaux que l’on voit. L’eau, l’air, le feu sont les éléments face auxquels l’homme se mesure. C’est un retour à ce qui nous relie de façon la plus intime au monde, au cosmos.
Photographie par Idriss Bigou-Gilles