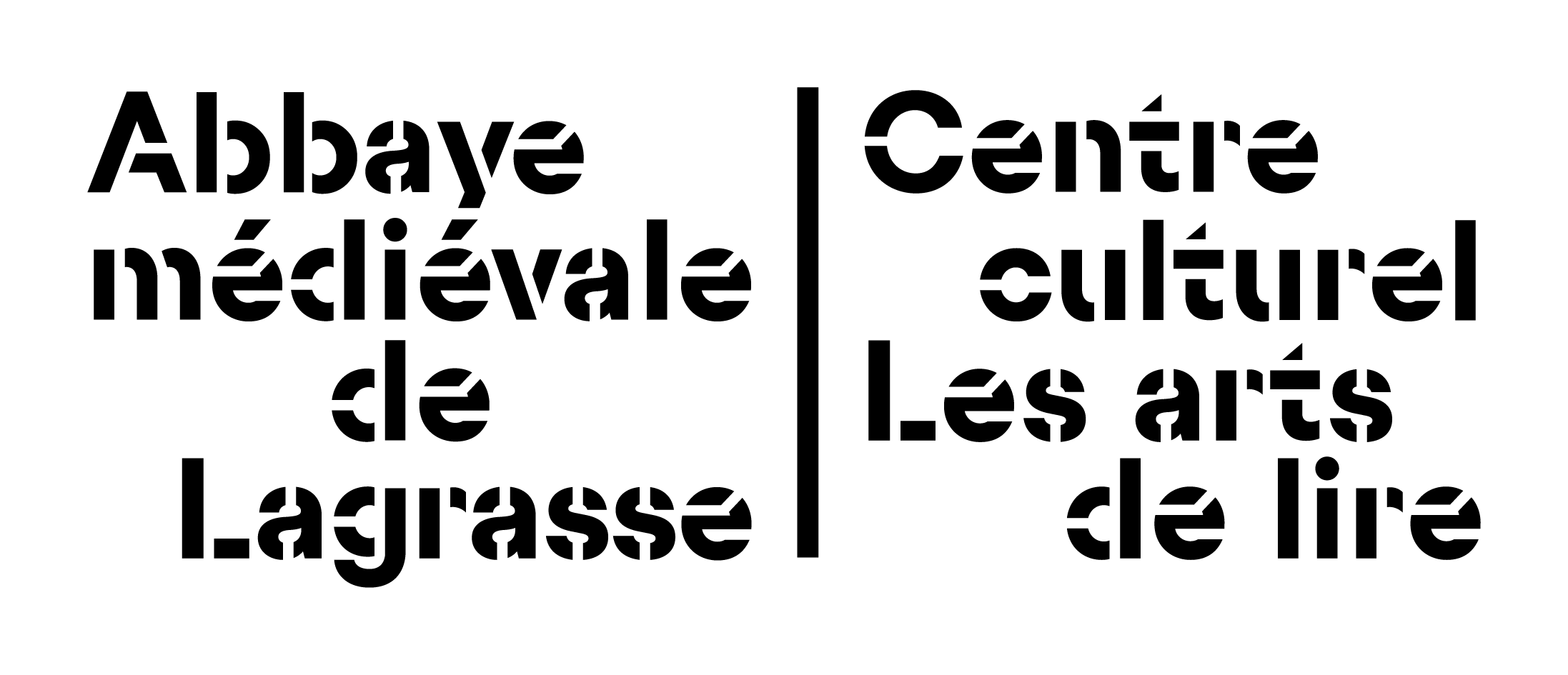Un modeste voyage dans les multiples générations de « la » génération se clôt mais ce qui se dit, en nous, de ce qui s’est dit au cours de ce Banquet du livre, ne s’achèvera pas. Au lieu de clore une question, les portes de leurs ressorts, dégondés, demeurent grandes ouvertes : nez au vent, l’oreille attentive, aux sons des tournois urbains de Diaty Diallo ou des nostalgies musicales soviétiques intemporelles incarnées par Sonia Wieder-Atherton, un viatique commun se dessine, entre les générations. Léonor de Recondo en a transfiguré les sens, dessinés, creusés, sillonnés, par un collectif temporaire, intempestif et donc intemporel, que la Banquet invente depuis 28 ans. Presque une génération ? Le passage de témoins est passé.

Patrick Boucheron nous a pourtant fait comprendre ce midi combien anticiper les adieux permet de ne jamais se quitter. D’après Irène Théry, la génération demeure, malgré tout, une question non résolue de compréhension du monde social avant que le miroir que nous tend Christophe Pradeau ne nous ramène sans cesse à la recherche d’une empreinte retrouvée du temps ; elle nous libère et affranchit des impasses des divisions du temps dénoncées par Lucien Febvre.
Bégayons les temps qu’il fait ou que l’on croit faire, en confrontant deux derniers textes – celui de Marc Bloch, extrait de son testament inachevé mais jamais trahi, Apologie pour l’Histoire, rédigé en veille et en creux du sacrifice – et celui d’une sociologue, Claudine Attias-Donfut, pour qui la psychanalyse n’est pas antinomique à la saisie du social, bien au contraire.
Nos futurs, à leurs côtés, peuvent s’attendre sans inquiétude, empreints des échos du concert, improbable et infini, des générations. En dormance.
Yann Potin
portrait de Diaty Diallo par Idriss Bigou-Gilles
Extrait de Marc Bloch, Apologie pour l’histoire, Paris, 1949 (1991), éd. Etienne Bloch, chapitre III « La nomenclature ».

Dans le désarroi de nos classifications chronologiques, une mode s’est glissée, assez récente, je crois, d’autant plus envahissante, en tout cas, qu’elle est moins raisonnée. Volontiers, nous comptons par siècles.
Longtemps étranger à tout dénombrement exact d’années, le mot, lui aussi, avait originairement ses résonances mystiques : accents de Quatrième Églogue ou de Dies Irae. Peutêtre ne s’étaientelles pas tout à fait amorties au temps où, sans grand souci de précision numérique, l’histoire s’attardait, avec complaisance, sur le « siècle de Périclès », sur celui de « Louis XIV ». Mais notre langage s’est fait plus sévèrement mathématicien. Nous ne nommons plus les siècles d’après leurs héros. Nous les numérotons à la file, bien sagement, de cent ans en cent ans, depuis un point de départ une fois pour toutes fixé à l’an un de notre ère. L’art du XIIIe siècle, la philosophie du XVIIIe, le « stupide XIXe siècle » : ces figures au masque arithmétique hantent les pages de nos livres. Qui de nous se vantera d’avoir toujours échappé aux séductions de leur apparente commodité ?
Par malheur, aucune loi de l’histoire n’impose que les années dont le millésime se terminent par le chiffre 1 coïncident avec les points critiques de l’évolution humaine. D’où d’étranges fléchissements de sens. « Il est bien connu que le dixhuitième siècle commence en 1715 et s’achève en 1789 ». J’ai lu cette phrase naguère dans une copie d’étudiant. Candeur ? Ou malice ? Je ne sais. C’était en tout cas assez bien mettre à nu certaines bizarreries de l’usage. Mais, s’il s’agit du XVIIIe siècle philosophique, on pourrait sans doute encore mieux dire qu’il débuta fort avant 1701 : l’Histoire des Oracles parut en 1687 et le Dictionnaire de Bayle en 1697. Le pis est que le nom, comme toujours, entraînant avec lui l’idée, ces fausses étiquettes finissent par tromper sur la marchandise. Les médiévistes parlent de la « renaissance du douzième siècle ». Grand mouvement intellectuel, assurément. A l’inscrire cependant, sous cette rubrique, on se laisse trop aisément aller à oublier qu’il débuta, en réalité, vers 1060, et certaines liaisons essentielles échappent. En un mot, nous nous donnons l’air de distribuer, selon un rigoureux rythme pendulaire, arbitrairement choisi, des réalités auxquelles cette régularité est tout à fait étrangère. C’est une gageure. Nous la tenons naturellement fort mal. Il faut chercher mieux.
Tant qu’on s’en tient à étudier, dans le temps, des chaînes de phénomènes apparentés, le problème, en somme, est simple. C’est à ces phénomènes mêmes qu’il convient de demander leurs propres périodes. Une histoire religieuse du règne de PhilippeAuguste ? Une histoire économique du règne de Louis XV ? Pourquoi pas : « Journal de ce qui s’est passé, dans mon laboratoire sous la deuxième présidence de Grévy », par Louis Pasteur ? Ou, inversement, « Histoire diplomatique de l’Europe, depuis Newton jusqu’à Einstein ».
Sans doute, on voit bien par où des divisions tirées uniformément de la suite des empires, des rois ou des régimes politiques ont pu séduire. Elles n’avaient pas seulement pour elles le prestige qu’une longue tradition attache à l’exercice du pouvoir, « à ces actions, disait Machiavel, qui ont l’air de grandeur propre aux actes du gouvernement ou de l’État ». Un avènement, une révolution ont leur place fixée, dans la durée, à une année, voire à un jour près. Or, l’érudit aime comme on dit, à « dater finement ». Il y trouve, avec l’apaisement d’une instinctive horreur du vague, une grande commodité de conscience. Il souhaite avoir tout lu, tout compulsé de ce qui concerne son sujet. Combien seratil plus à l’aise si, devant chaque dossier d’archives, il peut, calendrier en mains, faire le partage : avant, pendant, après !
Gardons-nous, pourtant, de sacrifier à l’idole de la fausse exactitude. La coupure la plus exacte n’est pas forcément celle qui fait appel à l’unité de temps la plus petite — auquel cas, il faudrait préférer, non seulement l’année à la décade, mais aussi la seconde au jour — c’est la mieux adaptée à la nature des choses. Or chaque type de phénomènes a son épaisseur de mesure particulière et, pour ainsi dire, sa décimale spécifique. Les transformations de la structure sociale, de l’économie, des croyances, du comportement mental ne sauraient, sans déformation, se plier à un chronométrage trop serré. Lorsque j’écris qu’une modification extrêmement profonde de l’économie occidentale, marquée à la fois par les premières importations massives de blés exotiques et par le premier grand rayonnement des industries allemande et américaine, se produisit entre 1875 et 1885 environ, j’use de la seule approximation qu’autorise ce genre de faits. Une date soi-disant plus précise trahirait la vérité. De même, en statistique, une moyenne décennale n’est pas, en soi, plus grossière qu’une moyenne annuelle ou hebdomadaire. Simplement, elle exprime un autre aspect de la réalité.
Il n’est d’ailleurs nullement impossible, a priori, qu’à l’expérience, les phases naturelles de phénomènes d’ordre en apparence très différent, ne se trouvent se recouvrir. Estil exact que l’avènement du Second Empire introduisit une période nouvelle dans l’économie française ? Sombart avaitil raison d’identifier l’essor du capitalisme avec celui de l’esprit protestant ? M. Thierry Maulnier voitil juste en découvrant dans la démocratie « l’expression politique » de ce même capitalisme (pas tout à fait le même, en réalité, je le crains) ? Nous n’avons pas le droit de rejeter de parti pris ces coïncidences, si douteuses qu’elles puissent nous sembler. Mais elle n’apparaîtront, s’il y a lieu, qu’à une condition : de ne pas avoir été postulées à l’avance. Certainement, les marées sont en rapport avec les lunaisons. Pour le savoir, cependant, il a fallu d’abord déterminer, à part, les époques du flux et celles de la lune.
Envisageant, au contraire, l’évolution sociale dans son intégralité, s’agitil d’en caractériser les étapes successives ? C’est un problème de note dominante. On ne peut ici que suggérer les voies où la classification semble devoir s’engager. L’histoire, ne l’oublions pas, est encore une science en travail.
Les hommes qui sont nés dans une même ambiance sociale, à des dates voisines, subissent nécessairement, en particulier dans leur période de formation, des influences analogues. L’expérience prouve que leur comportement présente, par rapport aux groupes sensiblement plus vieux ou plus jeunes, des traits distinctifs ordinairement fort nets. Cela, jusque dans leurs désaccords, qui peuvent être des plus aigus. Se passionner pour un même débat, fûtce en sens opposé, c’est encore se ressembler. Cette communauté d’empreinte, venant d’une communauté d’âge, fait une génération.
Une société, à vrai dire, est rarement une. Elle se décompose en milieux différents. Dans chacun d’eux, les générations ne se recouvrent pas toujours : les forces qui agissent sur un jeune ouvrier s’exercentelles fatalement, au moins avec une intensité égale, sur le jeune paysan ? Ajoutez, même dans les civilisations les mieux liées, la lenteur de propagation de certains courants. « On était romantique, en province, durant mon adolescence, alors que Paris avait cessé de l’être, me disait mon père, né à Strasbourg en 1848. Souvent d’ailleurs, comme dans ce cas, l’opposition se réduit surtout à un décalage. Quand donc nous parlons de telle ou telle génération française, par exemple, nous évoquons une image complexe et non, parfois, sans discordance — mais dont il est naturel de retenir avant tout les éléments vraiment directeurs.
Quant à la périodicité des générations, il va de soi qu’en dépit des rêveries pythagoriciennes de certains auteurs, elle n’a rien de régulier. Selon la cadence plus ou moins vive du mouvement social, les limites se resserrent ou s’écartent. Il y a, en histoire, des générations longues et des générations courtes. Seule l’observation permet de saisir les points où la courbe change d’orientation. J’ai appartenu à une École où les dates d’entrée facilitent les repères. De bonne heure, je me suis reconnu, à beaucoup d’égards, plus proche des promotions qui m’avaient précédé que de celles qui me suivirent presque immédiatement. Nous nous placions, mes camarades et moi, à la pointe dernière de ce qu’on peut appeler, je crois, la génération de l’Affaire Dreyfus. L’expérience de la vie n’a pas démenti cette impression.
Il arrive enfin, forcément, que les générations s’interpénètrent. Car les individus ne réagissent pas toujours pareillement aux mêmes influences. Parmi nos enfants, il est, dès aujourd’hui, assez aisé de discerner, en gros, selon les âges, la génération de la guerre de celle qui sera, seulement, celle de d’aprèsguerre. A une réserve près, toutefois : dans les âges qui ne sont pas encore l’adolescence presque mûre, et ont pourtant dépassé la petite enfance, la sensibilité aux événements du présent varie beaucoup avec les tempéraments personnels ; les plus précoces seront vraiment « de la guerre » ; les autres demeureront sur le bord opposé.
La notion de génération est donc très souple, comme tout concept qui s’efforce d’exprimer, sans les déformer, les choses de l’homme. Mais elle répond aussi à des réalités que nous sentons très concrètes. Depuis longtemps, on l’a vu utilisée, comme d’instinct, par des disciplines que leur nature conduisait à se refuser, avant toutes autres, aux vieilles divisions par règnes ou par gouvernements : telle l’histoire de la pensée, ou celle des forces artistiques. Elle semble destinée à fournir, de plus en plus, à une analyse raisonnée des vicissitudes humaines, son premier jalonnement.
Mais une génération ne représente qu’une phase relativement courte. Les phases plus longues se nomment civilisations.

Extrait de Claude Attias-Donfut, La sociologie des générations, Paris, PUF, 1988.
Une génération ne serait-elle qu’une transition entre l’une qui s’en va, l’autre qui vient, telle la figure de Janus, une face tournée vers le passé, l’autre vers le futur ? Les doubles évocations de la tradition et de la nouveauté, de la continuation et de la rupture sont indissociablement éveillées par l’idée de génération, l’accentuation étant portée, tantôt sur le poids du passé, tantôt sur la tension vers l’avenir. Dans la suite des générations, quelle est l’empreinte de chacune d’elles ? Entre celle qu’elle reçoit et celle qu’elle imprime, quelle est celle qui la forme le temps de sa présence ?
L’empreinte du temps inscrit une génération dans la suite des générations et l’en distingue tout à la fois dans son expérience unique et sa durée concrète. La réalité historique d’une génération se fond dans la suite des générations. La mémoire et l’histoire n’émergent à la conscience qu’en tant qu’une continuité est établie entre les faits, les événements, les traces. Cette continuité est toujours du ressort du langage qui donne leur signification aux traces, en reconstitue les liens, assure la transmission. Transmettre est l’enjeu capital des échanges entre générations, avec son négatif, l’oubli, l’effacement du savoir. Mais transmission partielle et oubli partiel sont nécessaires et positifs comme l’exprime le message biblique : Moïse n’a pas tout transmis, car le maître se doit de laisser une place au disciple. Pour que l’enseignement soit une « parole créatrice de parole » (Levinas, En découvrant l’existence, avec Husserl et Heideggr, 1949), il faut un non-dit, un silence dans lequel puisse s’introduire l’élève. Et ce que Moïse a transmis a été en partie oublié à sa mort et… restauré par le raisonnement puissant (pilpoul) d’un disciple (Ouaknin, Le livre brûlé, 1986, p. 24-29). Car le savoir n’est pas donné, il doit se conquérir, la transmission ne consiste pas à déposer un savoir inerte d’une génération à l’autre ; elle est « reprise, vie, invention et renouvellement, modalité sans laquelle le révélé, c’est-à-dire une pensée authentiquement pensée, n’est pas possible » (Levinas, L’au-de là du verset, 1982, p. 99).
Par son héritage, sa création propre, son legs, une génération s’inscrit dans la continuité de l’histoire. Réalité sociale temporelle, immatérielle, elle reçoit la marque du temps historique matérialisée, quant à elle, dans les œuvres ou inscrite dans les êtres, objectivée dans le « 3e monde », le monde des connaissances sans sujets connaissants (Popper, La connaissance objective), ou gravée dans l’acte de penser, de faire.
La recherche des « traces » guide le pisteur vers la première option, vers l’archéologie, au sens commun comme au sens foucaldien. Le dévoilement de l’empreinte définie par ce qui façonne les êtres de par leur immersion dans l’histoire, procède de la recherche des processus et microprocessus sociaux et mentaux par lesquels se forme une génération.
Ces processus ne sauraient être réduits aux phénomènes psychosociaux d’influence ou de contagion sociale, car la génération ne forme pas une entité concrète mais un ensemble anonyme. Son existence sociale n’est que partiellement formalisée sur la base de regroupements, à certaines phases de la vie – jeunesse, vieillesse – et pour une partie de ses membres. Elle ne peut donc être assimilée à un pôle de sociabilité bien que cette fonction ne soit pas à négliger. On ne saurait non plus réduire l’empreinte du temps à l’action d’un événement unique, conformément à une pratique courante évoquée précédemment et que nous avons interprétée comme point de repère temporel contribuant tout à la fois à la construction de la mémoire collective et de l’histoire contemporaine.
L’empreinte effective du temps déborde l’événement, elle se produit par toute interaction avec l’environnement, par toute expérience perceptive de la réalité externe, médiatisée par le langage, par les représentations sociales, par les images et les symboles. L’expérience porte sur les événements vécus, mais aussi sur les idées, les valeurs collectives ; elle se rapporte également aux images qu’elles soient diffusées par les médias (Michel Denis, Images mentales, 1979), ou offertes par le système d’objets produits par la société.
Au cours d’une vie, les marques laissées par les différentes expériences entrent en interaction, se restructurent continuellement, dans un renvoi incessant du passé au présent et du présent au passé, produisant ainsi une durée individuelle en correspondance avec la durée collective.
La durée commune est la principale référence qui fonde une génération, une durée concrète, faite d’histoire, objet de discours. Structure de médiation entre temps individuel et temps social, cette durée commune établit les correspondances entre les durées individuelles vécues, ordonne les séries chronologiques et offre la référence d’un ordre temporel. La génération est une réalité d’ordre temporel, elle est immatérielle et symbolique. Profondément inscrite dans l’ordre social, elle s’enracine dans la dimension historique constitutive des êtres eux-mêmes dans leur matérialité.
[…]