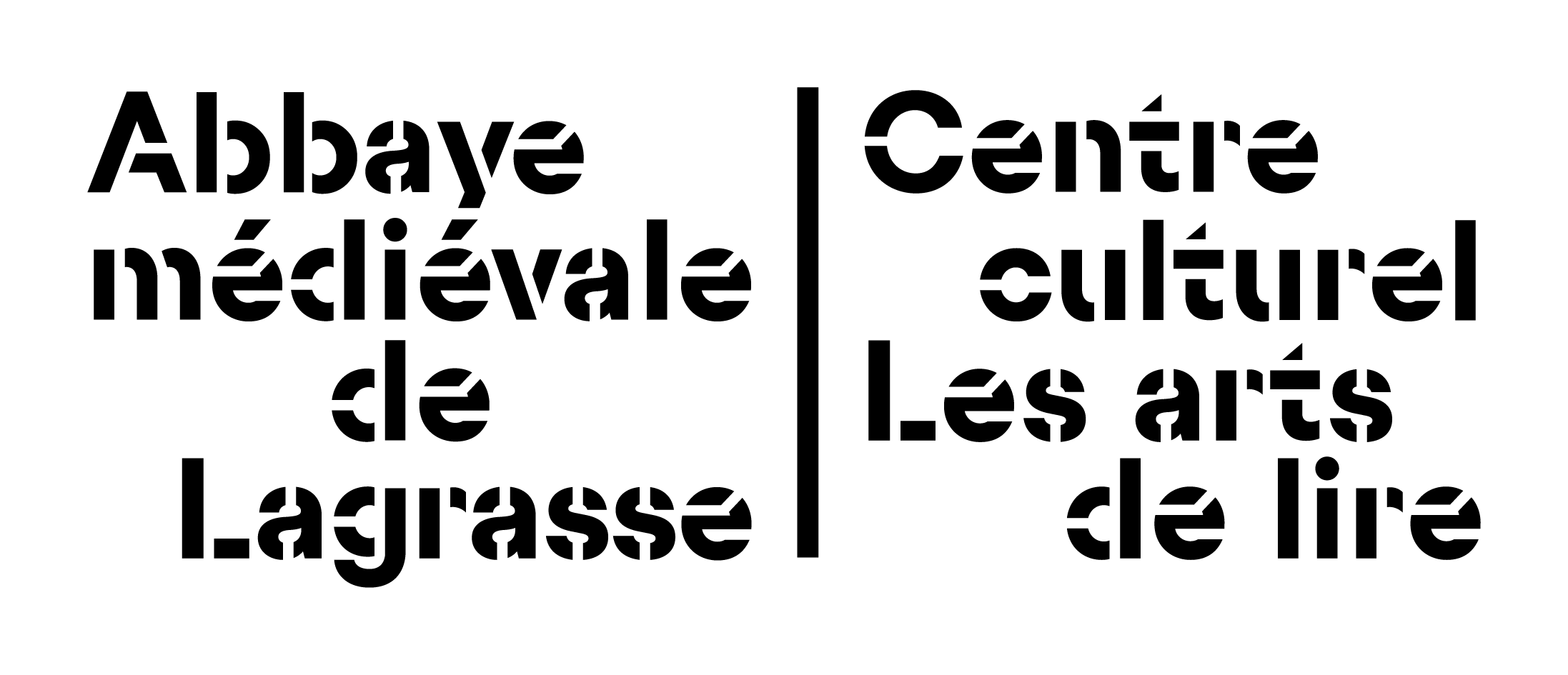Dans la pénombre d’un samedi soir d’été, au cœur des Corbières déchirées par un vent perçant, résonnent dans la salle polyvalente bondée de Lagrasse les mots nus de Patrick Boucheron au cœur du prologue de son spectacle Contretemps, une poésie (qui nous vient) du Moyen Âge : « Ecoutez le passé, ça vient de loin. Il nous pèse. Il nous brise les os. » Peut-être, bien davantage qu’un prologue au spectacle, se donne à entendre là, dès son entame lumineuse mais toute de noir vêtue, l’exergue même du Banquet d’été placé sous le signe de « Générations, nos futurs ». Comme si ce premier temps du Banquet, celui de la déploration de la force négative du passé, en habits noirs de deuil, donnait aussi sa couleur tonale : celle d’une articulation historique étroite et poétique entre différentes transmissions, les unes sombrement négatives, les autres lumineusement ouvertes et neuves. Une articulation qui conjure le ressassement meurtrier du passé et qui propose de venir, avec joie, réhabiter le présent.
Car ce présent, en ce premier jour de Banquet ce dimanche, n’est pas si facile que ça à habiter. Le Banquet s’est ouvert sur Contretemps, et justement il y en a. Il y a même un contretemps de taille : il y a tout d’abord le vent. Il y a ensuite le vent. Il y a enfin le vent. Le vent qui, par bourrasques folles, balaie les cyprès, arase l’herbe et fait s’envoler les assiettes. Ce vent, inhabituel, sauvage et mauvais, est comme un pense-bête tonitruant de l’histoire de ce que l’homme a fait à la nature : d’un passé écocide impossible à rédimer, allez savoir. Le vent finalement refait les lieux, les vide et les déplace. Changement de programme : tout se déroulera pour les premiers jours dans la salle polyvalente où Patrick Boucheron a joué samedi soir et dans le cellier où se tient la très belle librairie Ombres Blanches, déplacée de Toulouse pour l’occasion mais pas par le vent : ils sont venus de leur plein gré. Mais, enfin, il faut peut-être le dire ainsi car la pensée a hanté chacun à chaque rafale : le passé qui brise les os, c’est d’abord le vent qui brise des branches et qui casse la tête.
Une langue forte, à la violence nue…
On voudrait plaisanter avec ce vent du passé, le mettre à distance par l’ironie comme on vient de faire mais il revient obstinément comme une interrogation terrible et sourde qui plane sur les différentes interventions qui ont traversé cette première journée. Peut-être pour saisir comment s’y est dit la transmission, la manière dont les générations se perçoivent comme trouées par un passé presque impossible à rédimer et si difficile à collecter, il faut aller cette après-midi au cellier écouter Emma Marsantes, autrice chez Verdier à la rentrée 2022 d’un remarquable premier roman, Une mère éphémère.
Cette lecture orale est saisissante. La cinquantaine de personnes réunies autour de la romancière sont stupéfaites. Emma Marsantes a les os brisés. On ne le voit pas mais sa voix le dit. Elle est celle qui trouve la voix de Mia pour venir, en une saga, combien sa famille a voulu détruire Mia. Dans une robe de lin orangée, Emma Marsantes dit combien la transmission, c’est l’histoire d’un meurtre qu’on ne veut pas dire mais qu’on entend bien faire subir. Elle y dit, dans une famille de la haute bourgeoisie de l’est parisien le caractère feutré de la redoutable violence physique et morale qui y règne. Les os craquent. La figure hirsute et barbare dans sa maniaquerie du père, chasseur à ses heures, pervers à temps plein. Le passé familial ne détruit pas : il tue. Emma Marsantes le dit : elle n’est pas survivante. Elle est restante.
Dans une langue forte, à la violence nue, elle nous donne une clef, après Patrick Boucheron, de la manière dont la transmission s’impose à elle : transmettre, dans une famille, c’est apprendre à mourir. On peut très bien apprendre à mourir, ça se transmet très bien dit-elle. L’appartement familial est un caveau familial. Les murs sont des murs d’os, dit Emma Marsantes. Revoici donc les os brisés dont Patrick Boucheron parlait samedi soir.
Ces os, ceux d’un passé meurtrier au-delà de toute violence, sont ceux qui sommeillent au cœur de l’œuvre de Camille de Toledo dont, de nouveau dans la salle polyvalente, il fut question dans son intervention au cœur d’un échange, dialogue à deux voix qui fut le nôtre. Peut-être peut-on en dire quelques mots ici tant la parole de Camille de Toledo a dressé un partage à la suite de Boucheron et Marsantes comme une chambre d’écho. Ici aussi les os brisés forment un xylophone macabre, celui de la mélopée du devoir de mémoire, l’injonction mémorielle européenne qui ne cesse de clamer qu’il faut se souvenir, que, depuis la verticalité institutionnelle, on ne saurait penser à l’avenir sans être obsédé par le passé. Les os brisent tout, ils coupent tout élan, ils décharnent tout. C’est l’astasie.
Mais, précise Camille de Toledo devant une salle polyvalente bondée, plongée pour l’occasion dans une demi-pénombre studieuse, il faut penser aussi combien cette transmission incapacitante n’est qu’un premier temps. Un appel du vivant ne cesse de se faire entendre. Les arbres reprennent leurs droits même dans ce qui fut l’horreur des camps. Les arbres revivent. C’est alors peut-être que se fait entendre le second temps du prologue de Patrick Boucheron : celui qui précisément donne son titre au spectacle, celui d’un contretemps qui s’énonçait ainsi : le contretemps, « Ce n’est pas le temps. C’est le surgissement du temps, joyeux ». Voilà que les idées circulent plus vite que le vent ne porte les paroles.
Ce surgissement du temps, sa joie intense à déployer ce que Camille de Toledo appelle également les « potentiels du temps », achève de guider la journée et de la mener à la lecture incandescente d’Hélène Laurain. Partout le feu résonne dans la nuit tombée au cœur même de Lagrasse, dans la scansion de cette prose rythmée comme un poème brûlant, d’un temps de l’urgence climatique, où, partout le feu ici, à la frontière espagnole proche, partout le feu, tout le temps, partout dans la dynamique des colères donc des idées au présent. Le feu se transmet comme une rage sourde. Les os achèvent de brûler.
On ne pouvait trouver de meilleure conclusion à cette journée. Peut-être ceci encore : n’oublions surtout pas de dire : quand les intervenants prennent la parole, le vent cesse de hurler : il se tait. Voilà un détail qui est loin d’être négligeable, croyez-moi.
Johan Faerber
-o-
Professeur de lettres modernes, éditeur et essayiste, Johan Faerber est membre de l’équipe éditoriale du site Diacritik où sont publiés ses articles et entretiens.