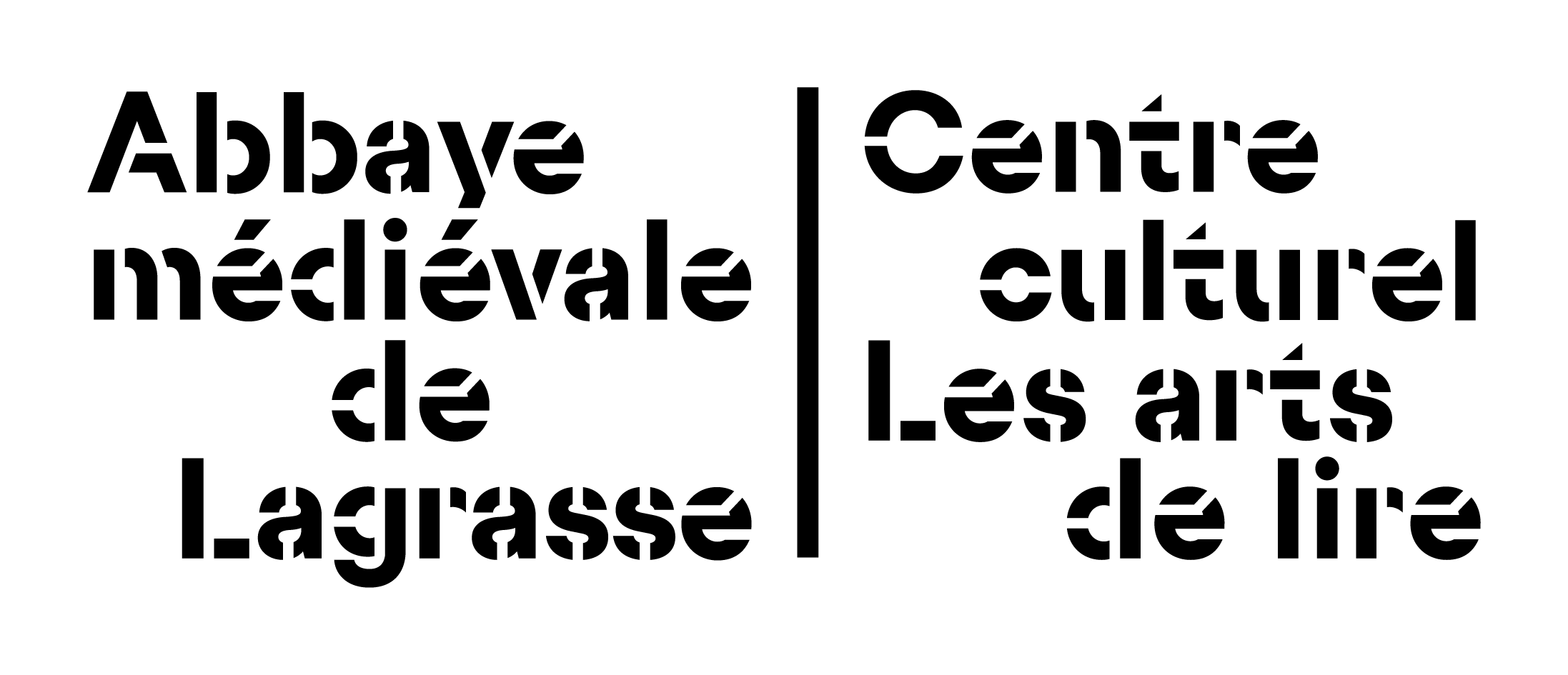Ce que peut (4/5)… la musique. Sonia Wieder-Atherton (photo Idriss Bigou-Gilles) est violoncelliste, soliste et compositrice. Après ses études au Conservatoire national supérieur de musique (CNSM) de Paris, elle part étudier à Moscou avec Natalia Chakhovskaya. Elle est lauréate du concours de violoncelle Rostropovitch en 1986. Parallèlement à son activité de concertiste, elle crée des spectacles qui sont régulièrement invités par de grands festivals internationaux. Sa large discographie témoigne de son répertoire.
Est-ce que vous considérez que votre parcours de musicienne est marqué par une dimension politique ?
Quand j’avais 19 ans, j’ai choisi d’aller en Union Soviétique après le Conservatoire de Paris pour continuer mes études avec la violoncelliste Natalia Chakhovskaïa. J’ai été plongée dans un monde écrasé sous une chape, où la musique prenait la parole alors que toute parole politique était interdite. Mes études supérieures ont été complètement imbriquées à cet apprentissage. J’ai été accompagnée, guidée, bouleversée par Natalia Chakhovskaïa qui pour moi est une sorte d’Akhmatova du violoncelle, et qui avait une tenue, une intégrité dont j’ai su bien plus tard combien elle avait pu lui coûter. Je me souviens des concierges en bas de son immeuble qui me regardaient et demandaient qui j’étais, je me souviens qu’elle faisait couler l’eau par peur d’être sur écoutes quand elle racontait certains épisodes de sa vie. En même temps elle croyait à cette idée de communisme mais elle est toujours restée très intègre, quitte à perdre énormément. C’est comme ça que j’ai grandi musicalement, artistiquement. J’ai appris la force d’un Chostakovitch à travers la musique et la force que les interprètes pouvaient mettre dans leur jeu, cette puissance que l’Occident ne connaissait pas du tout. Quand ces musiciens sont arrivés à l’Ouest, les gens sont restés comme collés au mur. Ils ont découvert ce qu’était une musique qui devient une parole, sans déclamer que c’était politique, ça l’était de fait par leur histoire. Cela a marqué ma manière d’être et de devenir musicienne, cela reste en moi, tout le temps.
Il m’est ensuite arrivé d’expérimenter des rencontres merveilleuses entre des œuvres, entre des personnes, des formes de transmission où l’on se rend compte à quel point la musique atteint les êtres. Dans presque tous les pays, toutes les cultures du monde, la musique accompagne tous les moments de la vie, tristes ou gais, les moments de fête, de mort, de douleur, de travail. La musique classique est faite de tout ça, et c’est beau quand elle ne reste pas isolée dans son univers de musique classique, de musique savante.
Comment la musique classique peut-elle sortir de cet isolement ?
La musique classique a parfois été prise en otage, on l’a enfermée dans des lieux réservés comme s’il n’y avait qu’un seul public, avisé et connaisseur. Je me souviens d’une publicité pour je ne sais plus quel produit, dans laquelle on voyait un jeune garçon au teint blafard habillé d’une petite veste de costume, qui avait l’air d’un croque-mort à 13 ans tandis qu’un autre avait les cheveux ébouriffés et respirait l’energie… celui-là jouait du rock tandis que le premier jouait du violon classique. C’est cela qu’on véhiculait. La musique classique en a souffert, elle en a été comme anémiée. À l’époque du bloc communiste, lorsque les musiciens arrivaient, emplis de ce qu’ils vivaient là-bas avant de sortir du pays, ils amenaient une vie profonde aux œuvres. Une vitalité de la résistance. Quand Benjamin Britten par exemple a rencontré Rostropovitch une profonde relation d’amitié est née. Britten s’est mis à lui dédier ses œuvres pour violoncelle. Il y a eu des rencontres qui ont créé un humus de création, des œuvres sont nées, puis tout cela s’est effondré après la chute du communisme. Il est finalement resté un establishment où 9 musiciens classiques sur 10 viennent de familles aisées. Mais la musique a toujours cette force, l’œuvre est là. La question est de savoir comment on la joue, pour qui, avec quelle mémoire ? Pour qui prend-on la parole ? C’est cela qui importe.
J’ai réalisé un projet qui s’appelle Les Odyssées, où je m’accompagne d’une bande son. Une sorte « d’histoire d’une vie ». Je joue du Prokofiev, Granados, Bach, Schumann, ainsi que des chants traditionnels. J’ai partagé cette Odyssée avec des femmes d’Afrique du Nord, avec l’écrivain Aharon Appelfeld en Israël, avec Giovanna Marini, l’extraordinaire musicienne italienne qui a fait tout un travail de recherche sur les musiques populaires italiennes… C’était toujours des partages incroyables. J’ai été en Inde, où la cadence du concerto de Prokofiev a inspiré une grande danseuse indienne, très traditionaliste, dont on m’avait dit qu’elle ne pourrait même pas entendre cette musique, et elle en a fait une chorégraphie extraordinaire… Ces rencontres sont toujours inattendues, elles vous échappent, vous ne savez jamais comment cela va se passer. Quand je joue Shakespeare/ Bach avec Charlotte Rampling, je rencontre aussi des publics différents. Ce sont des mélanges que je choisis de faire depuis très longtemps.
« Une des forces les plus précieuses c’est quand un être se lève pour la cause d’un autre. »
Quels partages occasionnent ces mélanges ?
Chaque fois que je joue devant un public, c’est un partage, avec autant de personnes qu’il y a ce jour-là. Pour moi le public c’est 1 + 1+ 1 + 1, et je sais très bien qu’il y aura mille manières de recevoir ce que je joue. C’est multiple, comme on aime le monde, et c’est ce qui me plaît. Si tous s’accordent dans la même forme de réception ça n’est pas la même chose. Je ne veux pas que tout le monde soit impressionné par la technique virtuose, que le multiple devienne un, je trouve qu’il y a là une forme de manipulation. Ce qui est beau, c’est quand j’ai l’impression que les gens sont libres de laisser ce moment-là entrer en eux, de le vivre et de tisser des liens qui leur appartiennent. Je ne connais pas ces liens, je les découvre parfois quand quelqu’un vient me raconter tel ou tel ressenti dont je n’aurais jamais imaginé que la musique puisse l’inspirer. J’aime vivre cela dans des salles où le public a entendu beaucoup, un peu ou pas du tout de musique classique. On a tout de suite accès à autre chose chez la personne que de savoir si elle reconnaît une suite de Bach, ou qu’elle applaudit entre les mouvements, cela je m’en fiche. En revanche, quand quelque chose se passe, il y a une intensité dans l’atmosphère, qui est indicible, mais qui est très tangible, que je ressens. C’est cela qui m’importe. C’est un moment qui permet une liberté d’accès à ce que l’on ressent, dans la multiplicité de chaque réception, c’est un moment gagné sur ce que l’on vous dicte, la majeure partie du temps…

Comment avez-vous traversé la séquence que nous venons de vivre en France, et la crainte de l’imminence, durant quelques semaines, de l’arrivée de l’extrême-droite au pouvoir ? Est-ce que vous avez envie d’en dire quelque chose en tant qu’artiste ?
Je ne veux pas parler « en tant qu’artiste ». Je suis avant tout une femme qui fait un métier qu’elle a choisi, c’est vrai que c’est un métier où l’on exprime des choses mais je trouve important qu’on ne s’attribue pas cette espèce de « en tant que ». Est-ce que ça veut dire que quelqu’un d’autre, en tant qu’agriculteur, en tant que… aurait moins de légitimité ? C’est comme si les artistes, les écrivains, les penseurs avaient un rapport autre au politique. Aujourd’hui en Russie, des metteurs en scène – des metteuses en scène surtout – sont en prison, mais il y a aussi en prison une femme qui ne vient pas d’un milieu artistique. Elle n’a pas supporté les images de la guerre en Ukraine et s’est mise à remplacer les étiquettes des prix, dans un supermarché, par des étiquettes sur lesquelles était écrit « non à la guerre ». Cette femme était dans une unité pénitentiaire (elle vient d’en être libérée dans le cadre des échanges de prisonniers) . Elle y est en tant que femme. Evguénia Berkovitch (metteuse en scène) qui est emprisonnée aujourd’hui, l’est aussi en tant que femme. Une des forces les plus précieuses c’est quand un être se lève pour la cause d’un autre.
Quand je vois la poussée du Front National, j’ai honte, mais je n’ai pas honte de ses électeurs. Je sentais venir cela depuis longtemps et je pense que nous vivons une forme de rupture avec le rapport à la mémoire, à la transmission, à ce qu’on peut nous apprendre et qui nous aide à imaginer le futur. Les fils sont rompus. C’est pour cela que « en tant qu’artiste » ne me convient pas, cela reviendrait à dire « écoutez cette musique comme c’est beau, ça ne vous donne pas envie d’être gentils, ou sensibles ? ». Le problème est ailleurs, comme si une sorte de vide sidéral – ou un trop-plein, je ne sais pas – s’était installé et que naissait de cela quelque chose que je n’arrive pas à nommer, où le fait d’essayer de convaincre quelqu’un n’a plus aucun sens. Cela s’est terriblement aggravé depuis l’arrivée de Trump au pouvoir aux Etats-Unis. Ses idées populistes existaient déjà, mais on sent la jouissance d’une posture qui affirme une absence absolue de doutes, de questions, ou même d’écoute. Et cela nous laisse sans moyens.
Dans les récentes élections en France, il y a quand même eu un vent de réveil. Cela veut dire aussi qu’on joue avec le feu, qu’il y a un côté jouer avec le feu, voir jusqu’où on peut aller… Je me demande si cette montée du vote d’extrême droite un peu partout en Europe ne traduit pas le besoin de s’abandonner à un guide autoritaire qui va décider pour vous. Je pense à le « servitude volontaire » de La Boétie. Le travail que cela représente de rester un être libre de ses choix, pour chacun de nous. Ajoutons à cela un plaisir que j’ai bien des fois remarqué, à parler de Jordan Bardella, sa grande stature, son côté sexy… Beaucoup de jeunes, sur les réseaux sociaux, sont fascinés par ce gars qui a à peine 30 ans et qui porte beau. Dans le fascisme, il y a toujours une vision esthétique, qui crée la fascination pour celui qui va vous mener à la baguette.
Est-ce que la musique, ou plus largement la création artistique peuvent contribuer à débrancher ce fil ?
Peut-être. Bien sûr, les artistes peuvent s’exprimer politiquement et c’est très important.J’ai participé à des concerts contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie par exemple. Cependant, on fait comme si l’art ou la musique pouvait donner une sorte de guide de « comment penser bien », mais pas du tout ! Il faut essayer de penser autrement que de sa place à soi. Je pense qu’on doit essayer de se décaler, de s’éloigner de notre point de vue, parce qu’on reste le plus souvent dans ce qui est une zone de confort, que l’on connaît. Peut-être qu’on commence à comprendre des choses à partir du moment où on prend conscience qu’on est en-dehors du jeu, et que l’on s’interroge sur les façons d’y remédier. Arianne Mouchkine parlait de faire silence, c’est une idée très forte. C’est important de savoir se taire parfois. Se demander comment cela est arrivé, et comment inventer autre chose que ce qu’on nous a toujours appris pour que se recrée un lien, avec les moyens que l’on a, que ce soit la musique ou tout autre chose.
Mais ce dont je suis sûre, c’est que lors d’un concert, si ne serait-ce qu’une seule personne dans le public expérimente un voyage dans lui-même dans un endroit inconnu qu’il découvre ou redécouvre, un ailleurs connu, inconnu ou reconnu ; alors c’est une victoire. Est-ce qu’une pensée, un lever de soleil, un son de violoncelle peut un jour récréer ce lien? Peut-être, et c’est ce que je voudrais croire.
Recueilli par Agnès Martial