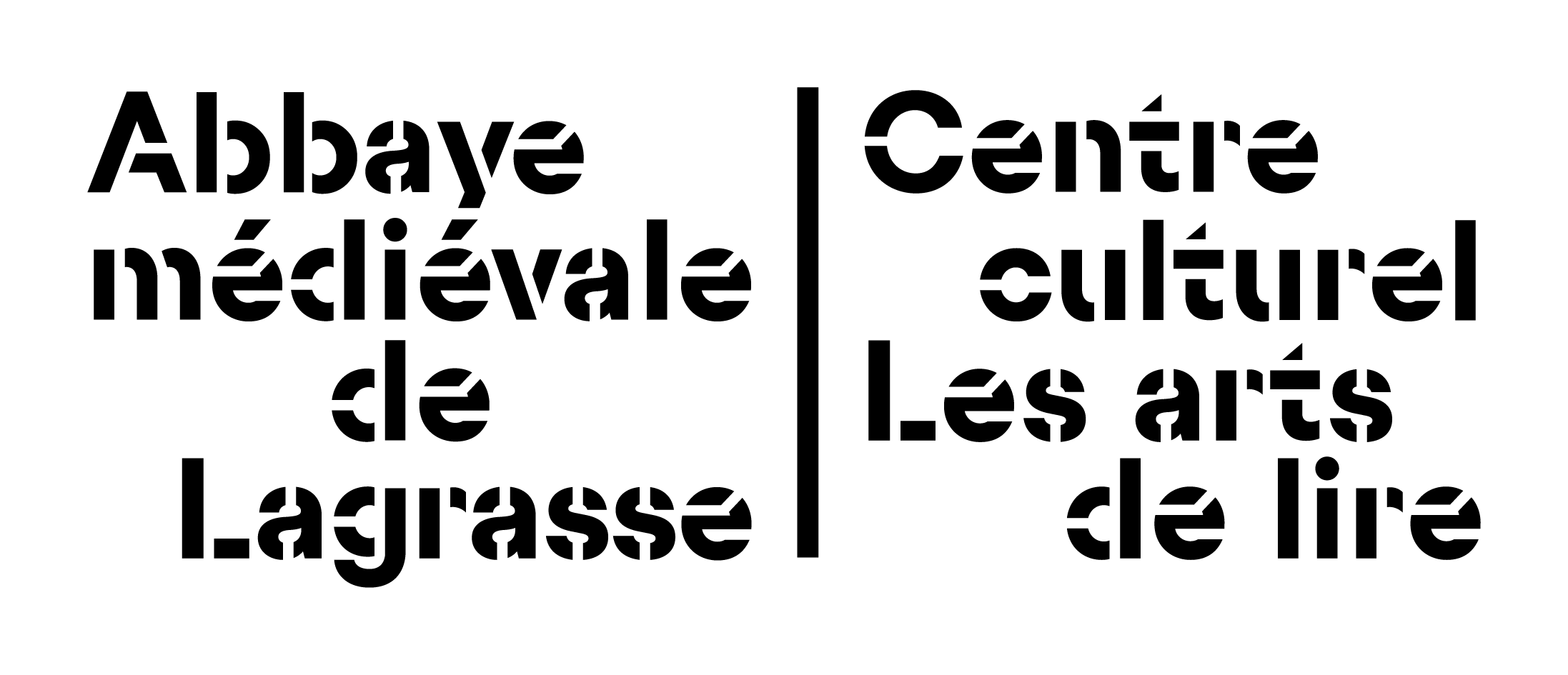Alors voilà : à peine « la » génération est-elle portée sur les eaux lustrales de la Révolution, qu’elle se dévore elle-même. Il nous faut entendre ce qu’Albert Thibaudet (1874-1936), édité par Christophe Pradeau et Antoine Compagnon, nous dit, il y a presque un siècle, en 1930, rebondissant d’une physiologie l’autre. Ce n’est plus la « physiologie » des gamètes ou des gonades, mais bien celle des plumes et de leur réception. Un bon siècle après son entrée brutale, parfois sanglante, dans l’histoire des représentations, « la » génération s’éprouve au lendemain d’une boucherie intégrale et volontaire. Celle même qui est censée ouvrir le « vingtième siècle ».
En 1920, paraissait chez Brossard, à Paris, le livre curieux d’un philosophe, François Mentré, élève puis enseignant à l’École (privée), post-Le Playsienne « des Roches », tout autant disciple d’Alfred Espinas (auteur, vraiment oublié, en 1878, Des Sociétés animales, études de psychologie comparée) que fidèle d’Émile Durkheim, décédé au moment de la parution de cette thèse, soutenue en 1916 en plein cœur du premier conflit mondial.
Son titre – Les générations sociales – entendait dépasser la question téléologique et familiale des « générations », pour en faire un étalon sociologique, hélas au service d’une vision nationaliste et xénophobe de la société. Pour le domaine français, ce livre, jamais réédité depuis un siècle, a suscité débats et critiques tout en générant, c’est le cas de le dire, un motif décisif de division et du temps, et de l’espace social, selon des générations « d’identification » collective. Thibaudet, alors qu’il compose une Histoire de la littérature française (de 1789 à « nos jours ») scandée en cinq à six « générations littéraires », bientôt « intellectuelles », lui donne la réplique. Et éprouve le motif.
Yann Potin

Albert Thibaudet, Physiologie de la critique, Ed. de la Nouvelle revue Critique, 1930, p. 201-202
Rien de plus commun dans le langage courant de la critique que ce mot et cette idée de génération. Et non seulement de la critique professionnelle, mais de la critique spontanée. Pas d’année où l’on ne fasse dans quelque journal l’enquête de vacances sur la « génération nouvelle ». Un ministre dit : Le pays… Un parlementaire dit : Mon groupe… Un jeune écrivain dit : Ma génération… Et cela répond évidemment à une réalité. Il y a des traits communs entre les esprits d’une même génération. Une génération réagit d’ordinaire contre la génération précédente, — critique si l’autre est organique, organique si l’autre est critique. Mais ce n’est vrai qu’en gros, et de façon assez conventionnelle. Rien de plus difficile à définir qu’une génération. On s’en rendra compte en lisant de façon critique le livre de M. Mentré sur les Générations sociales. Une génération ne commence pas et ne finit pas à un point précis. Elle appartient à un continu. Penser le continu c’est le morceler par des divisions qui existent en nous, pour notre commodité, et non en lui. Les générations littéraires sont obtenues par des abstractions de la critique, dont le métier est de construire des réalités idéales, pensantes, maniables. Mais la critique se livrerait à un vain jeu si ces abstractions n’étaient pas, dans une certaine mesure, fondées sur la réalité. Le continu et le discontinu ne se contredisent pas tout à fait. Je ne puis jamais trouver un point précis qui soit à la limite de la pluie et du beau temps. Mais je sais bien que tandis qu’il pleut à Lyon il fait beau à Avignon. La continuité et l’imbrication de générations qui croissent et décroissent à chaque instant de la durée n’empêche pas que la façon de penser du Second Empire diffère probablement, et par certains traits généraux, exprimables, réels aussi, de la façon de penser de 1900. Ces différences, tranchées d’un demi-siècle à un autre, impliquent des différences insensibles d’une année à l’autre, délicates et difficiles à saisir : on voit qu’un enfant a grandi, mais on ne le voit pas grandir. La critique, la psychologie peuvent tout de même essayer de voir grandir une génération. Un temps très court, comme le temps qui s’est écoulé depuis l’armistice, nous permet déjà de tracer des courbes et d’enregistrer une évolution.
Faire le tableau vivant d’une génération française, isoler en artiste cette génération dans le flot continu du temps, voilà une des belles et fructueuses ambitions de la critique professionnelle. Il ne semble pas que la critique classique, même après la querelle des Anciens et des Modernes, ait sérieusement utilisé cette idée de génération. La première génération qui se soit sentie violemment distincte d’une autre, qui ait pris conscience d’elle-même en tant que génération, c’est la génération romantique de 1830. Les pages initiales de la Confession d’un Enfant du Siècle donnent vraiment une note non encore entendue. La critique de Sainte-Beuve a été fécondée par l’idée de génération, qui lui a servi à faire dans le XVIIe et le XVIIIe siècle des coupes admirables. Surtout elle commande Port-Royal.
Qu’est-ce en effet que Port-Royal, chef-d’œuvre et massif central de la critique française, sinon le tableau de la génération classique, génération chrétienne, que Sainte-Beuve groupe idéalement autour de ce qui fut ou de ce qu’il juge avoir été la réaction chrétienne propre de la France après la Réforme ? Port-Royal demeure le type même de la construction critique, une construction qui est amorcée dans la réalité, mais qui n’y est pas donnée et que le génie à la fois artiste et savant du critique en fait sortir. Contre le tour tout sensuel et impressionniste de Montaigne, la génération de Pascal avait restauré les exigences de construction et d’institution. Avec le livre de Sainte-Beuve, c’est l’esprit même de Montaigne qui s’incorpore à cette construction. Le chapitre sur Montaigne n’y figure pas inutilement. L’Entretien avec M. de Saci et Port-Royal emploient également Montaigne à une construction, ici à une construction critique, là-bas à une construction morale.
M. Seillière, dans une série d’ouvrages déjà longue, a utilisé de façon intéressante cette idée de génération, en étudiant les traits propres de ce qu’il appelle les cinq générations rousseauistes, sans qu’il lui soit encore possible sans doute, de dire si la nôtre constitue la première génération anti-rousseauiste. Les Essais de psychologie contemporaine de M. Bourget nous offrent un excellent exemple d’une critique construite autour de l’idée de génération. M. Bourget s’est efforcé d’y donner un inventaire de ce que sa génération, en abordant la vie, avait trouvé dans l’héritage de ses aînés immédiats. Ces Essais ont marqué une date importante en critique. Ils nous ont laissé l’habitude de ces inventaires par lesquels on donne acte de leur influence aux auteurs d’une génération et on leur signifie en même temps que cette influence est finie. Construction utile, mais artificielle. J’ai commencé moi-même un travail de ce genre ; j’ai pu sentir combien mes divisions s’appliquaient mal sur une continuité, combien la vie multiforme d’une génération échappe aux figures auxquelles on est tenté de la limiter, aux formules dans lesquelles il faut bien, tant bien que mal, la fixer.