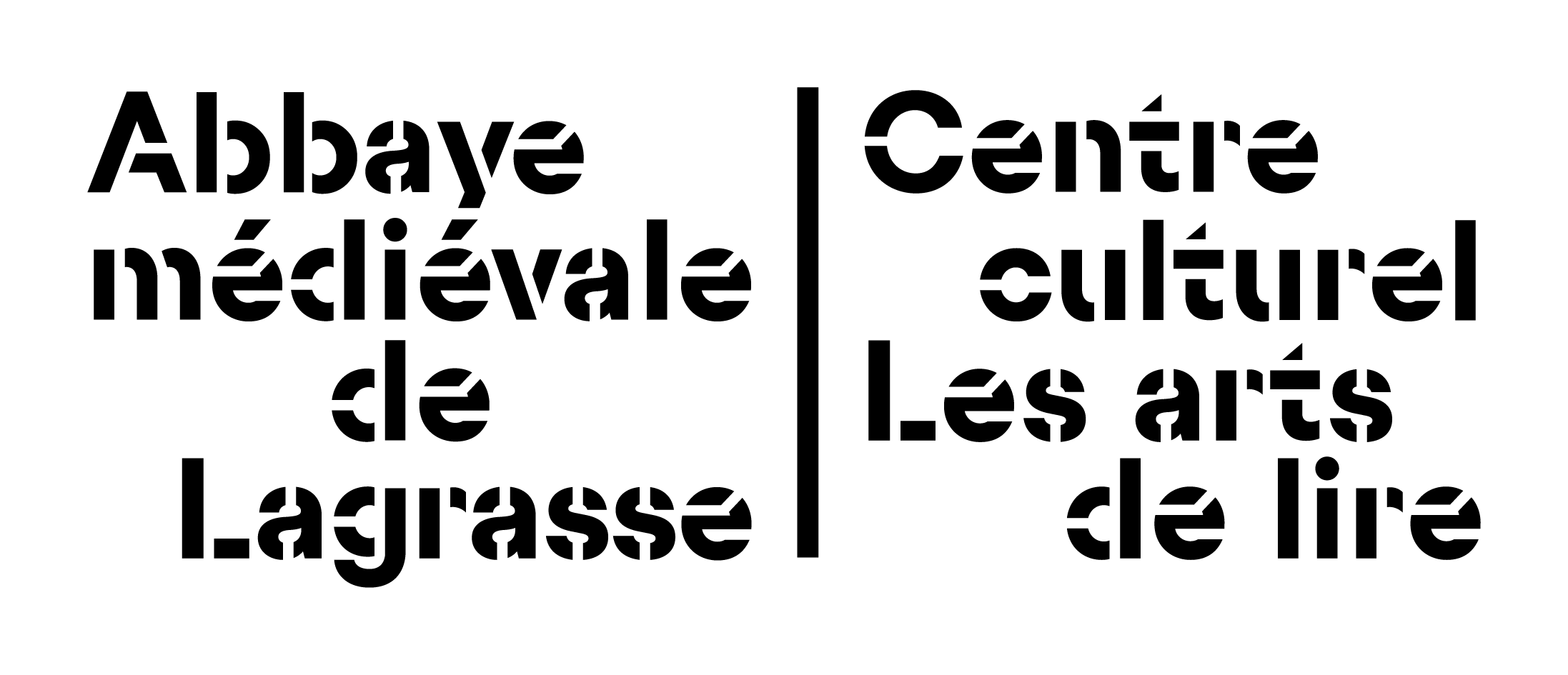Depuis 1925, le Centre international de synthèse, piloté par le philosophe Henri Berr, et émanation, depuis 1900, d’une revue éponyme – la Revue de Synthèse – entend briser les murs entre l’analyse et la spéculation, au profit d’un rêve, encore encyclopédique. Le contexte transnational pas tout à fait encore manqué, de la Société des Nations, et de « l’Institut de Coopération intellectuelle » qui lui est associée, donne un programme : établir un « Vocabulaire historique » international des notions qui pourraient (re)construire la paix, sinon le monde. En tout cas l’histoire, à refonder, sur un monde en ruines.
Lucien Febvre (1878-1956) prépare la mise en œuvre d’une révolution méthodologique des sciences sociales, par l’histoire, avec l’aide d’un brillant collègue, plus jeune que lui, Marc Bloch (1886-1944), sous la forme d’une revue, Annales d’histoire et économique et sociale. Sur ce chemin, alors qu’il publie Un destin. Martin Luther, Febvre dresse un réquisitoire sans appel pour que la génération ne soit pas une catégorie historique opératoire. Par ce texte, resté discrétionnaire, ne vaudrait-il pas mieux « s’en passer », de la génération ? A suivre…
Yann Potin

« Générations », par Lucien Febvre.
Communication au Centre international de synthèse du 11 mars 1928, publié en 1929, à l’issue de la discussion donnée ci-après.
Le problème des générations, en histoire, n’est qu’un des aspects particuliers du problème, beaucoup plus vaste, des divisions. Problème d’ensemble et naturellement susceptible de recevoir des solutions très diverses : il semble cependant, en fait, que ces solutions puissent être réparties toutes sous deux rubriques générales.
Pour ceux qui, s’attachant avant tout aux actes, considèrent l’histoire comme une trame d’événements, le problème est de savoir si cette trame, qui paraît continue, n’est pas en réalité faite d’une série de pièces mises bout à bout, mais distinctes, et qu’il y a profit à considérer comme telles. Grandes pièces, et ce sont les fameuses périodes traditionnelles : Antiquité, Moyen Age, Temps modernes ; petites pièces à l’intérieur des grandes, et ce sont les siècles et les règnes. Chacune, aux deux extrémités, est limitée par des événements promus à une dignité particulière et considérés comme inaugurant ou terminant de véritables phases distinctes et, dans une certaine mesure, autonomes, de l’évolution humaine. S’il est vrai qu’il y a dans l’Histoire du contingent, du nécessaire et du logique, on voit que ce système (et c’est là sa faiblesse) est basé tout entier sur le contingent.
Pour ceux au contraire qui, dans l’Histoire, s’attachent aux acteurs beaucoup plus qu’aux actes et, frappés par ce qu’il y a d’insuffisant, de puéril, de scolaire si l’on veut, dans le découpage des périodes, essaient de réagir et de serrer la réalité vivante de plus près – ce qui est frappant, ce n’est pas la succession des événements mais l’écoulement continu des hommes, le fleuve d’Héraclite au cours sans fin et qui ne s’arrête jamais. Par conséquent, le problème est pour eux, non pas d’encadrer entre des événements dits « marquants » des tranches de faits, mais dans la masse perpétuellement mouvante des êtres humains, d’appréhender des successions de groupes remplissant le même office que les successions de périodes.
Or, que ses inventeurs en aient eu, ou non, la pleine conscience, la théorie des générations n’a été qu’un moyen de substituer aux divisions par les actes des divisions par les acteurs ; aux coupures taillées dans la trame des faits des coupures opérées dans la masse des hommes.
Il est curieux qu’à l’origine les promoteurs de cette théorie n’aient point paru sentir l’hétérogénéité des deux conceptions en présence : l’ancienne, celle des périodes ; la nouvelle, celle des générations. Leur première idée fut, au contraire, de les combiner toutes deux et de subordonner la seconde à la première. Ainsi Cournot. L’auteur des Considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes (I, VIII) installe dans la carapace vide de chaque « siècle », pour la remplir en quelque sorte et la vivifier, la succession régulière de trois générations de trente ans : celle des grands-pères, celle des pères, celle des fils. Après quoi, dans le cadre pareillement hospitalier du siècle suivant, il installe une deuxième série de générations, composée exactement de la même façon.
L’idée en elle-même n’a rien de nouveau. Le mot non plus, naturellement. Son origine est sans mystère. Il habille à la française, depuis le XIIIe siècle au moins, le latin generatio. Celles de ses significations qui nous intéressent ici sont les suivantes :
1° Génération est d’abord synonyme, ou à peu près, de reproduction. On peut dire et on dit à peu près indifféremment : le phénomène de la génération ou le phénomène de la reproduction ;
2° Il signifie ensuite, d’une manière vague, la race, la descendance, le produit de la génération entendue au sens précédent ;
3° Plus précisément, il désigne un degré de filiation en ligne directe. Il y a une génération du père au fils, et deux du père au petit-fils ;
4° Ce concept de degré n’implique en lui-même aucune notion de durée fixe. Un homme né en 1800 peut être grand-père en 1835 ; le même peut être père en 1850, et grand-père (s’il vit centenaire) en 1900. Mais de très bonne heure, il fut admis qu’à chaque degré de filiation correspondait une durée moyenne de trente ans, – ou encore, qu’il y a trois générations par siècle, comme Hérodote le soutient déjà ;
5° La notion d’une certaine durée étant ainsi liée à celle de génération, il est tout naturel que ce dernier mot ait fini par désigner l’ensemble des hommes vivant à la même époque, ce concept d’époque étant d’ailleurs fort imprécis.
Or, reprenons l’idée de Cournot. Elle ne se peut défendre : il est inutile de le démontrer longuement. Il s’agit pour le philosophe de galvaniser, ou plutôt d’animer la notion formelle de siècle. Il remplit donc chaque siècle de trois générations, chacune faisant un peu plus de trente ans. Le grand-père « fleurit » de 1500 à 1530. Il a donc, au temps où se sont formées ses premières impressions, subi le contre-coup direct de la découverte de l’Amérique. Son fils, le père, celui qui fleurit de 1530 à 1560, a recueilli des lèvres paternelles toute une tradition à ce sujet. Et le petit- fils, qui fleurit de 1560 à 1590, a lui aussi puisé dans les discours de son père et de son grand-père les éléments de souvenirs non livresques sur ce fait supposé d’importance capitale. Après quoi, c’est fini. Mais un nouveau cycle commence avec les trois générations du XVIIe siècle qui vont succéder à celles du XVIe siècle.
Est-il utile de faire observer tout ce qu’a de factice, et à vrai dire d’enfantin, une pareille conception ? Ne discutons même pas l’intérêt ou la portée du fait choisi comme dominant : ici, la découverte de l’Amérique. La génération qui fleurit de 1500 à 1530 est sans doute intéressante : pas plus, j’imagine, que celles qui fleurirent de 1485 à 1525, ou de 1515 à 1545 ? D’autre part, liée étroitement à celle qui la prolonge, et celle-ci à son tour à celle qui la remplace, une génération ne l’est pas moins à celle qui la précède. En d’autres termes, les trois générations 1, 2 et 3 qui couvrent les cent années du XVIe siècle, sont solidaires, soit ! Mais les générations 2, 3 et 4 ; les générations 3, 4 et 5 ; ajoutons (qu’on nous pardonne ces fantaisies arithmétiques !) les générations 1, 5; 2, 5 ; 3, 5 le sont exactement de la même solidarité. Tout ceci, en acceptant d’ailleurs ce postulat préalable : que si les trois générations 1, 2 et 3 constituent un bloc, chacune d’elles, prise à part, en fait un également.
Vouloir loger les générations dans les siècles, à raison de trois par siècle, c’est une chimère et une absurdité. Une erreur de fait et, non moins, une erreur de principe et de méthode : car c’est mêler arbitrairement des conceptions disparates. Mais est-il impossible d’utiliser, toute seule et rationnellement, la seconde de ces deux conceptions ? Et sans plus s’occuper des périodes, des siècles, règnes ou autres divisions « événementielles », n’y a-t-il pas moyen de fonder sur la notion de génération une division « humaine » de l’histoire ?
L’idée a beaucoup séduit. Les générations, sortant les unes des autres, par engendrement continu, chacune prolongeant celle qui la précède et préparant celle qui la suit, les prendre pour bases de l’étude du passé, n’est-ce pas conserver à ce passé le caractère essentiel de la vie, qui est d’évoluer et de se renouveler sans cesse ?
N’est-ce pas résoudre en le supprimant l’absurde et irritant problème des dates-limite, et substituer à des abstractions inopérantes et artificielles, comme les périodes, une réalité humaine et vivante ? Telle fut, notamment, l’idée d’Ottokar Lorenz qui, se réclamant (non sans quelque abus) de Ranke, proposait de substituer à l’étude des périodes celle des générations auxquelles il continuait d’attribuer la traditionnelle durée moyenne de trente ans.
Tout ceci ne saurait résister à un examen un peu approfondi. D’abord, à moins de verser dans de chimériques absurdités, il est impossible de fonder l’étude de l’histoire universelle sur la notion de générations se subordonnant à la fois et s’opposant les unes aux autres. Car nous croyons à peu près savoir ce que nous disons quand nous opposons les deux générations de 1660, celle de Pascal si l’on veut et celle de Fontenelle ; mais quel sens l’historien de l’antiquité qui opposera les unes aux autres les trois générations romaines du Ve siècle avant Jésus-Christ ? Ou même l’historien du Moyen Age qui fondera quoi que ce soit sur les caractéristiques particulières des générations de l’an Mille, de 1030 et de 1060 ?
Par ailleurs, les grandes périodes, telles qu’on les définit communément ou, plus exactement, telles qu’elles résultent de siècles et de siècles d’élaboration historique, ont la prétention d’être valables pour un certain nombre de pays compris dans la même aire de civilisation. En gros, si l’on veut, le Moyen Age français ressemble au Moyen Age anglais et au Moyen Age allemand par certains traits, certains aspects dominants. Mais de la génération française de 1200 à 1230 dira-t-on la même chose (même si cette chose est fort grosse) que de la génération milanaise, brugeoise, barcelonaise, londonienne ou colonaise de la même époque ! Et du reste, génération française ? Ce qui s’appliquera, tant bien que mal, aux Parisiens vaudra-t-il pour les Toulousains ou les Lyonnais du même temps ?
Ces remarques n’atteignent d’ailleurs pas le fond du problème. La plus grave objection qui puisse être faite à toute tentative de reconstruction de l’Histoire sur la base des générations est décisive : c’est qu’il est impossible de donner de la génération une définition qui laisse subsister des illusions sur la valeur d’un semblable concept.

Pascal ne « dirige » rien, au sens où on l’entend, ni La Bruyère, ni Fontenelle.
Reprenons l’exemple que nous citions plus haut. C’est un lieu commun, d’opposer à la génération de 1660 à celle de 1690. Et, il semble facile, ici, de marquer des contrastes, dans de multiples domaines. Mais qu’on y regarde de plus près. Les remarques qu’on se plait à accumuler à ce propos, ce sont des remarques d’ordre intellectuel. Ce qu’on oppose avant tout (et ce qu’on a raison d’opposer) ce sont des œuvres littéraires, des états d’esprit, ou de conscience. Mais de ces œuvres, quel était le rayonnement ? De ces états d’esprit, quels sont les participants ? Est-il correct, est-il simplement possible de transporter dans le monde des paysans, j’imagine, ou des petits bourgeois de provinces périphériques des distinctions qui valent pour un nombre restreint d’hommes cultivés, au cœur de la France royale ? Ces hommes, dira-t-on, sont les dirigeants. Voilà une conception bien aristocratique de l’histoire. Mais d’ailleurs, l’erreur est manifeste, ou l’illusion. Pascal ne « dirige » rien, au sens où on l’entend, ni La Bruyère, ni Fontenelle. Et qu’entre les générations politiques de 1660 et de 1690, il y ait eu les mêmes contrastes, et pour les mêmes raisons, qu’entre les générations littéraires de 1660 et de 1690, rien ne nous le garantit.
Certes, on peut faire entrer en ligne de compte, on peut exalter le rôle et l’importance de l’éducation et de l’instruction sur la mentalité des générations successives. On peut noter que, souvent, les oppositions s’expliquent par un changement de système ou de programme d’enseignement. Ceci n’est pas faux. Ceci est à observer. Mais à la condition, d’abord, de ne pas oublier que les programmes et les systèmes d’enseignement sont loin de donner la traduction directe et l’image fidèle des tendances de leur époque En général, ils n’en fournissent qu’une image tardive, parfois même une image posthume. Ensuite, que les programmes et systèmes en question n’intéressent généralement qu’une minorité, ce qui nous ramène à l’idée qu’à une époque et dans un pays donné se distinguent autant de générations distinctes qu’il y a de classes ou de catégories sociales diverses. Notion qui est bien loin d’être sans valeur, naturellement, et que l’historien doit toujours retenir. Mais elle ne saurait fournir la base d’un système de divisions de l’Histoire, même à ceux, surtout à ceux dirais-je, qui ne perdant jamais de vue ce principe directeur que l’Histoire est une science de l’homme, s’inscrivent en faux contre le découpage de cette histoire en périodes événementielles, et sont le plus disposés à admettre qu’une science de l’homme doit partir de l’homme, non du hasard, pour établir solidement et fonder en raison son système de divisions particuliers.
Si pour échapper à de telles difficultés on en vient à compliquer les choses, à substituer à la notion simpliste de la génération trentenaire, la notion, beaucoup plus complexe, d’un groupe d’hommes ayant subi, dans des conditions à peu près comparable d’âge, de nationalité, de culture intellectuelle et de situation sociale l’empreinte des mêmes évènements, ces évènements étant eux-mêmes choisis non plus dans un seul, mais dans tous les domaines de l’activité humaine : le politique, mais aussi l’intellectuel, le moral, le religieux, l’économique ; si, par conséquent, on se propose d’étudier sous le nom de génération une moyenne d’influences s’exerçant sur une moyenne d’individus : on se donnera beaucoup de mal sans doute pour éviter quelques-uns des reproches qu’on peut faire à la théorie des influences ; mais alors, à quoi bon maintenir la notion inutile, la notion parasite de génération ?
Mieux vaut la laisser tomber, purement et simplement, pour en revenir à une autre notion qui, ici même, à diverses reprises, se trouve déjà visée.
Il y a, dans l’histoire des sociétés humaines, certains moments où l’on croit saisir dans les consciences, avec une particulière netteté, les effets concordants de tout un vaste travail simultané. Il y a, au contraire, entre ces époques, des époques d’indécision, de tournoiement pour ainsi dire et de dégradation. Partir de ces états si saisissants d’équilibre momentané, de stabilité temporaire, où il semble que, pour un court instant, toutes choses s’harmonisent et s’entraident ; chercher, en avant, ce qui les a précédé et préparé, en arrière ce qui va les dissocier et les ruiner : voilà une recherche qui n’a rien d’arbitraire, qui s’applique également bien à toutes les histoires de toutes les époques et de tous les peuples dans la mesure où nous les connaissons et qui nous fournit un moyen (le seul) de définir du dedans, en partant de l’homme, mais sans s’encombrer de notions aussi confuses et mal définies que celle de génération, ces périodes de l’histoire qu’une science de l’homme ne saurait chercher, et trouver, que dans l’homme même.

Lucien Febvre publie Un destin. Martin Luther en 1928, un an avant de fonder la revue Les annales avec Marc Bloch.
Discussion
M. Berr fait remarquer que la communication de M. Febvre rejoint l’étude du mot Crise qui doit faire l’objet d’un exposé de M. Léon Cahen.
M. Léon Cahen est d’accord avec M. Berr sur ce point. Par ailleurs, il conviendrait de dire que la forme de comput par générations est extrêmement ancienne : on la trouve déjà dans la Bible. Il faudrait aussi ajouter que le laps de temps représenté par une génération a varié selon les époques ; aujourd’hui, après avoir diminué, il a tendance à grandir ; il répond à la notion de la moyenne de la vie humaine.
Il serait intéressant de rapprocher l’idée de génération du développement du calcul des assurances. Les compagnies d’assurances recourent à des statistiques concernant l’âge moyen des hommes, et à des tables de mortalité. Or toutes les statistiques relatives à la population de Paris au XVIIIe siècle sont fausses. On les a faites en ajoutant tant de milliers d’hommes tous les trente-cinq ou quarante ans à une évaluation datant de Richelieu (1636). Ces statistiques reposent donc sur l’idée d’un accroissement moyen par génération.
M. Febvre croit qu’il serait utile d’entendre un exposé sur la notion juridique de génération.
Au point de vue historique, le mot n’a aucun sens. La durée des générations varie suivant les époques, les pays, les classes. Il y a en histoire des crises – la guerre, par exemple – qui détruisent l’équilibre démographique ancien pour en établir un nouveau.
On constate de plus en plus l’influence fâcheuse de la philosophie, qui fait peser, sur certaines études, des mots ne répondant pas à la complexité des faits. Ainsi les divisions de l’histoire en périodes sont de simples procédés d’exposition doctrinale. On est obligé d’y recourir, mais il conviendra de dire que ces divisions ne répondent pas à des faits précis. L’utilité du vocabulaire qu’élabore la section est précisément de montrer tout ce que ces termes ont de vague.
M. Van Tieghem croit qu’il serait bon d’indiquer que les guerres ou d’autres crises peuvent unifier certains groupes d’hommes. Ainsi on emploie l’expression de générations d’après-guerre.
Il faudrait mettre en garde contre le sens impropre donné au mot génération ; ce mot devrait se référer à un laps de temps de dix ans au moins.
M. Berr rappelle que le mot génération, correctement employé, s’applique, dans le temps, à une période d’environ trente ans.
On pourrait, en rattachant génération à crise, dire que, lorsque des hommes entrent dans la vie, s’il ne survient aucun événement propre à déterminer une crise nouvelle, il y a des chances pour qu’il existe entre eux une certaine analogie pendant cette période trentenaire.
M. Febvre dit que les points de départ en question doivent être bien choisis.
Il est d’accord avec M. Van Tieghem pour ajouter à son article un paragraphe mettant en garde contre le sens imprécis donné fréquemment à génération. Les articles des dictionnaires relatifs à ces mots sont d’ailleurs eux-mêmes imprécis.