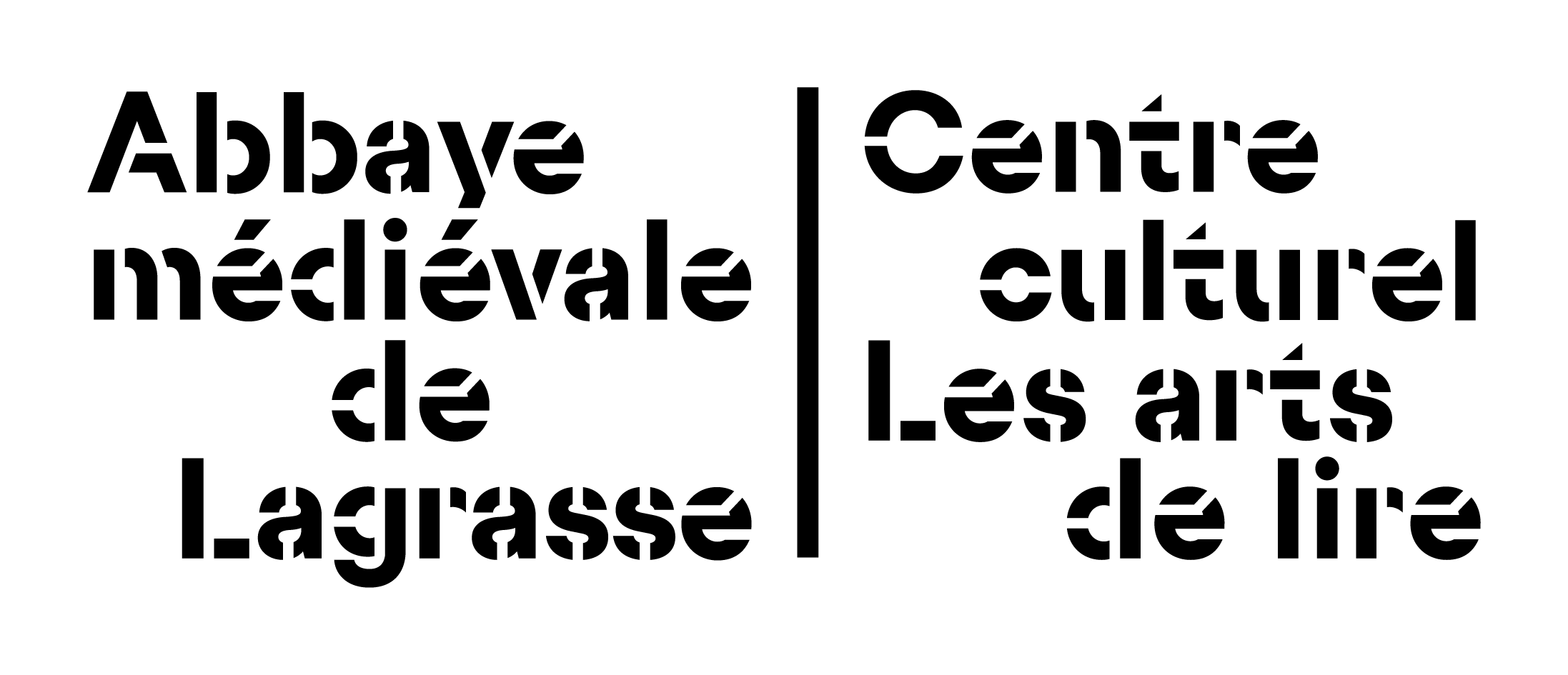Sarah Leduc (photo Idriss Bigou-Gilles) signe l’exposition photographique Ailleurs, ici, sur les résidents du Centre d’accueil de demandeurs d’asiles (Cada) de Lagrasse présentée dans l’arrière salle du bistrot de l’abbaye. Après douze ans de journalisme à cadence forcée dans une chaîne d’information en continu, elle se tourne aujourd’hui vers une autre manière de lire et de dire le monde. En se donnant « le luxe du temps » et en plaçant désormais la photographie au cœur de son travail, elle veut toucher plus à l’intime de ces anonymes qui, aussi, font l’histoire. En témoigne l’exposition Ailleurs, ici qu’elle présente jusqu’au 29 août dans l’arrière salle du bistrot de l’abbaye. Entretien.
Qu’est-ce qui, dans votre démarche professionnelle, vous a amené à faire le choix de la photographie ?
J’ai été pendant plus de douze ans reporter multimédia à France 24 où j’ai toujours associé l’écriture et la photo. Ce sont des outils différents mais qui permettent tous deux de construire une narration et de dire une interprétation du monde. J’ai réalisé des documentaires multimédia, notamment sur une communauté malienne en Bretagne ou sur les violences sexuelles au Congo, et la narration passait autant par les images que par le texte. Puis, il y a un peu plus de deux ans, je suis partie vivre en Espagne, pays dont je ne parlais pas la langue. Face aux limites du langage écrit et parlé, j’ai décidé d’explorer plus profondément le langage visuel. Je me suis formée à la photographie et j’ai commencé à réfléchir à des projets personnels centrés sur l’image.
« Aller vers les autres sans a priori »
En quoi vos études d’ethnologie ont-elles contribué à façonner votre itinéraire personnel ?
Ce qui m’a plu dans l’ethnologie, c’est le terrain. J’ai donc fait le lien assez naturellement avec le journalisme. L’ethnologie a façonné mon regard. Elle a nourri ma curiosité et mon envie de raconter « d’autres vies que la mienne ». Elle m’a aussi appris à aller vers les autres humblement, sans a priori. On a rompu aujourd’hui avec une vision très européenne et ethnocentrée du monde. Dans l’ethnologie comme dans le journalisme, on a déconstruit la hiérarchie entre celui qui observe et celui qui est observé. C’est dans l’échange que se conçoit une narration, de même que la photo se construit dans la relation à l’autre. Cela vous oblige à prendre conscience de votre propre place. Jusqu’à quel point je me raconte quand je raconte l’histoire des autres…
Comment est né le projet de photographies au Centre d’accueil de demandeurs d’asile (Cada) de Lagrasse que vous exposez pendant ce Banquet du livre ?
En tant que journaliste, je me suis beaucoup intéressée aux questions migratoires. Je me suis rendue dans les pays de départ comme le Niger, dans les pays de transit, en Grèce, dans les camps de Lesbos ou de Calais… J’avais envie de raconter la suite de l’histoire, la suite du périple des migrants en France. Mais, pour la première fois, je me suis accordée le luxe du temps alors que j’étais habituée à travailler dans l’urgence. Ce travail s’inscrit dans une démarche documentaire plus que de reportage : j’ai pu sortir de l’immédiateté et proposer une lecture personnelle de la réalité du Cada. J’ai utilisé les outils du langage photographique – la lumière, la couleur, le cadrage… – pour donner une interprétation du réel et retranscrire des émotions, des sensations, un rapport sensible au monde. La photo m’a permis d’aller là où les mots ne vont pas.
Mais pourquoi Lagrasse ?
Lagrasse est un lieu auquel je suis intimement attachée. J’y viens depuis que je suis née et j’y ai passé toutes mes vacances. Et parfois, les histoires sont sous votre nez mais vous ne les voyez pas ! Quand j’étais petite, je jouais avec les enfants du Cada, les Boats People à l’époque. Maintenant, ce sont mes filles qui jouent avec les jeunes résidents, elles les invitent à la maison et s’invitent chez eux. J’ai vu avec quelle facilité les enfants se lient les uns aux autres sans se poser de question. Mes filles se moquent de savoir si ces enfants-là sont demandeurs d’asile, migrants ou réfugiés. Ce sont juste des enfants qui se rencontrent dans leur humanité en toute simplicité, et leur envie d’être avec les autres.
« L’étrangère, c’était moi ! »
Et c’est donc une enfant, amie de vos filles, qui vous a amenée chez elle, au Clos d’Orbieu…
En effet. Mariam, une petite Malienne dont le portrait se trouve dans l’exposition, passait du temps à la maison et elle m’a amenée chez elle. Je n’étais alors ni journaliste, ni photographe mais la mère de mes filles. Cela a tout de suite créé un lien de confiance et une proximité. Quand j’ai commencé ce travail en août 2022, il y avait au Cada de Lagrasse beaucoup de femmes isolées avec leurs enfants. Le fait d’être une femme et une mère m’a permis de partager plus facilement leur quotidien. Pour les autres familles, il a fallu frapper aux portes et leur demander de partager leur intimité. C’est intrusif. Pour le coup, l’étrangère, c’était moi ! Quand j’ai vu que certaines étaient mal à l’aise face à l’appareil photo, j’ai rapidement renoncé à l’idée d’être exhaustive. Il ne s’agissait pas de cartographier les treize familles occupant les appartements du Cada ni de documenter par le menu leur manière de vivre. Plutôt de retranscrire de manière sensible l’ambiance de ce lieu et ce qui traverse intérieurement ses habitants.

Pouvez-vous préciser votre idée ?
Dès le début, je me suis interdite de demander à ces personnes la raison de leur présence : pourquoi ils avaient fui leur pays, pourquoi ils étaient là. Soit ce récit viendrait de lui-même, soit il ne viendrait pas. D’abord, je ne voulais pas être associée à la série d’interrogatoires qu’ils subissent déjà dans le processus de demande d’asile. Par ailleurs, je ne cherchais pas à faire une narration de trajectoires individuelles. J’ai travaillé sur l’ici et le maintenant, ce qui est au cœur même de la démarche photographique. Et pour les gens du Cada, l’ici et le maintenant, c’est un temps suspendu, un moment de rupture dans leur parcours migratoire. Ils sont partis de chez eux, ils repartiront plus tard, mais en attendant, ils sont ici, à Lagrasse. C’est à la fois un moment de soulagement. Ils n’ont plus besoin de chercher un toit et ils se sentent protégés. Mais c’est aussi un moment d’angoisse et d’attente. Ils ne contrôlent pas leur destinée, ne savent pas s’ils vont pouvoir rester en France ni où ils vont aller après. J’ai essayé de traduire en images comment l’attente s’immisce dans les lieux comme dans les personnes. Je me suis demandé : que fait-on pendant un temps où il ne se passe rien ? Que ressent-on ? J’ai essayé de travailler sur ce rien.
« Sortir les résidents de leur invisibilité »
Est-ce que cette approche du réel constitue un tournant dans votre parcours ?
Quand on fait de « l’actu » comme cela a été mon cas pendant longtemps, on demeure dans une transcription brute du réel. On essaie de se tenir le plus en retrait possible et de ne pas intervenir sur la réalité dont on rend compte. Pour la première fois, j’ai essayé de mettre un peu plus de moi dans mon travail et me suis autorisée à livrer mon interprétation, ma vision de la réalité vécue par des réfugiés dans un centre d’accueil. Oui, ce travail m’amène peut-être vers autre chose que ce que j’ai connu avec le journalisme de reportage. Peut-être…
Quel sens le choix de l’exposer a-t-il donné à ce travail ?
Je voulais exposer ce travail à Lagrasse pour « sortir » les résidents du Cada. Les donner à voir dans toute leur humanité et simplicité, dans leur beauté aussi, sans tomber dans l’écueil de la victimisation ni de l’héroïsation. Plus symboliquement, ce travail avait l’ambition de sortir toutes ces personnes de l’invisibilité, de mettre des histoires, des visages derrière des statistiques, des politiques, des gros titres. Je voulais aussi probablement déconstruire quelques mauvais mythes. Quand on voit les réactions suscitées par l’ouverture d’un Cada à Saint-Brévin-les-Pins, c’est plus nécessaire que jamais. Donner la parole à ceux qu’on n’entend pas, montrer ceux que l’on ne voit pas , c’est rappeler que l’Histoire se joue aussi dans les marges. Si ce travail est un tournant dans ma démarche, il s’inscrit en revanche dans une continuité, mon profond intérêt pour ceux qui jouent anonymement un rôle dans la construction du monde.
Recueilli par Serge Bonnery