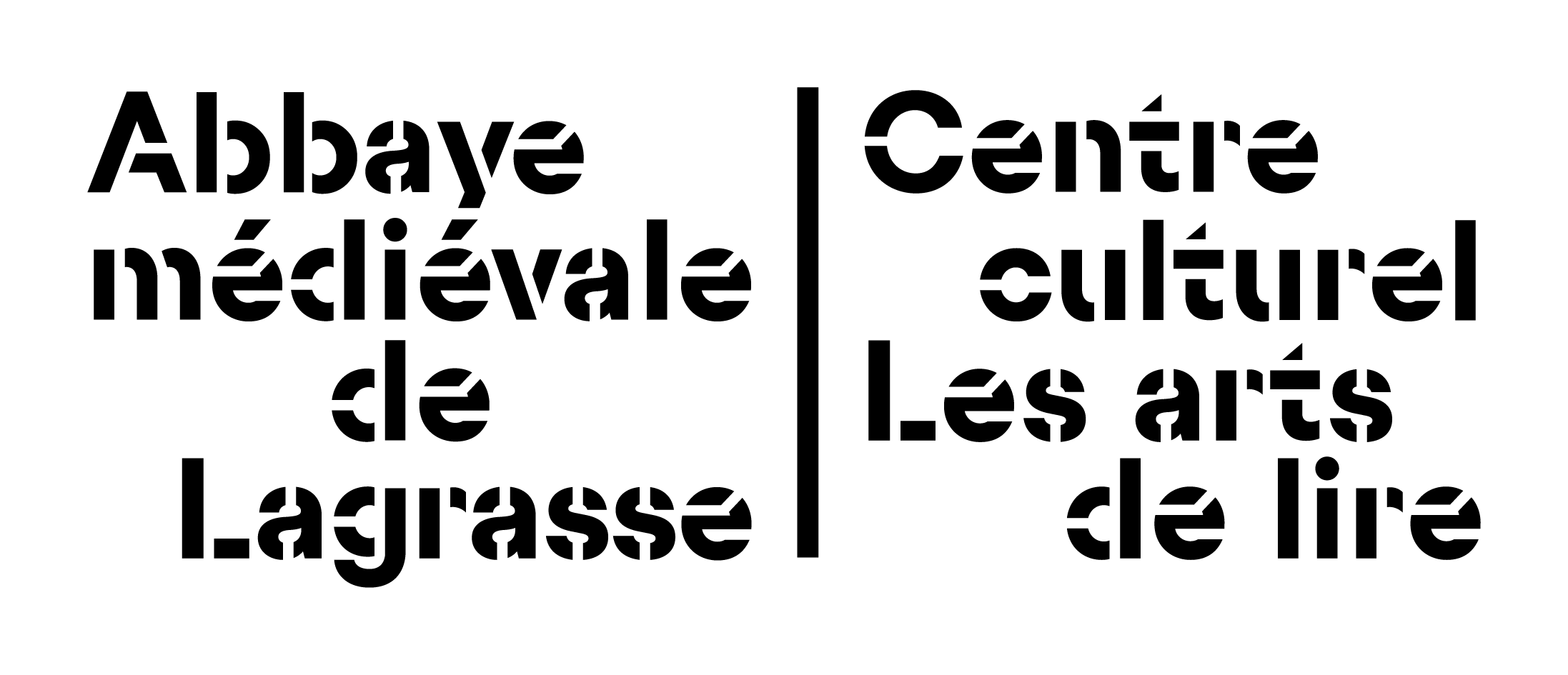Archéologue, Jean-Paul Demoule est professeur émérite de protohistoire européenne à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne et membre honoraire de l’Institut universitaire de France. Ses travaux portent sur la néolithisation de l’Europe ainsi que sur les sociétés de l’âge du fer. Mais il mène aussi une réflexion approfondie sur la place de l’archéologie dans la société contemporaine. Cette préoccupation l’a conduit à participer à l’élaboration de la loi française sur l’archéologie préventive et à la création de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), dont il a été le président de 2001 à 2008. Il explique ici pourquoi les crises actuelles trouvent leur origine dans le grand tournant que fut le néolithique.
L’expression « révolution néolithique » est communément admise dans la communauté scientifique. En quoi cette période est-elle si révolutionnaire ?
Le Néolithique est le changement le plus radical de l’histoire humaine. En dix mille ans, on passe de trois millions d’individus à huit milliards aujourd’hui. Les sociétés qui ont fait le choix de l’agriculture ont explosé démographiquement. Leur mode de vie s’est répandu sur toute la planète et les derniers chasseurs-cueilleurs ont été progressivement éliminés. C’est une révolution lente qui a pris des millénaires avec certainement des retours en arrière mais cela reste une rupture radicale. Quand Claude Lévi-Strauss disait « il y a deux révolutions dans l’histoire humaine, la révolution néolithique et la révolution industrielle » auxquelles on pourrait rajouter aujourd’hui la révolution numérique, ces deux dernières ne sont que les conséquences de la première. Sans la révolution néolithique, elles n’auraient vraisemblablement pas eu lieu.
Qu’est-ce que l’invention de l’agriculture change fondamentalement dans le comportement humain ?
Excepté le cas particulier des pasteurs nomades, l’agriculture entraîne la sédentarité. Elle permet de disposer d’une nourriture plus sécurisée et, par là même, elle fait exploser la démographie. Les chasseuses-cueilleuses ont en moyenne un enfant tous les trois ou quatre ans alors que les agricultrices des sociétés traditionnelles en ont pratiquement un tous les ans. Gagnant en nombre, ces sociétés doivent aussi gagner en espace et pour ce faire, elles éliminent leurs rivales. La violence entre mâles humains est attestée chez les chasseurs-cueilleurs. Mais avec les sociétés territorialisées, les conflits augmentent de manière significative. En même temps, apparaissent les premières différences sociales telles qu’on peut les observer dans les sépultures où les ornements attestent du statut social du défunt. Le Néolithique, c’est aussi le début des atteintes à l’environnement. L’agriculture apparaît à la fin de la dernière glaciation, il y a environ dix ou douze mille ans. A ce moment-là, le monde est couvert de forêts qu’il va falloir défricher. Les grandes déforestations commencent. Enfin, les maladies : elles existent certes depuis longtemps mais en concentrant en un même endroit humains et animaux, les épidémies se développent plus facilement.
« Les sociétés trop oppressives finissent par éclater »
Le Néolithique, dites-vous, est « un miroir grossissant de l’état de notre société »…
Incontestablement, les problèmes actuels de nos sociétés liés à la violence, aux inégalités, à la faim dans le monde et aux épidémies trouvent leurs racines dans les premières sociétés du Néolithique.
Vous rappelez, comme un avertissement, que toutes les grandes civilisations urbaines se sont effondrées. Quelles sont les causes de ces effondrements ?
On cite souvent une phrase de Paul Valéry : « Nous, les civilisations, nous savons que nous sommes mortelles ». J’ai envie de dire « heureusement » car si tel n’était pas le cas, nous vivrions toujours au Néolithique ou sous l’Empire romain. Il advient un moment où une société se transforme. Ces transformations peuvent être radicales comme lorsque les Européens envahissent les Amériques ou l’Afrique en détruisant les civilisations de l’extérieur. Mais souvent, on a affaire à des effondrements de l’intérieur pour lesquels il y a rarement une cause unique. Les causes principales résident dans une mauvaise gestion de l’environnement et, d’autre part, dans les troubles sociaux générés par les inégalités sociales. Il y a alors un effet domino qui provoque l’effondrement. Confrontés à des problèmes de sècheresse et de fluctuations climatiques, les Mayas construisent des pyramides de plus en plus grandes pour se concilier les dieux. Pour ce faire, ils expulsent les paysans des terres les plus fertiles, ce qui accroît les problèmes d’agriculture et d’alimentation. A la même époque – autour de l’an mille de notre ère – et à l’autre bout du monde, les Khmers, avec des constructions et des installations surdimensionnées donc fragiles, doivent faire face aux difficultés, ils voient la crédibilité de leurs élites s’effondrer et des ennemis extérieurs profitent de la situation. De même, les sociétés trop oppressives finissent par éclater.

« La destruction généralisée de notre civilisation – qu’il ne faut pas souhaiter – n’entraînerait pas la disparition de l’humanité. »
Sommes-nous menacés à notre tour ?
Nous gérons mal notre environnement. Nous vivons dans des sociétés très inégalitaires puisque les vingt personnes les plus riches du monde possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l’humanité. La différence majeure est que désormais, nos problèmes se posent à l’échelle planétaire alors qu’aux époques lointaines, ils étaient circonscrits à une société dans un espace donné. Ceci dit, l’effondrement ne signifie pas que les humains disparaissent. Au Mexique, plusieurs millions de personnes parlent encore des langues mayas. Lorsque vers – 1 200, les civilisations minoenne ou mycénienne disparaissent, les archéologues parlent d’âges sombres – the dark ages – parce qu’il n’y a pas grand chose à fouiller, mais c’est du fond de ces âges que surgira le miracle grec. La destruction généralisée de notre civilisation – qu’il ne faut pas souhaiter – n’entraînerait pas la disparition de l’humanité.
Vous montrez dans votre livre Homo Migrans que la migration est consubstantielle à l’histoire de l’humanité. Pourquoi ?
Au commencement, les humains sont nomades par nécessité. Ils se déplacent en fonction des ressources saisonnières à l’intérieur d’un territoire donné. La sédentarité des populations préhistoriques n’est attestée que là où les ressources sont disponibles toute l’année. Avec la révolution néolithique, tout change. Désormais, il va falloir disposer de toujours plus d’espace pour nourrir des populations sédentarisées grandissantes, ce qui provoque de nouvelles formes de nomadisme. Le phénomène va aller en s’accentuant avec l’émergence des sociétés étatiques, guerrières et esclavagistes qui sont elles aussi génératrices de migrations.
Il est devenu courant aujourd’hui de parler d’Anthropocène pour désigner cette nouvelle ère où l’influence de l’activité humaine sur l’environnement est devenue significative en termes de dégradation et de destruction. Certains de vos collègues vont plus loin en parlant, eux, de « Capitalocène » pour désigner le système économique dominant comme principal responsable du désastre écologique. A votre avis ?
Le terme Anthropocène a été créé dans les années 1990. Certains le font débuter aux premières explosions atomiques, d’autres dès la révolution industrielle ou encore à partir des grandes découvertes, lorsque les Européens prennent le contrôle du monde. Je fais partie de ceux qui datent son commencement du Néolithique, quand l’action des humains sur la planète se fait de plus en plus prégnante. Au début, c’est un phénomène peu sensible mais qui va progressivement s’accélérer. On observe aujourd’hui dans les glaces du pôle les effets de pollutions atmosphériques survenues dès l’âge du bronze, il y a quatre mille ans. Toutefois, nommer notre époque « Capitalocène » ne me paraît pas complètement exact dans la mesure où les ex-pays dits socialistes, qui étaient aussi inégalitaires, développaient le même type d’économie productiviste que les pays capitalistes. On a aussi parlé de « Plantationocène » pour désigner les grandes plantations esclavagistes et l’agriculture intensive comme facteurs des dégradations climatiques. Personnellement, le terme d’Anthropocène me convient. Il désigne un phénomène historique indéniable, désormais repérable dans les strates successives de sédiments que l’on étudie comme c’est le cas au Canada où le lac Crawford est devenu un site référence en la matière.
« L’INRAP, un tournant essentiel pour l’archéologie »
Le succès populaire des grands sites préhistoriques – Lascaux, Chauvet, Cosquer etc. – atteste d’un engouement pour la Préhistoire de la part d’un public de plus en plus large. Comment l’expliquez-vous ?
J’ai pu l’observer, et toute la génération de l’après-guerre avec moi, dans la pratique de mon métier. Dans les années 1950-1960, on détruisait les sites archéologiques avec indifférence sinon bonne humeur. Tout le premier réseau autoroutier de France a été construit sans la moindre fouille préventive alors qu’on sait maintenant que sous telle portion nouvelle d’autoroute, peut surgir à chaque kilomètre un site archéologique important. Pendant les trente glorieuses, tout allait bien : on allait éradiquer les maladies, on marchait sur la Lune, il y avait le Concorde, la fusée Ariane, les premiers TGV… Les gens baignaient dans l’idée de progrès. C’est seulement à partir des années 1970-1980, lorsque nos sociétés sont entrées en crise, que l’on a pris conscience qu’il n’était plus possible de faire comme avant. Dès lors que je me pose la question de savoir où je vais, il est légitime de me demander d’où je viens. Alors qu’on les ignorait il y a une trentaine d’années, le Néolithique, l’Anthropocène sont devenus de vrais sujets de débats. L’expression « faire l’archéologie de… » est aujourd’hui très répandue pour dire que l’on fait l’histoire de… Peu à peu les choses avancent. J’ai été président de l’Institut national des recherches archéologiques préventives (INRAP). Au début, nous nous heurtions à l’hostilité d’un certain nombre de décideurs. Nous avons alors compris qu’il était nécessaire d’expliquer à quoi sert l’archéologie. Beaucoup a été fait par les archéologues eux-mêmes en termes de pédagogie, avec des expositions, des opérations portes-ouvertes et les journées européennes de l’archéologie qui réunissent chaque année au mois de juin quelque 200 000 personnes sur les chantiers ouverts au public. Tout ce travail répondait à une vraie attente des publics sur la question : « Où allons-nous ? », « Va-t-on ou non dans le mur ? ».

Vous avez contribué à l’élaboration de la loi sur l’archéologie préventive et à la création de l’INRAP dont vous avez été président entre 2001 et 2008. En quoi ces outils sont-ils décisifs pour les études préhistoriques ?
C’est sans conteste un tournant essentiel pour l’archéologie. Il a été possible grâce à l’action très volontariste des archéologues de ma génération qui ne supportaient pas de voir tout disparaître. L’intérêt grandissant du public pour nos recherches a aussi joué en notre faveur. Pendant très longtemps, nous avons dû lutter contre les élites françaises pour qui nos racines, notre histoire, c’était l’Orient, la Grèce et Rome. C’est ce que montre encore le musée du Louvre. Si vous allez à Berlin, à Budapest ou à Londres, vous verrez dans les grands musées nationaux toute l’histoire du sol de ces pays. Dès le XVIIIe siècle, la Suède possède une carte de ses sites archéologiques. Pour découvrir l’archéologie de la France, il faut se rendre à la périphérie de Paris, au musée de Saint-Germain en Laye qui n’a jamais vraiment eu les moyens de fonctionner. Il y avait donc beaucoup de retard à rattraper. Songez qu’il a fallu attendre 1941 pour que soit votée, en France, une loi imposant l’autorisation de fouilles. Auparavant, chacun pouvait faire ce qu’il voulait, c’est-à-dire à peu près n’importe quoi. L’école française d’Athènes a été fondée en 1846 et l’INRAP… quelque cent cinquante ans plus tard. Tout n’est pas encore parfait. Malgré la loi sur les fouilles préventives, on artificialise chaque année en France 500 km2 de terres, soit un département tous les dix ans et seulement un quart de ces surfaces sont surveillées d’un point de vue archéologique. On a aussi introduit la concurrence en archéologie avec des entreprises qui effectuent des fouilles à des tarifs peu élevés, ce qui n’arrange pas les choses. Pour autant, la situation actuelle n’a rien à voir avec ce que j’ai connu quand je suis arrivé sur le marché du travail il y a cinquante ans.
La préhistoire est-elle une science pour l’avenir ?
Toute espèce biologique a une histoire. La préhistoire nous éclaire parce qu’elle permet d’aborder les questions ayant trait au fonctionnement des sociétés humaines. Nous observons, par les études préhistoriques, comment des groupes humains parviennent à faire société. Si je me suis intéressé, par exemple, à l’histoire des migrations, c’est pour montrer que les humains ont toujours migré et qu’il n’y a rien de vraiment nouveau aujourd’hui. Même si les migrations peuvent prendre des formes différentes selon les époques, on retrouve toujours des constantes autour de ces mouvements de populations : la démographie, les violences, l’étranger comme bouc-émissaire, le mélange des sociétés humaines… Longtemps, les migrations sont demeurées circonscrites à une partie limitée du globe terrestre. L’Empire romain, c’était cinq millions de km2, l’empire mongol 33 millions. Aujourd’hui, tout se passe à l’échelle planétaire. L’Homme doit se débrouiller dans les limites de cet espace – le globe terrestre – à l’intérieur duquel il vit enfermé. On n’ira pas beaucoup plus loin avant longtemps. C’est bien là le problème !
recueilli par Serge Bonnery
-o-
Repères bibliographiques
Jean-Paul Demoule a récemment publié :

- Homo Migrans, de la Sortie d’Afrique au Grand Confinement. Payot, 2022.
- La préhistoire en 100 questions. Tallandier, 2021.
- Aux origines de l’archéologie : une science au cœur des grands débats de notre temps. La Découverte, 2020.
- Les dix millénaires oubliés qui ont fait l’histoire : quand on inventa l’agriculture, la guerre et les chefs. Fayard, 2017.
- On a retrouvé l’histoire de France : comment l’archéologie raconte notre passé. Robert Laffont, 2012.
-o-
A lire demain : La palynologie : rencontre avec Anne-Sophie Lartigot-Campin, dans son laboratoire du Centre européen de recherches préhistoriques de Tautavel.