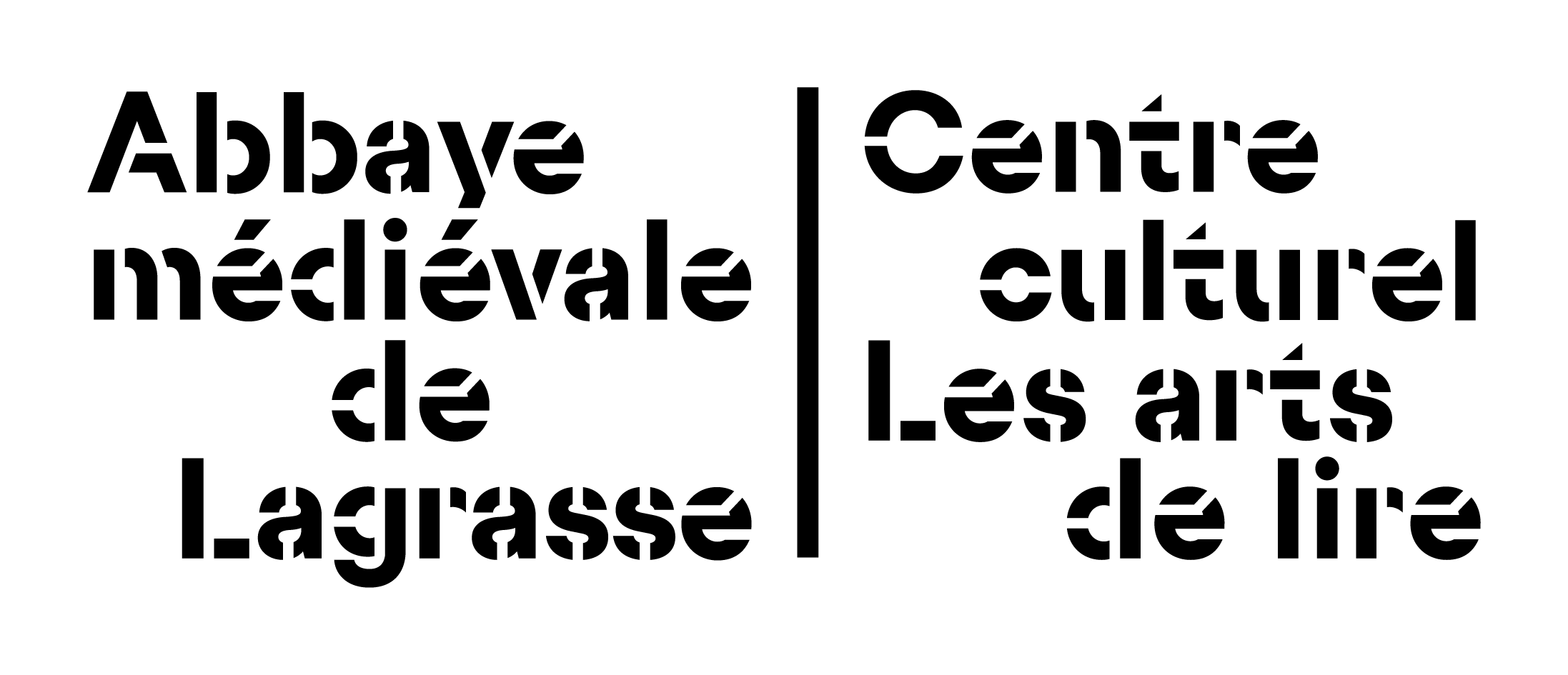Dont acte, en cheminant avec Lucien Febvre. En France, la génération ne sera pas, au cours du XXe siècle, une notion historique recevable. Au moins jusqu’à ce que « la » génération, celle du livre éponyme d’Hervé Hamon et Patrick Rotman, la réinvestisse au service de l’histoire politique, culturelle et intellectuelle… du XXe siècle, justement, au travers des travaux de Michel Winock et Jean-François Sirinelli en particulier. Albert Thibaudet est alors un sauf-conduit pour recomposer le temps des générations – mais avec la, ou les, littératures en guise de justification.
En parallèle, la sociologie, dans la droite ligne de l’héritage philosophique qui la fonde, s’est emparé à de multiples reprises de ce criterium des âges. Il est assurément une manière de conjurer les spectres de la « classe sociale », sans doute, dans l’ombre ou la lumière du marxisme. Karl Mannheim (1893-1947), disciple de Georg Simmel avant d’être tuteur du jeune Norbert Elias, en stricte contemporanéité avec Febvre, au revers du lendemain de deux générations sacrifiées de part et d’autre du Rhin, propose de faire de la génération une des manières de faire « unité » et lien social, mais non exclusif.
Cinquante ans plus tard, dans un entretien sur la « jeunesse », Pierre Bourdieu dit la trace fantôme et la conjuration partielle de cette insistance sociologique à faire vivre, malgré tout, la génération.
Yann Potin

Karl Mannheim : « Le phénomène de génération est un des facteurs fondamentaux de la réalisation de la dynamique historique. »
Extrait de Karl Mannheim, « Das Problem der Generationen », Kelner Vierteljahreshefte fur Soziologie, VII, 1928, p. 157-185, p. 309-33 [rédigé en 1926], trad. Fr., Gérard Mauger et Urania Perivolaropoulos, Le problème sociologique des générations, Paris, Nathan, 1990.
Si on veut se représenter le phénomène de l’ensemble générationnel [generationzusammenhang] à partir de ses structures fondamentales, alors il faut expliquer l’être-ensemble spécifique des individus réunis dans l’unité de génération.
En premier lieu, l’unité d’une génération n’est pas un lien social qui tend à la constitution de groupes concrets, même s’il peut arriver occasionnellement que l’unité de génération devienne le fondement conscient et unificateur de la formation de groupes concrets (par exemple, le Mouvement de Jeunesse de l’époque contemporaine). Si tel est le cas, alors il s’agit la plupart du temps de ligues qui ne sont spécifiques que dans la mesure où ce n’est pas en premier lieu un quelconque contenu objectif, mais précisément l’ensemble générationnel devenu conscient de lui-même qui devient le fondement de la formation concrète de groupes.
Mis à part ce cas particulier, où là l’ensemble générationnel peut devenir le principe de la formation concrète de groupes, on peut d’abord opposer l’ensemble générationnel en tant que simple ensemble aux formations concrètes de groupes.
Les associations à but déterminé, la famille, la parenté, les communautés d’opinion, etc., sont des exemples de formations concrètes de groupes. Toutes ces formes concrètes de groupes peuvent être caractérisées par le fait que les individus qui les composent forment aussi in concreto un groupe, c’est-à-dire que cette unité de groupe est essentiellement fondée sur les liens vitaux, existentiels, préexistants de la « proximité », ou constituée sur la base de « la libre volonté ». Au premier type correspondent toutes les formes de communautés [Gemeinschaft] (famille, parenté, etc.), au second, les « formes de sociétés » [Gesellschaft].
L’ensemble générationnel en soi ne peut pas être caractérisé comme un groupe concret au sens de la communauté, où la connaissance mutuelle in concreto est une condition préalable et dont la désagrégation spirituelle se produit dès que cesse la proximité physique. Mais l’ensemble générationnel n’est pas non plus comparable à des formations sociales – comme des associations à but déterminé – dont les caractéristiques sont la création volontaire, la possibilité d’institutionnalisation, la révocabilité, qui tiennent lieu de proximité physique et de lien naturel.
Nous parlons donc de « groupes concrets » quand des liens, soit naturellement développés, soit volontairement créés, unissent les individus ; ainsi l’ensemble générationnel est-il un être-ensemble d’individus, que quelque chose relie entre eux ; mais ce lien ne produit d’emblée aucun groupe concret. Pourtant l’ensemble générationnel est un phénomène social dont la spécificité doit être décrite et comprise.
Pour éclairer cette notion d’ensemble générationnel, peut-être trouverait-on une aide dans le recours à une catégorie sociale tout à fait différente. On pense au phénomène de la situation de classe, certes radicalement différent de l’ensemble générationnel quant à son contenu, mais qui présente une ressemblance quant à certaines données structurelles de base. Par situation de classe on pourrait entendre, dans le sens le plus large du terme, une situation analogue d’individus déterminés dans la structure économique et la structure de pouvoir d’une société donnée, situation qui contient en germe leur destin. On est prolétaire, entrepreneur, rentier, etc., et on l’est parce qu’on éprouve constamment (comme contrainte ou comme possibilité) la pesanteur d’une situation particulière dans la structure sociale. Cette situation dans l’espace social n’est pas révocable par un acte intellectuel et volontaire comme l’est l’appartenance à une association. Mais, on n’est pas pour autant attaché de ce fait de toutes les fibres de son être à un groupe concret au même sens vital et fatal que dans la communauté.
On ne peut quitter cette situation que du fait d’une ascension ou d’un déclin social, individuel ou collectif ; que la cause du changement soit le mérite ou l’effort personnel, la conjoncture sociale ou même le simple hasard est ici secondaire résiliation. L’appartenance à une « association » s’éteint par résiliation de la relation ; les liens communautaires cessent lorsque se dissolvent en nous ou chez d’autres les liens spirituels entre les membres du groupe, la situation de classe antérieure perd sa pertinence pour nous, dans la mesure où nous modifions par ce changement notre position économique et notre pouvoir.
On relève d’une situation de classe ; qu’on le sache ou non, qu’on s’avoue ou qu’on se dissimule cette appartenance, est ici secondaire.
Une situation de classe n’implique pas systématiquement une conscience de classe, même si cette dernière peut, sous certaines conditions, en surgir ; la conscience de classe peut conférer un caractère particulier à la simple situation de classe et donner lieu au phénomène de « la classe se constituant ». Dans la forme que nous venons d’analyser, seul nous intéresse pour notre raisonnement le phénomène de la situation dans l’espace social. Aux unités de groupes concrètes s’oppose le phénomène de la situation analogue des hommes dans l’espace social – un moment de l’analyse où situation de classe et ensemble générationnel sont analogues.
Notre premier pas dans l’analyse consiste donc à opposer le phénomène de la situation à la formation de « groupes concrets » ; et il devrait être clair que l’ensemble générationnel repose sur une situation analogue dans l’espace social des individus relevant d’une même génération.
[…]

Si l’historien de la littérature a d’abord tendance à ne pas voir le fait que la plupart des gens ne se situent qu’à l’intérieur d’un courant précis d’une époque, et ensuite à ne pas voir que l’« esprit du temps » [c’est-à-dire, l’enchaînement continuel dynamique des « ensembles » générationnels successifs] se présente toujours éclaté et ne devient pas subitement exclusivement romantique, puis de nouveau exclusivement rationaliste, cela tient au fait que sa réflexion s’exerce d’abord sur les destins d’hommes de lettres, c’est-à-dire sur le destin d’une couche sociale tout à fait spécifique.
Seul le milieu des hommes de lettres, qui dans notre société est relativement sans attaches (ce qui est évidemment aussi une caractéristique sociologique), a la possibilité d’osciller, de se rattacher, tantôt à l’un, tantôt à l’autre courant. Pendant la première moitié du XIXe siècle, il s’est toujours rattaché dans une large mesure au courant, dont la nouvelle génération, aidée par les circonstances, est devenue justement spirituellement offensive, c’est-à-dire là où, à chaque fois, la formation d’une entéléchie de génération était possible. L’époque de la Restauration et les faiblesses sociales et politiques de la bourgeoisie allemande au début du XIXe siècle favorisèrent d’abord la formation d’entéléchie au pôle romantique-conservateur de la jeunesse, qui attira une grande partie du milieu socialement sans attaches des hommes de lettres. À partir des années trente, la révolution de Juillet et l’essor de l’industrialisation favorisèrent l’offensive de nouvelles entéléchies libérales-rationalistes au sein de la génération qui en était le support : une grande partie des hommes de lettres rejoint maintenant le camp libéral-rationaliste.
Si on suit cette évolution, en ayant surtout à l’esprit ce milieu des hommes de lettres, on a alors l’impression qu’il y a un « esprit du temps », d’abord exclusivement romantique, puis exclusivement rationaliste, et, en outre, que ces hommes de lettres, poètes et penseurs, le déterminent. En fait, les volontés décisives, déterminantes pour l’orientation, ne sont absolument pas enracinées en eux, mais dans les agents sociaux bien plus massifs, qui se trouvent derrière eux, constamment présents dans leur polarisation. Ce mouvement ondulatoire dans l’« esprit du temps », provoqué par la progression des courants singuliers procède uniquement de ce que, selon les circonstances, c’est tantôt un pôle, tantôt l’autre, qui est capable de promouvoir une génération qui devient active, et qui, par la suite, entraîne avec elle les « couches moyennes » et, plus particulièrement, ce monde des hommes de lettres sans attaches. Ce n’est pas nier ici l’importance formidable de ce milieu des hommes de lettres (à laquelle appartiennent souvent les penseurs et les poètes les plus puissants), puisqu’ils approfondissent réellement et donnent forme à toutes ces entéléchies qui émanent ainsi de l’espace social. Si on se réfère exclusivement à eux, on ne peut pas appréhender de façon tout à fait satisfaisante justement cette structure de courant des mouvements spirituels. Si on considère le courant historico-social dans son ensemble, alors il n’y a pas d’époques exclusivement romantiques ou exclusivement rationalistes, cette polarité étant clairement présente au moins depuis le XIXe siècle ; mais on peut dire que c’est tantôt l’une, tantôt l’autre direction, qui prend le dessus, qui devient dominante. Ce qui du point de vue sociologique ne signifie – en d’autres termes – rien de plus que ceci : la formation d’une entéléchie de génération favorisée par les circonstances est possible tantôt à un pôle, tantôt à l’autre, ce qui attire constamment les couches moyennes hésitantes, et en premier lieu le milieu contemporain des hommes de lettres. Ce qui montre bien que l’homme solidement enraciné socialement (quel que soit son « type psychique ») a surtout à faire avec le courant dominant dans son milieu, tandis que l’homme de lettres sans attaches (quel que soit son « type psychique ») a surtout à faire avec le courant dominant contemporain. Quelle sera l’issue de cette lutte pour l’individu singulier entre dispositions individuelles, attitude spirituelle socialement adéquate et courant devenu dominant à l’époque considérée ? Elle varie sûrement selon les individus : seule une personnalité forte est en mesure de persévérer dans les dispositions de son caractère contre une attitude spirituelle polarisée de son propre milieu (tout particulièrement si elle est en essor). Un « bourgeois » d’inclination irrationaliste était aussi difficilement en mesure d’être « lui-même » pendant les années quarante du XIXe siècle, qu’il devait être difficile pour un noble appartenant à la nouvelle génération et d’inclination rationaliste, de préserver son mode de vie contre le nouvel essor du romantisme et de la religiosité. Dans de tels cas, les plus protégés contre l’offensive de la nouvelle entéléchie de génération sont ceux qui, du fait de leur situation de génération plus ancienne, ne peuvent pas ou ne veulent pas vivre dans la nouvelle entéléchie de génération en essor dans leur milieu social. Ainsi Frédéric-Guillaume III et ses partisans, qui ont généralement grandi dans l’orthodoxie rationaliste, c’est-à-dire dans la forme la plus ancienne du conservatisme, purent échapper à la nouvelle vague romantique-piétiste religieuse. Par contre, son fils, le prince héritier, devenu plus tard Frédéric-Guillaume IV, était un archétype très marqué de ce courant. Il en résulte, envisagé sous un autre angle, qu’il n’est pas possible de constater l’effet du facteur de génération directement, sans médiation, mais seulement dans l’élément du devenir socio-historique.
La situation de génération est toujours présente comme potentialité, elle tend toujours à se réaliser, non pas dans l’élément de l’esprit du temps, mais au contraire dans les courants concrets qui y sont à chaque fois présents. [On peut également l’observer dans le Mouvement de la Jeunesse moderne qui se polarise à chaque fois socialement et politiquement. Il est, en tant qu’apparition cohérente, une preuve du phénomène de la « cohésion de génération ». Mais on ne peut l’appréhender concrètement sous la forme d’« unités de génération » qui se différencient entre elles socialement et intellectuellement]. Cette tendance à la formation d’entéléchies correspondant à des générations au sein de ces courants parvient-elle à se réaliser et à quel pôle ? Cela dépend comme nous l’avons vu des destins historiques.
À ces facteurs, qui compliquent suffisamment la problématique des générations en soi et pour soi, s’ajoute encore un facteur qui ne s’est pas imposé jusqu’ici dans nos réflexions.
On n’a, en effet, pas encore pris en considération le fait que l’entéléchie de génération qui vient de faire irruption n’a pas la même possibilité de le faire dans tous les domaines, dans toutes les sphères spirituelles. Chaque sphère isolée peut favoriser ou inhiber l’irruption de l’entéléchie de génération. On peut très certainement parler ici d’une hiérarchie des sphères en fonction de leur pertinence pour l’entéléchie de génération.
Ainsi peut-on montrer clairement que les sciences exactes, pour lesquelles l’importance de la vision du monde est bien moindre, dissimulent dans une large mesure les entéléchies de génération.
De façon générale, la « sphère de la civilisation » [Alfred Weber, « Prinzipielles zur Kultursoziologie », 1920], du fait de sa structure de développement linéaire, dissimule beaucoup plus que la sphère de la culture les changements dus à la volonté et à l’expérience. De ce point de vue, Pinder a certainement raison, quand il attribue aux disciplines langagières (religion, philosophie, poésie, science) un autre rôle que celui des arts plastiques et de la musique [Pinder, Das problem der Generation in der Kunstgeschichte, Berlin, 1926].
Il va falloir, là aussi, distinguer de plus près et se demander dans quelle mesure les différentes impulsions de courants et de générations, ainsi que les principes structurants n’ont pas une affinité avec certains « genres » et si même ils n’en créent pas de nouveaux à leur propre intention. Ainsi, la génération romantique avait marqué et cultivé d’autres genres que ceux de la génération libérale d’avant la révolution de 1848.
On doit aussi prendre en considération l’influence des formes sociales de la vie communautaire. Là aussi, il y a différentes formes d’être-ensemble qui conviennent mieux, tantôt à telles intentions de génération et de courants, tantôt d’autres. Mentré [Les générations sociales, Paris, 1920] avait déjà fait observer que l’association régie par des statuts est beaucoup moins susceptible de refléter les nouvelles impulsions de génération que les formes plus fluctuantes de socialisation (comme les salons).
Exactement de la même façon que le niveau social et historique peut freiner ou favoriser l’éclosion de l’entéléchie de génération, il s’avère donc que les « sphères » à l’intérieur desquelles elles peuvent trouver le mieux leur expression, ne peuvent pas être prédéterminées avec précision. Tout ceci ne fait que confirmer par ailleurs que le facteur de génération qui agit et existe avec la régularité d’une loi naturelle, ne peut être appréhendé dans l’élément « spirituel-social » qu’avec bien des difficultés et seulement par des voies détournées.
Le phénomène de génération est un des facteurs fondamentaux de la réalisation de la dynamique historique. L’étude de la combinaison des forces qui agissent conjointement est un ensemble de tâches en soi ; sans l’éclaircissement qu’elle apporte, l’histoire ne peut pas être appréhendée dans son devenir. Une telle problématique ne peut aboutir qu’avec une analyse rigoureuse préalable de la spécificité de toutes les composantes pertinentes.
L’analyse sociologique formelle du phénomène de génération peut d’abord contribuer à montrer, aussi clairement que possible, ce qui peut être expliqué par cette composante et ce qui ne peut pas être appréhendé directement à partir d’elle.
Pierre Bourdieu, entretien
Pierre Bourdieu, entretien avec Anne-Marie Métailié, paru dans Les jeunes et le premier emploi, Paris, Association des Ages, 1978, p. 520-530. Repris in Questions de sociologie, Éditions de Minuit, 1984, p.143-154.

Pierre Bourdieu : « La frontière entre jeunesse et vieillesse est dans toutes les sociétés un enjeu de lutte ».
Comment le sociologue aborde-t-il le problème des jeunes ?
Le réflexe professionnel du sociologue est de rappeler que les divisions entre les âges sont arbitraires. C’est le paradoxe de Pareto disant qu’on ne sait pas à quel âge commence la vieillesse, comme on ne sait pas où commence la richesse. En fait, la frontière entre jeunesse et vieillesse est dans toutes les sociétés un enjeu de lutte. Par exemple, j’ai lu il y a quelques années un article sur les rapports entre les jeunes et les notables, à Florence, au XVIe siècle, qui montrait que les vieux proposaient à la jeunesse une idéologie de la virilité, de la virtú, et de la violence, ce qui était une façon de se réserver la sagesse, c’est-à-dire le pouvoir. De même, Georges Duby montre bien comment, au Moyen Age, les limites de la jeunesse étaient l’objet de manipulations de la part des détenteurs du patrimoine qui devaient maintenir en état de jeunesse, c’est-à-dire d’irresponsabilité, les jeunes nobles pouvant prétendre à la succession.
On trouverait des choses tout à fait équivalentes dans les dictons et les proverbes, ou tout simplement les stéréotypes sur la jeunesse, ou encore dans la philosophie, de Platon à Alain, qui assignait à chaque âge sa passion spécifique, à l’adolescence l’amour, à l’âge mûr l’ambition. La représentation idéologique de la division entre jeunes et vieux accorde aux plus jeunes des choses qui font qu’en contrepartie ils laissent des tas de choses aux plus vieux. On le voit très bien dans le cas du sport, par exemple dans le rugby, avec l’exaltation des « bons petits », bonnes brutes dociles vouées au dévouement obscur du jeu d’avants qu’exaltent les dirigeants et les commentateurs (« Sois fort et tais-toi, ne pense pas »). Cette structure, qui se retrouve ailleurs (par exemple dans les rapports entre les sexes) rappelle que dans la division logique entre les jeunes et les vieux, il est question de pouvoir, de division (au sens de partage) des pouvoirs. Les classifications par âge (mais aussi par sexe ou, bien sûr, par classe…) reviennent toujours à imposer des limites et à produire un ordre auquel chacun doit se tenir, dans lequel chacun doit se tenir à sa place.
Par vieux, qu’entendez-vous ? Les adultes ? Ceux qui sont dans la production ? Ou le troisième âge ?
Quand je dis jeunes/ vieux, je prends la relation dans sa forme la plus vide. On est toujours le vieux ou le jeune de quelqu’un. C’est pourquoi les coupures soit en classes d’âge, soit en générations, sont tout à fait variables et sont un enjeu de manipulations. Par exemple, Nancy Munn, une ethnologue, montre que dans certaines sociétés d’Australie, la magie de jouvence qu’emploient les vieilles femmes pour retrouver la jeunesse est considérée comme tout à fait diabolique, parce qu’elle bouleverse les limites entre les âges et qu’on ne sait plus qui est jeune, qui est vieux. Ce que je veux rappeler, c’est tout simplement que la jeunesse et la vieillesse ne sont pas des données mais sont construites socialement, dans la lutte entre les jeunes et les vieux. Les rapports entre l’âge social et l’âge biologique sont très complexes. Si l’on comparait les jeunes des différentes fractions de la classe dominante, par exemple tous les élèves qui entrent à l’École Normale, l’ENA, l’X, etc., la même année, on verrait que ces « jeunes gens » ont d’autant plus les attributs de l’adulte, du vieux, du noble, du notable, etc., qu’ils sont plus proches du pôle du pouvoir. Quand on va des intellectuels aux PDG, tout ce qui fait jeune, cheveux longs, jeans, etc., disparaît.
Chaque champ, comme je l’ai montré à propos de la mode ou de la production artistique et littéraire, a ses lois spécifiques de vieillissement : pour savoir comment s’y découpent les générations, il faut connaître les lois spécifiques du fonctionnement du champ, les enjeux de lutte et les divisions que cette lutte opère (« nouvelle vague », « nouveau roman », « nouveaux philosophes », « nouveaux magistrats », etc.). Il n’y a rien là que de très banal, mais qui fait voir que l’âge est une donnée biologique socialement manipulée et manipulable ; et que le fait de parler des jeunes comme d’une unité sociale, d’un groupe constitué, doté d’intérêts communs, et de rapporter ces intérêts à un âge défini biologiquement, constitue déjà une manipulation évidente. Il faudrait au moins analyser les différences entre les jeunesses, ou, pour aller vite, entre les deux jeunesses. Par exemple, on pourrait comparer systématiquement les conditions d’existence, le marché du travail, le budget temps, etc., des « jeunes » qui sont déjà au travail, et des adolescents du même âge (biologique) qui sont étudiants : d’un côté, les contraintes, à peine atténuées par la solidarité familiale, de l’univers économique réel, de l’autre, les facilités d’une économie quasi ludique d’assistés, fondée sur la subvention, avec repas et logement à bas prix, titres d’accès à prix réduits au théâtre et au cinéma, etc. On trouverait des différences analogues dans tous les domaines de l’existence : par exemple, les gamins mal habillés, avec des cheveux trop longs qui, le samedi soir, baladent leur petite amie sur une mauvaise mobylette, ce sont ceux-là qui se font arrêter par les flics.
Autrement dit, c’est par un abus de langage formidable que l’on peut subsumer sous le même concept des univers sociaux qui n’ont pratiquement rien de commun.
[…]
Et cela a-t-il une influence sur les conflits de générations ?
Une chose très simple, et à laquelle on ne pense pas, c’est que les aspirations des générations successives, des parents et des enfants, sont constituées par rapport à des états différents de la structure de la distribution des biens et des chances d’accéder aux différents biens : ce qui pour les parents était un privilège extraordinaire (à l’époque où ils avaient vingt ans, il y avait, par exemple, un sur mille des gens de leur âge, et de leur milieu, qui avait une voiture) est devenu banal, statistiquement. Et beaucoup de conflits de générations sont des conflits entre des systèmes d’aspirations constitués à des âges différents. Ce qui pour la génération 1 était une conquête de toute la vie, est donné dès la naissance, immédiatement, à la génération 2. Le décalage est particulièrement fort dans le cas des classes en déclin qui n’ont même plus ce qu’elles avaient à vingt ans et cela à une époque où tous les privilèges de leurs vingt ans (par exemple, le ski ou les bains de mer) sont devenus communs. Ce n’est pas par hasard que le racisme anti-jeunes (très visible dans les statistiques, bien qu’on ne dispose pas, malheureusement, d’analyses par fraction de classes) est le fait des classes en déclin comme les petits artisans ou commerçants), ou des individus en déclin et des vieux en général. Tous les vieux ne sont pas anti-jeunes, évidemment, mais la vieillesse est aussi un déclin social, une perte de pouvoir social et, par ce biais-là, les vieux participent du rapport aux jeunes qui est caractéristique aussi des classes en déclin. Évidemment les vieux des classes en déclin, c’est-à-dire les vieux commerçants, les vieux artisans, etc., cumulent au plus haut degré tous les symptômes : ils sont anti-jeunes mais aussi anti-artistes, anti-intellectuels, anti-contestation, ils sont contre tout ce qui change, tout ce qui bouge, etc., justement parce qu’ils ont leur avenir derrière eux, parce qu’ils n’ont pas d’avenir, alors que les jeunes se définissent comme ayant de l’avenir, comme définissant l’avenir.
Mais est-ce que le système scolaire n’est pas à l’origine de conflits entre les générations dans la mesure où il peut rapprocher dans les mêmes positions sociales des gens qui ont été formés dans des états différents du système scolaire ?
On peut partir d’un cas concret : actuellement dans beaucoup de positions moyennes de la fonction publique où l’on peut avancer par l’apprentissage sur le tas, on trouve côte à côte, dans le même bureau, des jeunes bacheliers, ou même licenciés, frais émoulus du système scolaire, et des gens de cinquante à soixante ans qui sont partis, trente ans plus tôt, avec le certificat d’études, à un âge du système scolaire où le certificat d’études était encore un titre relativement rare, et qui, par l’autodidaxie et par l’ancienneté, sont arrivés à des positions de cadres qui maintenant ne sont plus accessibles qu’à des bacheliers. Là, ce qui s’oppose, ce ne sont pas des vieux et des jeunes, ce sont pratiquement deux états du système scolaire, deux états de la rareté différentielle des titres et cette opposition objective se retraduit dans des luttes de classements : ne pouvant pas dire qu’ils sont chefs parce qu’ils sont anciens, les vieux invoqueront l’expérience associée à l’ancienneté, tandis que les jeunes invoqueront la compétence garantie par les titres. La même opposition peut se retrouver sur le terrain syndical (par exemple, au syndicat FO des PTT) sous la forme d’une lutte entre des jeunes gauchistes barbus et de vieux militants de tendance ancienne SFIO. On trouve aussi côte à côte, dans le même bureau, dans le même poste, des ingénieurs issus les uns des Arts et Métiers, les autres de Polytechnique ; l’identité apparente de statut cache que les uns ont, comme on dit, de l’avenir et qu’ils ne font que passer dans une position qui est pour les autres un point d’arrivée. Dans ce cas, les conflits risquent de revêtir d’autres formes, parce que les jeunes vieux (puisque finis) ont toutes les chances d’avoir intériorisé le respect du titre scolaire comme enregistrement d’une différence de nature. C’est ainsi que, dans beaucoup de cas, des conflits vécus comme conflits de générations s’accompliront en fait à travers des personnes ou des groupes d’âge constitués autour de rapports différents avec le système scolaire. C’est dans une relation commune à un état particulier du système scolaire, et dans les intérêts spécifiques, différents de ceux de la génération définie par la relation à un autre état, très différent, du système, qu’il faut (aujourd’hui) chercher un des principes unificateurs d’une génération : ce qui est commun à l’ensemble des jeunes, ou du moins à tous ceux qui ont bénéficié tant soit peu du système scolaire, qui en ont tiré une qualification minimale, c’est le fait que, globalement, cette génération est plus qualifiée à emploi égal que la génération précédente (par parenthèse, on peut noter que les femmes qui, par une sorte de discrimination, n’accèdent aux postes qu’au prix d’une sur-sélection, sont constamment dans cette situation, c’est-à-dire qu’elles sont presque toujours plus qualifiées que les hommes à poste équivalent…). Il est certain que, par-delà toutes les différences de classe, les jeunes ont des intérêts collectifs de génération, parce que, indépendamment de l’effet de discrimination « anti-jeunes », le simple fait qu’ils ont eu affaire à des états différents du système scolaire fait qu’ils obtiendront toujours moins de leurs titres que n’en aurait obtenu la génération précédente. Il y a une déqualification structurale de la génération. C’est sans doute important pour comprendre cette sorte de désenchantement qui, lui, est relativement commun à toute la génération. Même dans la bourgeoisie, une part des conflits actuels s’explique sans doute par-là, par le fait que le délai de succession s’allonge, que, comme l’a bien montré Le Bras dans un article de Population, l’âge auquel on transmet le patrimoine ou les postes devient de plus en plus tardif et que les juniors de la classe dominante doivent ronger leur frein. Ceci n’est sans doute pas étranger à la contestation qui s’observe dans les professions libérales (architectes, avocats, médecins, etc.), dans l’enseignement, etc. De même que les vieux ont intérêt à renvoyer les jeunes dans la jeunesse, de même les jeunes ont intérêt à renvoyer les vieux dans la vieillesse.
Il y a des périodes où la recherche du « nouveau » par laquelle les « nouveaux venus » (qui sont aussi, le plus souvent, les plus jeunes biologiquement) poussent les « déjà arrivés » au passé, au dépassé, à la mort sociale (« il est fini »), s’intensifie et où, du même coup, les luttes entre les générations atteignent une plus grande intensité : ce sont les moments où les trajectoires des plus jeunes et des plus vieux se télescopent, où les « jeunes » aspirent « trop tôt » à la succession. Ces conflits sont évités aussi longtemps que les vieux parviennent à régler le tempo de l’ascension des plus jeunes, à régler les carrières et les cursus, à contrôler les vitesses de course dans les carrières, à freiner ceux qui ne savent pas se freiner, les ambitieux qui « brûlent les étapes », qui se « poussent » (en fait, la plupart du temps, ils n’ont pas besoin de freiner parce que les « jeunes » — qui peuvent avoir cinquante ans — ont intériorisé les limites, les âges modaux, c’est-à-dire l’âge auquel on peut « raisonnablement prétendre » à une position, et n’ont même pas l’idée de la revendiquer avant l’heure, avant que « leur heure ne soit venue »). Lorsque le « sens des limites » se perd, on voit apparaître des conflits à propos des limites d’âge, des limites entre les âges, qui ont pour enjeu la transmission du pouvoir et des privilèges entre les générations.