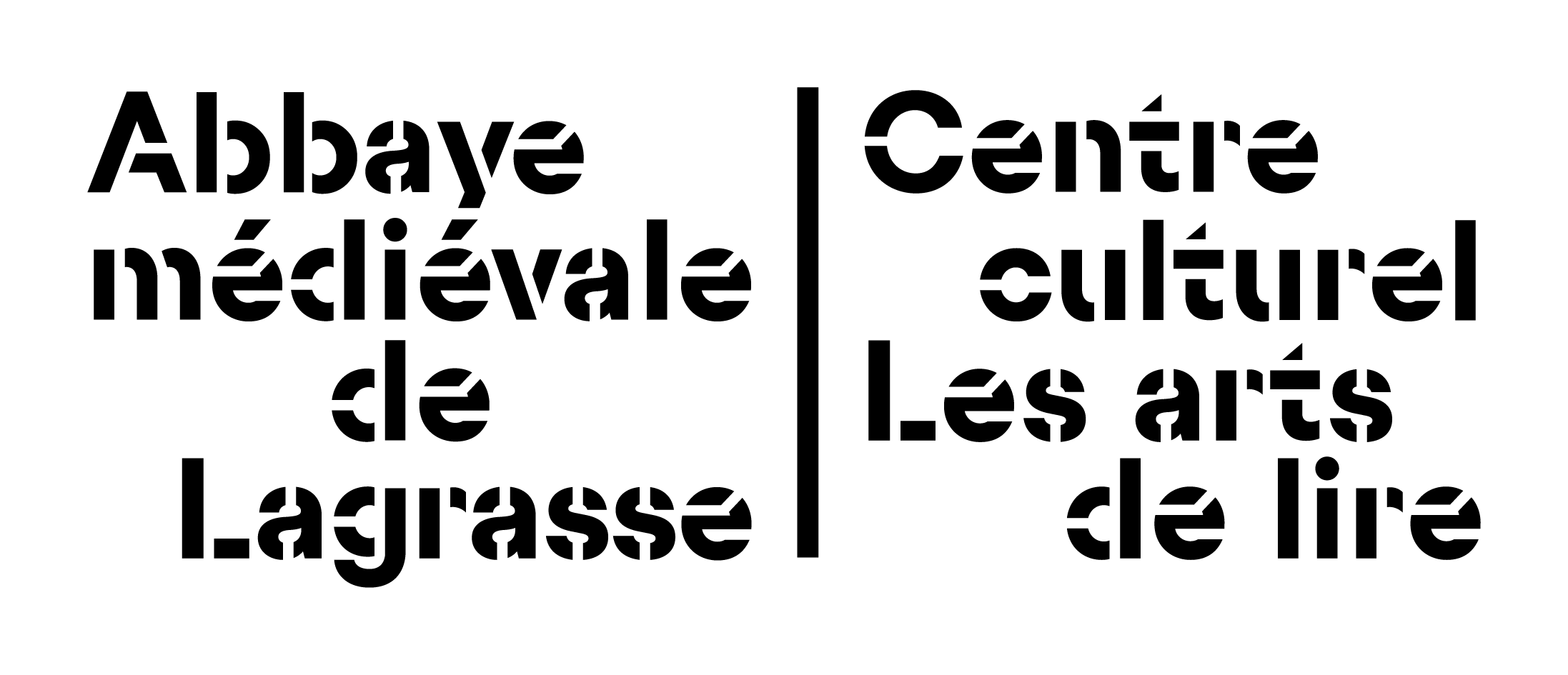Quand commence un corps ? Telle est, en apparence innocente, la timide mais forte question qui, entre dimanche et lundi, s’imprime au fronton de chacune des interventions. Quand débute un corps ? C’est-à-dire quand ce corps commence-t-il à m’apparaître et à se poser comme, finalement, ma première altérité au cœur de moi-même ? Vaste question, encore plus vaste réponse, éparpillement des pluriels, des hypothèses et des certitudes. Car, du dialogue avec Olivier Haralambon jusqu’à Marielle Macé convoquant Stéphane Bouquet, n’a cessé d’être posée la question de la naissance. Quand mon corps naît-il à lui-même ?
Au-delà de l’abstrait, le corps invite, au Banquet, à être toujours concret. La concrétude est même sa condition première. C’est peut-être ainsi, à remonter le fil des différents intervenants, ce qui a tramé le coeur même du dialogue entre Olivier Haralambon et Jean-Sébastien Steil : un dialogue qui pose d’emblée la question du corps comme une vaste histoire de la douleur. Quelle est la place de la douleur dans une possible généalogie de la connaissance du corps ? Olivier Haralambon se fait extrêmement matériel : le corps, c’est d’abord la chute. La chute à vélo qu’il a connue, lui le champion cycliste, alors qu’il roulait en compagnie de Romain Bardet, le champion qu’on ne présente plus. Le corps, c’est donc tout d’abord la douleur qui vient à soi mais cette douleur a toute une histoire longue comme le monde dans le cyclisme et le sport. La douleur, c’est la récompense de l’effort parce que le corps finalement y reconduit des schémas religieux, ceux qui exaltent, comme dans le catholicisme, la douleur comme le perpétuel et indépassable sacrifice de soi. La douleur comme abnégation ultime qui prouve à soi-même son propre prix, répètent donc tous les sportifs en chœur.

Finalement, le vélo n’est jamais loin de Georges Bataille car, poursuit Haralambon, ce discours de la douleur physique, de l’épreuve à soi de son propre corps, devient le moment d’une visée vers la transcendance. Une transcendance qui se fixe un but unique : finir dans un dépouillement, une ascèse sans pareille où vient aussi, à l’idéal religieux, se mêler une exaltation viriliste. Le corps n’est jamais loin de la manipulation idéologique comme s’il s’agissait toujours de le faire parler à la place de sa propre bouche, à la place de son propre coeur.
Et cette histoire de la douleur des corps va se poursuivre le soir même, dans un temps où la pluie fine se mêle à la bourrasque folle, pour innerver le spectacle de Laure Catherin et Christophe Grégoire, le très beau L’Accouchée tiré du récit de Florence Pazzottu. Le corps de douleur, c’est celui de la femme enceinte, le corps de la maternité et bientôt celui de la délivrance : l’accouchement. Après une immersion de près d’un an dans une maternité de Rennes, les deux dramaturges ont proposé ce spectacle qui pose, avec leur personnage de Sara, la question même de la manière dont les femmes veulent disposer de leurs corps. Est-ce que les femmes peuvent décider elles-mêmes pour elles-mêmes de ce qu’elles veulent ? Comment la traversée de la douleur de la grossesse peut être l’occasion de réfléchir à la manière dont les femmes entendent se saisir de l’émancipation ?
Le sujet est clivant, les sujets sont clivés, le plateau de théâtre est divisé, et les différents micros constituent le très bel effet scénique et sonique d’un spectacle qui met en lumière les mouvements contradictoires qui peuvent exister, à propos de son propre corps, entre soi et soi-même. Va-t-on accoucher de soi ? Voulez-vous accoucher avec moi, pourrait-on répondre en choeur tant, en effet, il faut s’apprivoiser, apprendre à connaître son corps-limite et sa capacité de résistance mais aussi d’accueil au monde.
Une telle histoire de la douleur ne peut revêtir ainsi que quelques accents polémiques puisqu’il s’agit ici de montrer encore et toujours de ne pas imposer aux femmes un discours sur le sacrifice, sur l’acceptation de la douleur – ou inversement de décider pour elles de les soulager : se réapproprier son corps pour ne pas être comme confisqué de soi-même.

La nuit vient. La scène se vide mais cette histoire de la douleur des corps reprend encore plus vivement le midi avec la première intervention de la nouvelle case de la programmation méridienne, l’exercice d’admiration que Marielle Macé inaugure. Son exercice se concentre sur l’oeuvre poétique de Stéphane Bouquet, poète s’il en est du corps, poète s’il en est de la sensualité au monde. Dans cette journée consacrée à la culture sourde, le dispositif scénique installe Marielle Macé disant son texte sur scène et deux interprètes le transcrivant simultanément en langue des signes dans une explicite gestuelle où il s’agit de proposer par le corps de communiquer. L’histoire de la douleur, ce serait l’histoire ici de corps qui ne communiquent pas, qui ne peuvent pas échanger, qui ne peuvent pas se comprendre. Rien de tel avec Marielle Macé parlant de Stéphane Bouquet : au contraire, des phrases pour la suite livrent précisément un art de la phrase qui se donne comme un art de poètes grammairiens comme Macé qualifie Bouquet. La phrase devient une entité plastique multiple : elle est une scène du vivant, un moment où les corps se côtoient et flamboient mutuellement. Une phrase qui, plus qu’une scène, devient le corps commun de liens entre les êtres, autant de singularités quelconques qui se croisent et se tiennent puisque, comme le dit Bouquet, « tout se tient ».
La respérance, du beau mot de Stéphane Bouquet, le re-départ de tous les corps, seraient ainsi le moyen de faire choeur ensemble. Il est midi. L’heure de se retrouver : c’est le moment au Banquet de faire corps.
par Johan Faerber
Photographies par Idriss Bigou-Gilles
-o-
Si la culture vous fait de l’effet, retrouvez toute l’actualité critique sur le site Collatéral fondé par Johan Faerber.