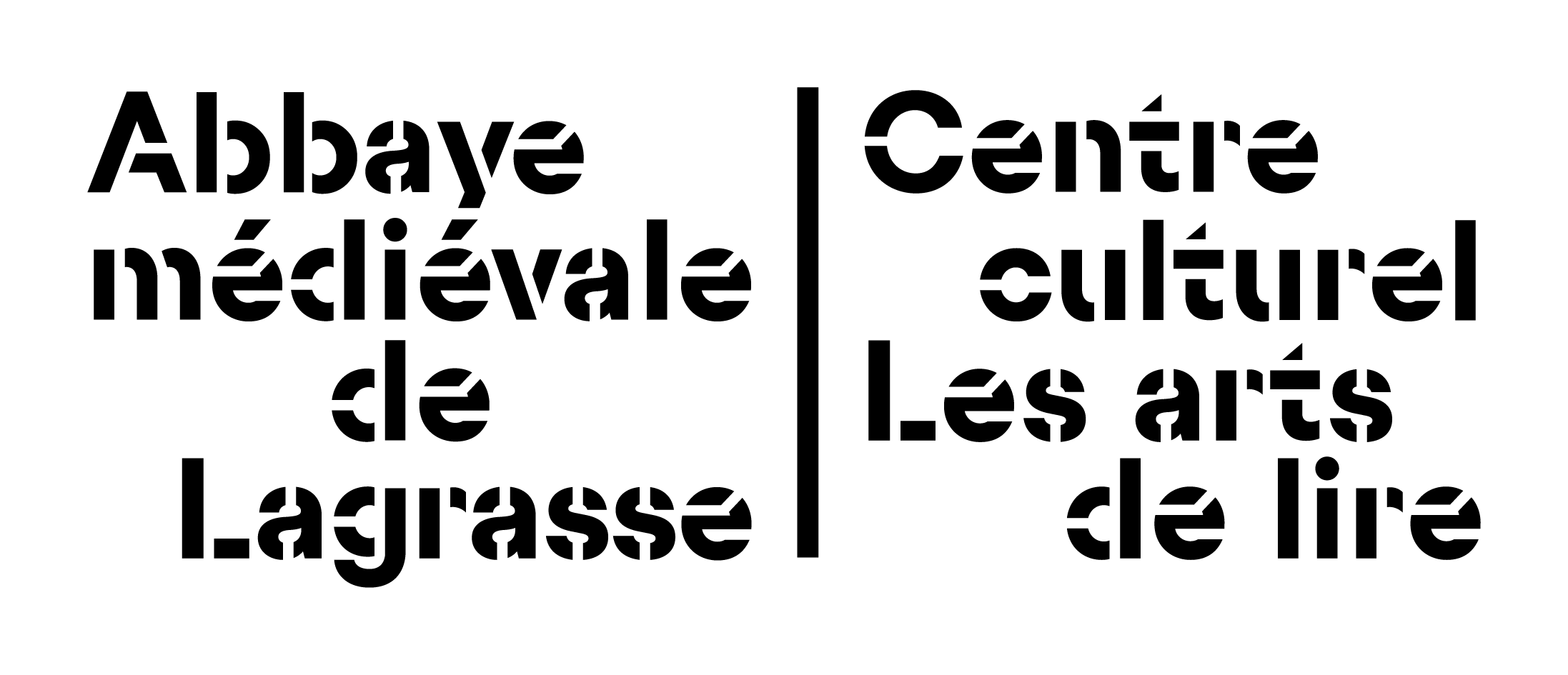Chaque corps a une existence locale. C’est peut-être bien davantage ou bien peu par rapport à une existence individuelle. Chaque corps a une existence locale, c’est-à-dire est ce corps qui point vers une existence localisée, géolocalisable ou en tout cas une existence où locale ne doit pas être prise au pied de la lettre mais doit être intégralement tournée vers la vibration, l’intensité singulière qui fait sens et sensible en chacun. Tels sont, dans Corpus de Jean-Luc Nancy, les quelques mots qui permettent d’éclairer cette particulière énergie du corps à être un émetteur de signes mais aussi à se tenir comme un prospecteur actif de sens. Un corps à l’existence locale, ni province, ni terroir – mais un corps qui est aussi capable, parce qu’il est local, de faire événement. Tout dépend de l’accord qui nous échoit.
C’est ce corps-événement qu’a sondé et interrogé cette cinquième journée du Banquet du livre d’été de Lagrasse en proposant, intervention après intervention, lecture après lecture, une véritable réflexion sur la manière dont le corps, par sa localité, peut se revendiquer politique. Car le corps s’impose ici comme le lieu de la parole même qui dira une inscription malaisée et fragile au milieu des paysages contradictoires et parfois illisibles d’un monde plus encore en expansion que l’univers lui-même. C’est peut-être Marie-Hélène Lafon qui fait tout d’abord entendre cette part du corps qu’on ne choisit pas : le décor où il naît. A travers trois lectures comme une valse à trois temps d’extraits de l’oeuvre de Josef Winkler, Marie-Hélène Lafon pose la question de savoir comment l’oeuvre montre un narrateur entré à corps perdu dans un monde, une famille, une histoire. Le corps local se fait ici un corps translocal tant il devient une manière d’intercesseur inouï entre le royaume des morts et la misère des vivants. Une manière d’intercesseur entre le père défunt et la mère pas encore tout à fait morte. Une manière d’intercesseur entre Klagenfurt et sa petite région, et le reste très grand du vaste monde.

Ce corps local tel que le fait transiter dans sa parole elle-même d’intercesseur Marie-Hélène Lafon donne à voir et à lire une sortie permanente hors de soi, hors du sol, qui jette à nouveau une lumière nouvelle sur la manière d’organiser politiquement à la fois une lecture du vivant mais aussi d’organiser une résistance au monde tel qu’il ne va plus. Citant Michel Foucault selon lequel aucune société ne laisse sans contrôle les usages que ses membres font de leurs corps, Dominique Memmi enchaîne dans la grande conférence du soir qui suit Marie-Hélène Lafon sur ces manières voire ces dispositifs selon lesquels les corps deviennent régulables – sans leur accord.
Que sont ainsi ces années 1970 qui, contre le contrôle très localisé des corps, ont pu progressivement mettre sur pied ce fameux « gouvernement de la parole » qui a pu permettre à toute une génération d’opérer de son vivant une massive réappropriation des corps ? De son propre corps. Ce gouvernement de la parole a ainsi pu permettre de sortir de ce local de soi pour partir à la conquête de droits sociaux, écrire une nouvelle histoire ?

Comment le corps local peut devenir un outil de lutte à plusieurs pour obtenir que le corps ne soit plus l’objet d’une soumission sans trêve dont la violence est la clef ? C’est peut-être la grande leçon de la très belle lecture performée de Léonor de Récondo, Mélanie Traversier et Julia de Gasquet, à la nuit tombée de Lagrass, qui, après le OFF d’Avignon, s’est déployée mercredi soir sous le titre de Le Désir du désir du désir sur un texte de Léonor de Récondo et une mise en scène de Julia de Gasquet.
« Je dis : assez. Il est temps de crier assez et de faire bloc avec nos corps » clament les trois actrices sur scène comme la scansion d’un désir impossible à tenir et pourtant à accomplir. L’ardeur est ici politique car elle renvoie avec force à la violence que les corps féminins subissent sous la dictature de Salazar quand en 1972 les trois Maria décident, elles qui vivent à Lisbonne de se retrouver chaque mardi à déjeuner pour évoquer la condition des femmes sous cette dictature. Qu’en est-il quand les corps ne sont considérés que pour être des ventres à remplir d’enfants à accoucher ? Que faire de cette maternité quand elle use du corps comme d’une usine à reconduction des impératifs du patriarcat ? Que faire sinon trouver, depuis leurs corps, l’accord d’un être ensemble du désir de se battre et de résister ? Peut-être retrouver comme le font Mélanie Traversier, Léonor de Recondo et Julia de Gasquet la parole de ces femmes pour mieux éclairer les combats encore à mener aujourd’hui et comprendre que cette lutte n’a rien de locale ?

Que cette lutte et cette violence contre les corps féminins, c’est aussi celle qui innerve avec une force rare le magistral texte qu’Emma Marsantes a lu le lendemain midi pour l’oeuvre en corps, l’oeuvre en cours. Accompagnée de l’actrice Mélanie Traversier, comme un fil continu entre chaque moment, Emma Marsantes a dévoilé un très bel et terrible extrait de N’Efface pas mes cercles, troisième récit à venir et en cours d’écriture qui fait suite à Une mère éphémère (2022) et Les Fous sont des joueurs de flûte (2024). Cette fois, Mia revient sur les traces de son père : comment était-il promis à la folie qui a fini par emporter la famille ? Comment chaque famille est-il la disparition du corps des femmes devant le souci masculin de la reproduction et comment le corps de l’homme achève sa domination ? 1908, 1913, 1930 : c’est l’histoire tragique des Bratard, du patriarche, quelque part à Pornic, dans la demeure des Grands Chênes où après six filles, un jeune héritier naît enfin : Bertrand. Mais à 4 ans, Bertrand meurt. Une déferlante naît, on ne sait comment. Il est tué dans l’eau. La famille noyée avec. Peu à peu se dit ici la folie des corps morts hérités, l’obsession de l’héritier et la folie faite aux femmes. Cette folie quand, de l’héritier, le corps échoue. C’est ce corps sans vie et sans choix qu’il nous appartient d’écouter et d’écrire.
par Johan Faerber
Photographies par Idriss Bigou-Gilles
-o-
Si la culture vous fait de l’effet, retrouvez toute l’actualité critique sur le site Collatéral fondé par Johan Faerber.