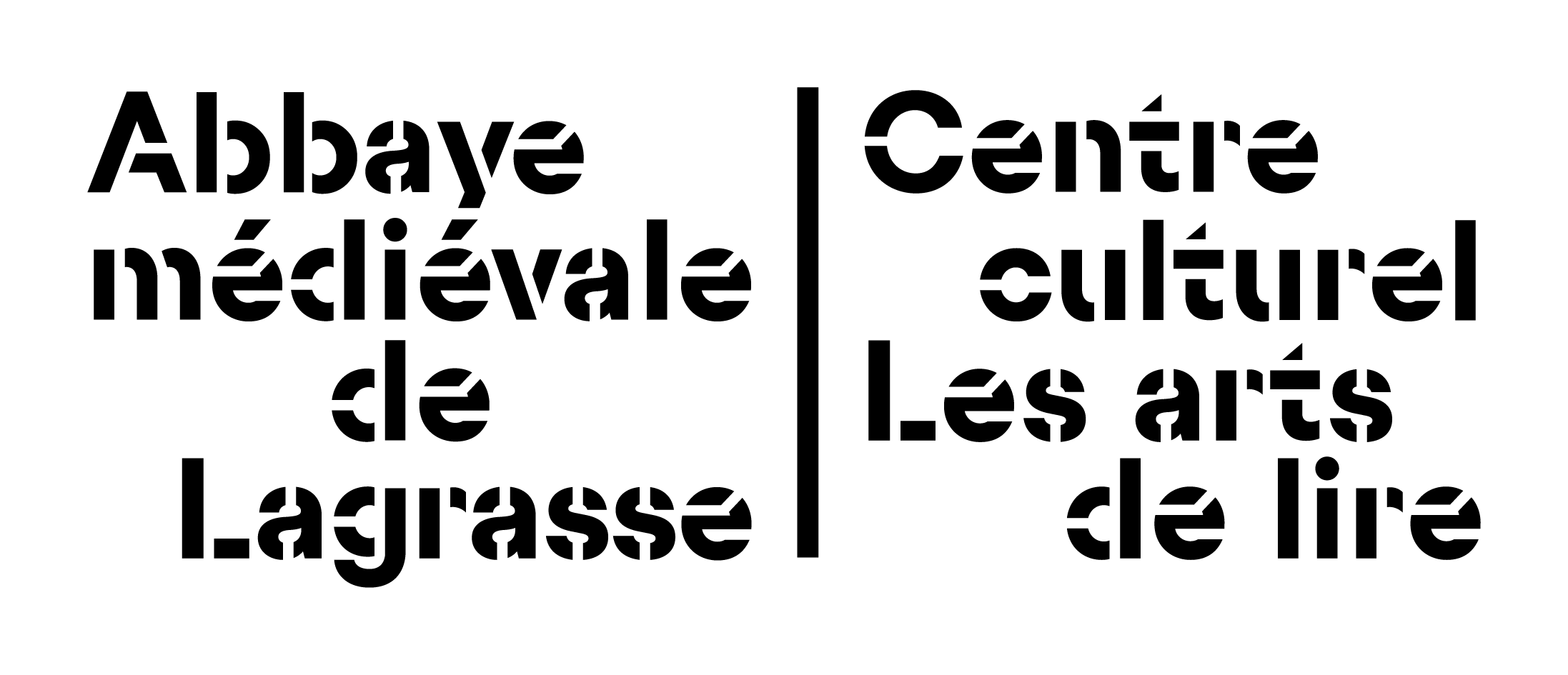Les gestes sont précis. Ils proposent une véritable grammaire. Ils ne viennent pas en doublure d’un langage premier mais viennent eux-même parler une langue qui serait elle-même intégralement tournée vers l’expression des signes. Les mains sont celles de femmes, les mains sont celles d’hommes. Des mains qui parviennent à produire ce que l’oreille n’arrive pas à entendre, ce que la bouche ne produit pas. Les mains viennent réparer et plus que réparer : elles viennent produire continument une parole. Elles parlent.
C’est peut-être ce qui, d’emblée, a pu frapper lors de la journée Culture Sourd du Banquet du livre d’été de Lagrasse, à travers le patient et ardent travail de traduction et d’interprétation de l’association Arts Résonances qui venait, à chaque intervention, proposer sa compréhension pour le public sourd. Cette langue frappe d’emblée par ce qu »elle surconvoque le corps en débarrassant chacune et chacun des préjugés selon lesquels les sourds seraient amoindris, les sourds seraient défaillants, les sourds seraient stigmatisés. Cette langue des signes n’est littéralement pas insigne tant elle convoque une vision politique même du champ social : tant il s’agit par la production d’une langue de se réapproprier un espace social, tant qu’il s’agit de produire par la langue des signes un véritable lieu même de visibilité : comme un aruspice traçait un rectangle pour faire surgir une phrase.
Cette sollicitation d’un corps qui devient l’espace même de visibilité de la langue est apparue hier avec une force rare lors de la très belle performance des deux poètes en VV, Erwan Nomad et Arnoldas Matulis, qui articulent cette langue Visual Vernacular qui exprime leur poésie. Sous la halle, près d’une heure durant, chacun des deux poètes ont sollicité leur corps pour choisir leurs mots. Tour à tour, chacun des deux hommes ont démontré à qui en douterait encore que la langue des signes est une langue de production situationnelle, qu’elle projette dans chaque phrase le double ensemble que la poésie de Stéphane Bouquet sollicite : la phrase comme espace de scène, la phrase comme espace de communauté. Le signe VV devient ici, par le corps, et parce qu’il n’a pas le choix, l’occasion de montrer, à pleine lumière, combien la langue des signes n’est pas une langue simplement véhiculaire mais qu’il s’agit avant tout d’une langue artistique.

Peut-être même que le corps en produit une langue non pas perfomative mais toujours-déjà performance. C’est indéniablement l’image même qui se dégage des véritables tableaux que Nomad et Matulis ont proposé : une langue qui va chercher sans attendre du côté du visuel, une langue qui va chercher sans attendre du côté du de l’expression imagée, une langue qui va chercher sans attendre du côté du mime. Car pantomime il y a comme si la VV, de la pomme turquoise jusqu’aux Magiciens, deux des poèmes de Nomad et Matulis, prouvait que la poésie en VV imposait une gestuelle des plus parlantes.
Une gestuelle par le corps qui vient en tout point contredire ces avis médicaux qui ont jeté un des traumatismes les plus vifs parmi la communauté sourde, celle dont Florence Encrevé retracera le soir même l’histoire tortueuse. Car c’est une histoire de biopouvoir par excellence que cette histoire de la surdité puisque, très vite, les sourds ont été considérés comme des pestiférés, des gens manquants, des gens à qui un sens manquait et tout était dépeuplé. Le biopouvoir par excellence est ainsi celui qui caractérise cette histoire de la surdité à l’âge classique tant il s’agissait pour de nombreux médecins de venir normer la surdité, l’effacer comme si le cinquième sens manquant endeuillait le monde des sourds. Un biopouvoir qui veut ainsi normer les corps et veut non pas tant les réparer que les convertir – comme si, comme toute communauté, les sourds se voyaient exposés à la même horreur politique que la communauté gay : la pratique de la médecine dans l’optique généralisée d’une thérapie de conversion. Erwan Nomad le montrera encore le lendemain au Grand petit déjeuner à la suite de son poème de la veille : ils veulent nous réparer mais pourtant nous ne sommes pas des machines à laver. Nos mains ont la parole mais elles sont aussi libres.
Libres pourquoi ? Parce que la langue des signes est peut-être plus qu’aucune autre une langue du désir de communiquer qui n’a pas d’origine assignable mais qui ne dit que deux choses : pour communiquer, il faut insister entre nous, et il faut résister. La langue des signes, nous disent les poètes en VV, fixe plus que jamais un horizon politique à nos corps. Parler en langue des signes consiste ainsi à ne pas traduire le langage mot à mot mais à produire du sens sans le son dans cette langue orale mais non vocale.
Cette langue vernaculaire, sans assignation d’origine possible, est aussi celle qu’a cherché à faire entendre Laurence Potte-Bonneville, le midi du troisième jour, à travers de beaux extraits de son nouveau récit à venir, Fossiles, à paraître en janvier 2026 chez Verdier. Dans ce nouveau moment du midi du Banquet du livre d’été, Laurence Potte-Bonneville fait entendre un corps ancestral, celui des fossiles, du palimpseste de ces vies dont on n’a pas encore donné le récit car elles se sont enfoncées dans la légende. C’est l’auto-stoppeuse en montagne dont le corps se fait sentir, c’est la route sinueuse, c’est la chute des corps. Quand elles écrivent, ses mains ont la parole.
par Johan Faerber
Photographies par Idriss Bigou-Gilles
-o-
Si la culture vous fait de l’effet, retrouvez toute l’actualité critique sur le site Collatéral fondé par Johan Faerber.