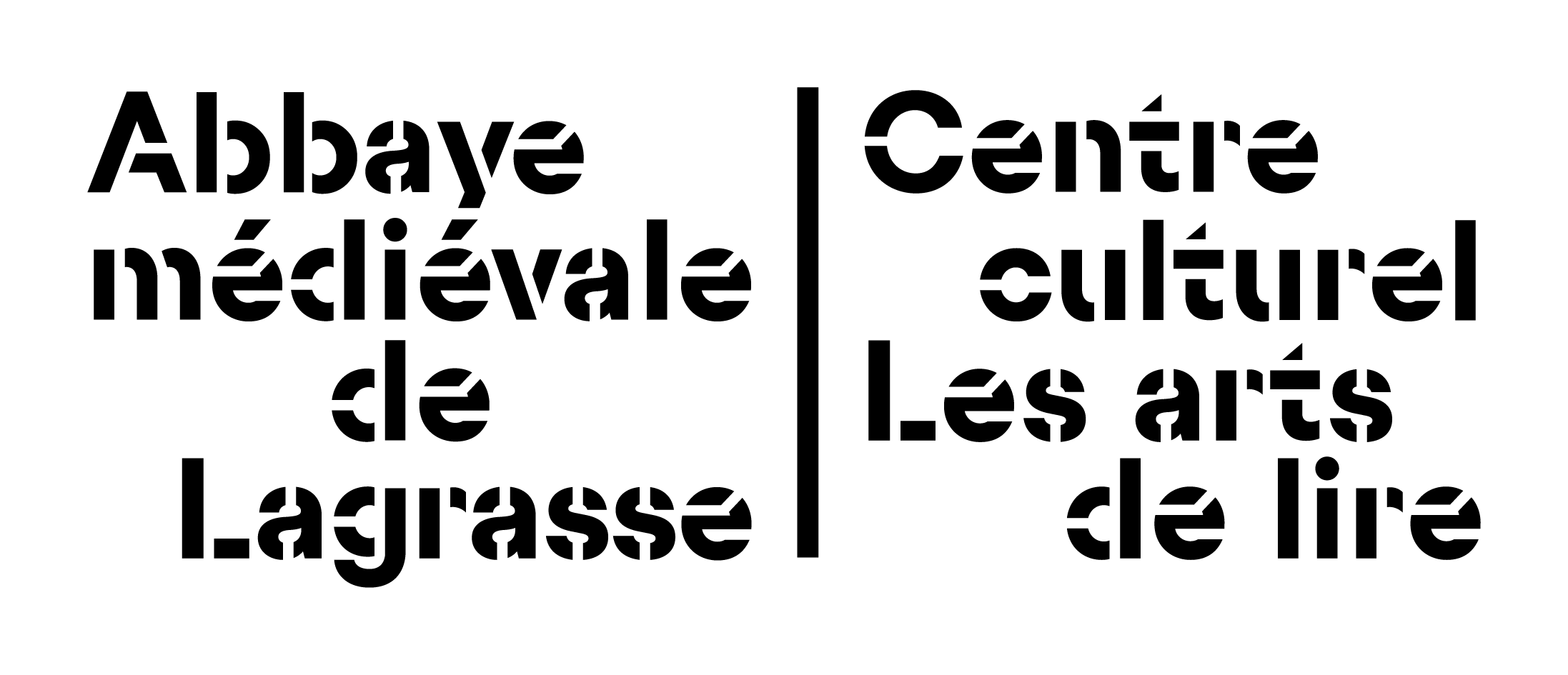Tout commencerait, à la nuit tombée, par le corps d’une femme qui s’accroche à une corde. Elle remonte le long de cette corde. Sa vie ne tiendrait, là, qu’à un fil. Ce fil, c’est ce dont précisément, parvenue au sommet de la poutre qui le soutient, elle se débarrasse. Car le fil qui la retenait à la vie était peut-être cette corde qui allait faire d’elle une pendue. Pour nos yeux de spectateurs transis et effrayés à Lagrasse, en ce soir d’inauguration du Banquet du Livre d’été, l’arc qui soutient ce corps acrobate exhibe le corps d’une femme qui veut échapper à la mort qu’on veut lui donner. Être acrobate, suggère Chloé Moglia dans sa performance à couper le souffle, c’est peut-être faire du corps féminin le lieu d’une acrobatie sans pareille : défier la mort qu’on veut socialement lui infliger. Sans la corde, il ne va pas falloir tomber. Chuter. Décéder. Les images s’affolent. Le public comprend qu’en fait il faut se tordre de douleur comme elle le fait pour parvenir à exister. Elle s’accroche : sens propre, sens figuré. Le corps devient torturé : les muscles bandés, il faut remonter le long du gibet. La pendue s’échappe. Elle glisse le long du gibet pour remonter la mort à l’envers. Seul son corps est capable d’accomplir cet exploit. La douleur est intense. Le temps est long. Mais elle triomphe. Elle finit par revenir au sol : vivante. Elle va vaincu la mort, encore une fois.
C’est peu de dire que le Banquet du livre d’été de Lagrasse a choisi cette année avec cette performance intitulée Horizon d’ouvrir les perspectives sur une question qui va traverser et organiser toutes les interventions : qu’advient-il de nos corps ? Comment nos corps sont-ils traités ? Comment faire pour se les approprier quand les ordres patriarcaux et capitalistes veulent s’emparer d’eux ? Mon corps n’a pas les mêmes idées sur lui-même que le reste de la société : c’est dans cet espace de singularité que le corps devient depuis son « s » terminal invariable totalement pluriel. Que le corps devient le siège d’une résistance. Durant la semaine du Banquet, comme le fixe d’emblée Chloé Moglia, dont la singulière présence innerve aussi, Une femme sur le fil, le très beau récit d’Olivia Rosenthal qui dialogue avec l’acrobate en un bel échange animé par Nina Rocipon, le corps devient toujours un peu plus que lui-même parce que la société voudrait le considérer toujours un peu moins que vous. Encore et toujours.
Car ce corps, c’est d’abord une longue et patiente traversée d’histoires. Le corps perclu de douleurs de Chloé Moglia est une allégorie programmatique même du banquet : il est tant d’histoires de corps qui viendront à être déclinées. Peut-être à commencer, dès le dimanche matin, par la très forte projection du film événement de Claire Simon, Notre Corps. La cinéaste s’est rendue pendant quelques mois auprès d’un service hospitalier parisien en suivant exclusivement des patientes dont le corps est en proie à différentes maladies, affections, tourments. Claire Simon le dit sans détours en prologue à son film : chaque hôpital devient un réservoir d’histoires. On lit les lignes d’une vie à même le corps des patientes. Comme le palimpseste de Chloé Moglia au gibet de sa corde perdue, chaque patiente de Claire Simon dévide pendant les trois heures intenses de projection la violence que subissent les corps féminins. Violence qu’elles ne peuvent éviter et que la médecine entend réparer. Violence, encore et encore.
Parce que peut-être le corps est le symptôme d’un autre corps, ce corps social qui va mal, flanche et dépérit. Les grossesses sont éprouvantes, les cancers sont tueurs, le corps féminin est à la merci d’une société qui a cherché à chaque instant à l’inférioriser voire le détruire. On est loin du corps glorieux du Christ qui a abandonné tout le monde en rase campagne. Et ce corps féminin, c’est aussi ce qu’on montre. Car on le montre pas : ou plutôt on l’exhibe toujours, ce corps féminin, comme trophée pornographique, domination masculine oblige. Ici l’obscénité est retournée : la caméra médicale va sonder par-delà les organes. La crudité des images laisse le corps pantois. Mais il permet aussi de l’explorer car, ce que suggère sans détours Claire Simon, c’est combien il faut battre en brèche Freud qui faisait des femmes le continent inconnu. Le corps est alors nommé, désigné, exploré. Il faut le connaître non pour le dominer mais pour être libérée.
Assurément un grand moment que cette séance dominicale qui, dans le sillage de Chloé Moglia, permet de fixer décidément les enjeux riches et variés de ce banquet : le corps céleste, hissé au sommet de la nuit, face à l’Abbaye de Lagrasse, entouré de grasses chauves-souris qui voulaient l’attaquer, c’est l’écran du film de Claire Simon mais c’est aussi, et peut–être surtout, l’écho du corps politique à l’oeuvre lors de l’inauguration du Banquet. Une inauguration marquée par des discours aux accents de discord avec le contexte politique anxiogène contemporain. Il faut constituer son corps politique.
Avec force, s’est ainsi dit un clair désir de ne pas céder aux sirènes de l’extrémisme, de ne pas succomber aux idées anti-culturelles d’absence d’ouverture, d’effondrement d’horizon d’accueil de l’autre et de repli mortifère sur soi. Ceci est mon corps, et il m’appartient sans condition : telle est la ligne rouge à ne pas franchir pour savoir que chacun peut trouver le corps qui lui convient, qu’il s’agit de construire le rapport que l’on entend à sa propre corporéité – qu’il n’appartient qu’à chacun, littéralement, de s’incorporer. Notre histoire se tient là car le corps politique, c’est ce que montrait encore Claire Simon quand l’adolescente et l’adulte en transition venaient se construire politiquement dans le cabinet du médecin.
Le choix du corps, tel que cette première soirée et cette première journée du Banquet l’ont montré avec puissance, c’est comprendre que le corps n’est pas une pure abstraction. Dans chaque corps, il y a quelqu’un, il y a une histoire, il y a la grande tendresse de vouloir vivre. C’est peut-être le sens ultime du souffle rauque de Chloé Moglia réchappant du gibet. Un souffle à la place des paroles, un souffle continu et régulier qu’on entendait pour dire qu’au-delà des mots : il faut vivre, et en porter l’espoir : encore.
par Johan Faerber
-o-
Si la culture vous fait de l’effet, retrouvez toute l’actualité critique sur le site Collatéral fondé par Johan Faerber.