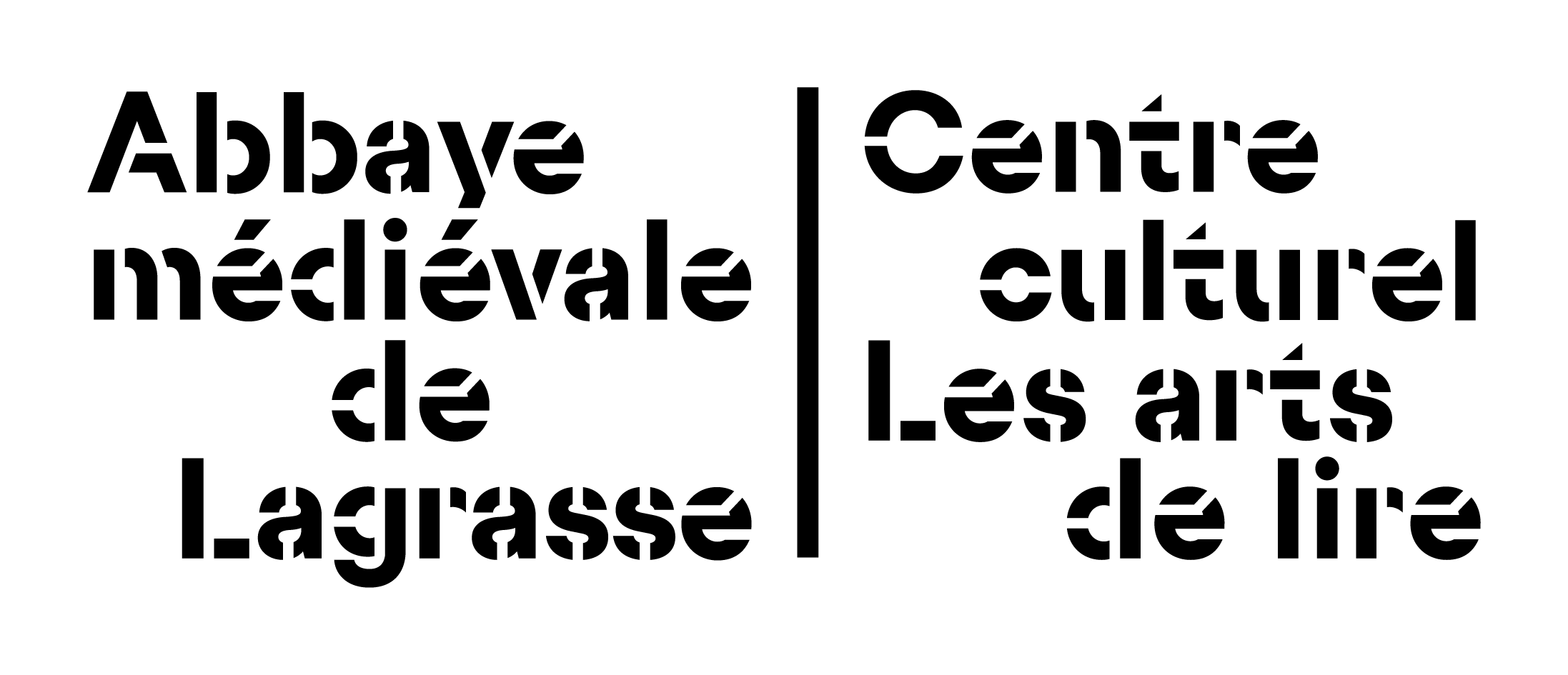Ce que peut… (2/5) la littérature – Marielle Hubert (photo Aurélie Foussard) est écrivaine. Elle a fondé la compagnie de théâtre La Folie Nous Suit, qu’elle a dirigée jusqu’en 2015. Elle a publié Ceux du noir (P.O.L.) en 2022. Son second roman, Il ne faut rien dire (P.O.L.), est paru en janvier 2024.
Dans la séquence politique très troublante dans laquelle nous sommes, où nos angoisses semblent prendre réalité, qu’est-ce qui vous paraît le plus inquiétant ?
Le plus préoccupant sont les gens qui se disent peu politisés et tiennent des propos d’extrême droite sans même sembler s’en rendre compte. Ce qui m’a le plus inquiétée, ce sont celles et ceux se définissant comme modérés et raisonnables et qui, tranquillement, expliquent qu’« on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », et que « l’insécurité vient quand même des étrangers », le sel du RN évidemment ! On connaît par cœur ce discours mais le plus angoissant est le fait qu’il soit devenu une opinion courante qu’on entend partout si on tend l’oreille. Cette banalisation de la rhétorique d’extrême droite a été soutenue par notre gouvernement, ce qui est extrêmement grave. Mais la catastrophe politique, je la situe avant, le 18 mai 2007, le jour où Brice Hortefeux prend la tête d’un « ministère de l’immigration et de l’identité nationale ». La France n’est pas descendue dans la rue ce jour-là et ce jour-là a été et reste ma catastrophe datée. Comme Caton l’Ancien, je ne cessais de répéter à tout le monde, quel que soit le sujet de la conversation, qu’il ne fallait pas laisser passer ça, j’étais obsédée par cette idée : Sarkozy avait créé un ministère de l’identité nationale, ces deux mots qui relèvent du fantasme nationaliste. Quand on pense avoir anticipé la catastrophe, peut-être est-on un tout petit peu moins catastrophé quand elle advient, c’est néanmoins très douloureux. Je me suis dit « c’était un projet et il a 20 ans. Nous avons collectivement laissé faire cette chose-là. ». Et le Karcher à Argenteuil ! Cette idée qu’un dirigeant arrive et dise « on va mettre un coup de Karcher » à la population, c’est insupportable. Une digue a été rompue à ce moment-là.
Vivez-vous votre démarche d’autrice, d’écrivaine, comme un engagement politique ?
Je ne crois pas. Toute ma vie est politique mais pas l’écriture. L’endroit du texte est un lieu de silence or j’assimile beaucoup l’engagement politique à la parole, à l’échange constant, au fait de susciter des questions, d’y répondre, de redéfinir les choses, d’essayer d’être précis dans le langage. Cela passe par une oralité assez quotidienne. Je vis à la Guillotière où beaucoup de gens sont issus de l’immigration et beaucoup d’autres de la migration, (d’ailleurs Jordan Bardella était venu pavaner dans mon quartier il y a quelques années pour en faire le symbole de l’insécurité à Lyon) et je me souviens que certaines personnes de mon entourage m’avaient dit « mais tu ne vas pas installer ta famille dans ce quartier ? » comme si c’était un acte inconscient ou héroïque de vivre là ! J’ai la sensation que mon engagement politique de gauche passe par l’exemple, par la vie quotidienne, par la cohérence entre idées et style de vie. Mais aussi en rappelant sans cesse par exemple que l’homophobie est un délit, pas une opinion, en m’interposant parfois quand je suis témoin d’agressions sexistes dans la rue… Le politique est nécessairement collectif, il appelle l’autre, le groupe. L’écriture en est la contreforme, la solitude extrême est nécessaire pour que le langage naisse. Mon travail est un moment de césure où je suis dans le silence parce que l’écrit ce n’est pas la parole, je ne suis pas avec les autres, je suis avec ma langue, je m’exclus de la vie. Ce qui ne veut pas dire que je ne défends pas des idées dans ce que j’écris qui pourraient être assimilées au politique, bien sûr. Peut-être que l’engagement politique et le militantisme sont indissociables à mes yeux. Dans mes livres, je ne milite pas.

« Avec ce livre je me suis confrontée à des réactions passionnées »
Peut-être qu’il y a plusieurs temps, le temps de l’écriture et celui de sa réception ? Car on pourrait quand même qualifier vos livres de politiques, notamment le dernier, Il ne faut rien dire, dans ce qu’il raconte des rapports de genre, dans ce qu’il donne à voir des violences intrafamiliales…`
Oui vous avez raison, c’est la réception qui est politique. Et la réception, en quelque sorte, elle ne m’appartient plus mais j’y assiste avec intérêt et inquiétude !
Avec ce livre je me suis confrontée à des réactions passionnées parfois d’adhésion enthousiaste et parfois de rejet (à ma grande surprise) de la part des plus militants ! Parce qu’il y a dans ce livre un discours qui ne prend pas entièrement et seulement le parti de la victime, qui ne se place pas uniquement du côté de la dénonciation de la domination masculine. On m’amène souvent sur ce terrain avec ce livre, et cela a pu me déstabiliser dans la mesure où j’essaie de décrire un système plutôt que de bâtir un manifeste. Si militantisme il y a dans Il ne faut rien dire, il n’est pas dans la dénonciation des violences masculines mais plutôt dans la mise en récit de ce qu’Anne Dufourmantelle appelait « la sauvagerie maternelle ». Il est également du côté de la défense d’un meilleur soin psychiatrique des victimes. Le Banquet du livre, il y a deux ans, avait justement organisé tout un cycle sur François Tosquelles, le fondateur de la psychiatrie institutionnelle, qui rappelait à quel point le soin devrait se faire en société. Je pense qu’une victime est d’abord un être social et qu’isolée sans possibilité de soin, elle a toutes les chances de reproduire la violence. C’est sur ce terrain-là que je voulais aller entre autres… mais pour être tout à fait honnête, je ne l’ai compris qu’après coup car le moment de l’écriture, étrangement n’est pas un moment d’idées, de pensée ou de démonstration, c’est une nuit totale. Une fois que j’en sors et que je défends le livre, le politique peut reprendre.
Bien sûr, Il ne faut rien dire introduit une complexité qui dépasse largement la dénonciation de la domination masculine, mais on est quand même plongé dans une expérience qui parle de cette domination.
La question que je me pose sur la domination masculine, c’est qu’on a souvent l’impression que les femmes n’en héritent pas comme sujet, qu’elles ne font que la subir sans la faire leur, en d’autres termes qu’elles hériteraient d’un statut de dominées qu’elles pourraient transmettre mais pas de celui du dominateur qui les ont engendrées. Sylvette, le personnage principal du livre, domine absolument l’éducation de son enfant, c’est-à-dire qu’elle prend le pouvoir, elle verrouille tout et elle n’est plus en mesure de partager quoi que ce soit. C’est une autre forme de domination sur l’individu qu’elle a fait sienne par son expérience « d’enfant de salaud ». L’idée n’est pas de dire « c’est encore la faute des femmes », mais de se demander comment cet héritage de la violence continue de s’exercer tant qu’on n’a pas dit « stop ».

Est-ce que la période qu’on vient de traverser a changé votre regard sur l’écriture, sur le sens que vous lui donnez, est-ce qu’elle est restée un espace de refuge et de silence ?Oui ça a changé. Au cœur de l’angoisse, je me disais, si on en est là, en France, je ne pourrai plus écrire, il va falloir que je donne mon temps à autre chose. J’ai eu la sensation que l’écriture allait s’arrêter, qu’entrer en résistance contre un gouvernement d’extrême droite installée deviendrait mon métier, que je n’aurais plus le temps pour autre chose. Je n’envisageais de continuer à écrire qu’en quittant le territoire. Si je restais en France, ce qui est une vraie question qui s’est posée intensément pour moi, je me suis dit alors il va falloir défendre les droits des étrangers, il va falloir résister, il va falloir refuser, aller voir si les fonctionnaires désobéissent, j’étais déjà quasiment dans cette idée de guerre … de guerre civile. Et je me suis dit, là, tu ne peux pas écrire.
Une autre question était : est-ce que j’ai envie de produire un texte dans un pays dirigé par l’extrême droite, est-ce que me taire n’est pas une autre manière de résister ? Je ne sais pas.
Peut-être parce que je viens du théâtre, j’ai toujours eu une grande conscience qu’on était les bouffons du roi. Nous sommes là parce qu’on nous subventionne, parce que le peuple a besoin de se divertir ou qu’on fournit des citations de bon aloi pour les discours. Alors certes, on participe à la vie intellectuelle du pays, mais les artistes sont les premiers à sauter quand il y a une dictature, quand il y a des coupes budgétaires, nous sommes une variable d’ajustement assez plastique, on a beau se donner de l’importance, nous sommes aussi des outils.
« Beaucoup de gens disent « la poésie sauvera le monde », et mon engagement de gauche m’amène à penser que c’est quand même une pensée bourgeoise »
Justement, alors que le RN n’a finalement pas accédé au pouvoir mais demeure une menace, est-ce qu’on peut se poser la question de l’accès à l’art et à la littérature, du fait que ces formes de création restent limitées à certains milieux sociaux ?
Mais oui ! Tout dépend du service public. Qu’il y ait des territoires qui n’aient plus de train, qui ne puissent plus se connecter à d’autres territoires, qui n’aient plus de bibliothèques, qui deviennent des déserts médicaux, tout ça c’est une seule et même chose ; ce ne sont pas des coupes budgétaires ici et là, c’est un projet politique qui vise à hiérarchiser les citoyens. Comme on le disait c’est la réception des œuvres et donc l’accès qui est politique et je suis une farouche militante de la décentralisation !
Donc dans la littérature de façon plus générale, est-ce qu’il n’y a pas un potentiel de subversion dans le contexte politique actuel ? Est-ce qu’elle peut être une forme de rempart, par exemple ?
Je ne crois pas. Beaucoup de gens disent « la poésie sauvera le monde », et mon engagement de gauche m’amène à penser que c’est quand même une pensée bourgeoise… Je ne crois pas que le beau nous tombe dessus de façon transcendantale, et ça ne veut pas dire, attention, que les classes populaires sont incapables d’apprécier une œuvre d’art … Mais il faut déjà avoir la place de penser, manger à sa faim, avoir des droits garantis, pour pouvoir donner un peu de temps à la littérature. Dans un monde où on exclut les gens, où la peur du lendemain occupe une grande place de l’activité émotionnelle des individus, où on meurt des particules fines, je ne vois pas bien ce qu’un texte… il faut que ça existe, bien sûr, mais il faut relativiser l’efficacité de notre travail. Même s’il est essentiel, ce qui nourrit les gens ce sont les agriculteurs quand même… Peut-être que les textes de Marie-Hélène Lafon sont plus que jamais nécessaires en ce moment, parce qu’elle travaille sur ce monde paysan malmené. Il y a peut-être des auteurs qui ont plus de résonnance dans ces temps troubles, qui sont nos boussoles ! J’ai la sensation qu’il faut être un peu humble avec ce qu’on est capable de faire, pour ma part, je ne crois pas que ma langue puisse remettre l’hôpital ou l’école debout par exemple.
Recueilli par Agnès Martial