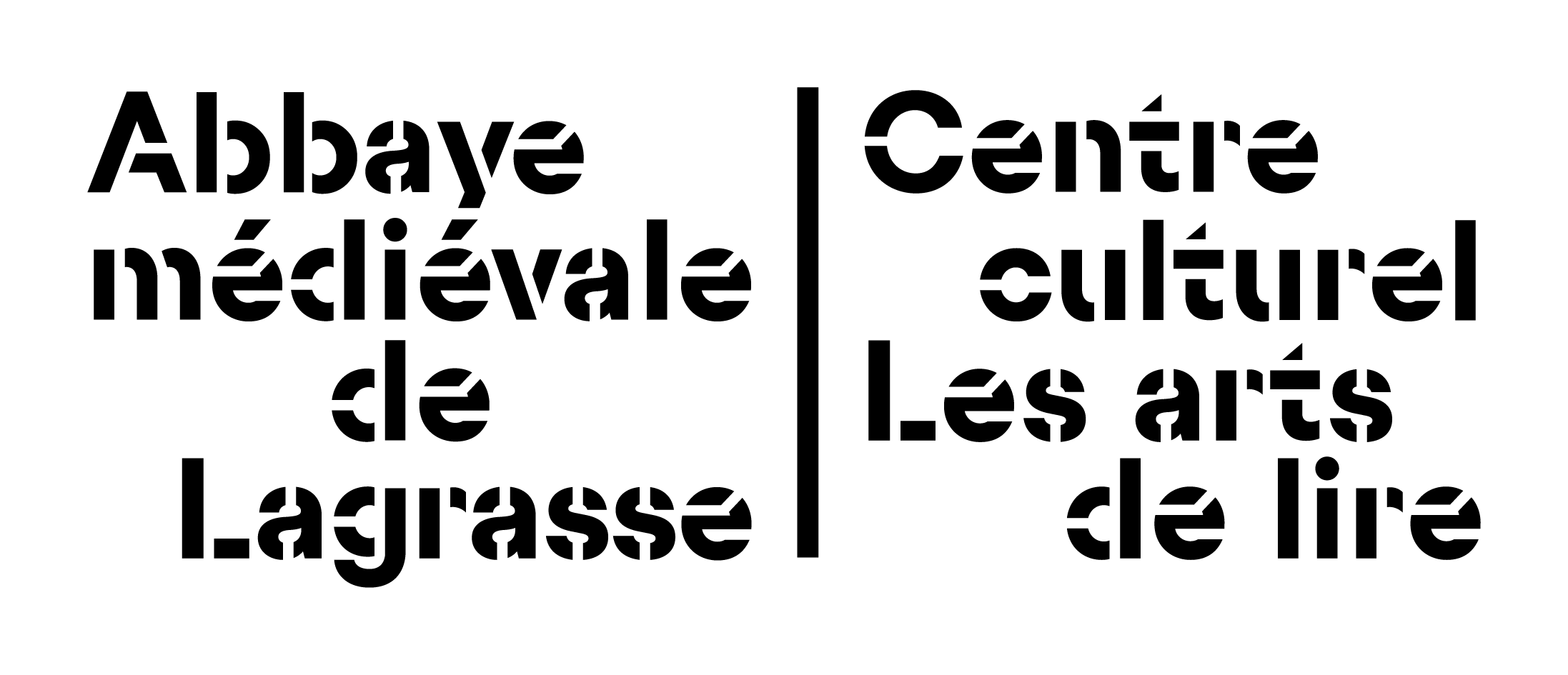Directrice de l’association Arts Résonances et engagée de longue date en faveur de l’accessibilité culturelle, Brigitte Baumié retrace la genèse de la collaboration avec le centre culturel Les arts de lire. Elle revient sur les actions menées en partenariat depuis 2023 et évoque l’importance d’une journée dédiée à la culture Sourde dans le cadre du Banquet, une initiative porteuse de sens tant pour la communauté sourde que pour le public entendant dans son approche de la surdité.
Propos recueillis par Marie Bataillon
Pour commencer simplement, en quoi consiste l’activité de l’association Arts Résonances ?
Brigitte Baumié : L’association existe depuis plus de 30 ans, et depuis une quinzaine d’années et s’est engagée dans la question de l’accessibilité, d’abord en lien avec la littérature et plus spécifiquement la poésie pour les personnes sourdes. J’ai découvert qu’un grand nombre d’entre elles avaient peu ou difficilement accès au français écrit. Comme nous étions très impliqués dans le champ poétique, l’idée a été de traduire la poésie vers la langue des signes française (LSF). Assez vite, on a découvert qu’il existait une littérature Sourde, on a donc aussi commencé à traduire cette poésie visuelle en français écrit, dans une logique réciproque.
On a lancé tout ça avec le service d’interprétation Des’L, basé à Montpellier, avec des interprètes, des professeurs de langue des signes, des linguistes, des poètes sourds et entendants. Et rapidement, on a fondé avec le laboratoire « Structures Formelles du Langage » du CNRS – Paris 8, un groupe de recherche dédié à la traduction poétique de et vers les langues des signes, qu’on appelle le « Labo d’Arts Résonances ».
Et aujourd’hui, combien de membres actifs composent l’association ?
BB : Une vingtaine de membres vraiment impliqués. Ce sont des personnes qui participent aux actions : traductions, interventions dans les festivals, les écoles, les lieux culturels. Au festival Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée de Sète, par exemple, nous collaborons avec Des’L et avec plusieurs professionnels engagés comme Djenebou Bathily, Félix Bianciotto, Othilie Rogé et Aurore Corominas.
Comment s’est créé le lien entre Arts Résonances et Les arts de Lire ?
BB : Tout est parti d’une sollicitation de l’Association des Sourds de l’Aude. Ils nous ont contactés car il n’y avait jamais eu de visite en langue des signes de l’abbaye de Lagrasse. J’en ai parlé à Fleur Bouillane (DRAC) et Florence Carre (Région Occitanie), qui m’ont encouragée à contacter le directeur des arts de lire. Notre rencontre a été très forte : il a immédiatement compris nos enjeux et a proposé une approche très juste : plutôt que de recourir à un interprète LSF pour traduire une visite en français, il fallait qu’une personne sourde s’approprie l’histoire de l’abbaye et la restitue avec sa propre sensibilité. C’était vraiment une proposition géniale, bien plus qu’un simple aménagement. C’est ainsi qu’a eu lieu notre première résidence, puis d’autres ont suivi naturellement avec l’invitation de poètes Sourds, enrichies par les retours enthousiastes des participants.
Pour les artistes et intervenants, comment sont faits les choix ? Par exemple, pour Françoise Casas ou les poètes invités en 2024 et 2025 ?
BB : Françoise est une guide conférencière installée à Montpellier, diplômée en Histoire de l’art. On la connaît depuis longtemps et elle était très motivée par le projet. On l’a associée à Félix Bianciotto, interprète en LSF. D’ailleurs, on essaie toujours d’avoir au moins un interprète entendant sur les résidences. Pour la résidence de 2024, j’ai proposé moi-même les poètes Sourds : Mathilde Chabbey, Wafae Abadou, Djenebou Bathily et François Brajou. Pour celle de 2025, dans le cadre du Banquet du livre d’été, on a laissé Erwan Cifra choisir librement un artiste avec qui il souhaitait collaborer, car nous savons qu’il travaille beaucoup à l’international. C’est comme ça qu’il a invité Arnoldas Matulis. On trouvait intéressant de découvrir d’autres sensibilités artistiques et d’autres langues des signes.
Le cadre de l’abbaye et du village est-il une source d’inspiration pour les artistes en résidence ?
BB : Oui, absolument. Les artistes apprécient le temps de création offert, et le lieu peut donner une dimension supplémentaire. Pour ceux qui ont participé aux résidences, le site a été une source d’inspiration forte : en 2024, la commande était justement de créer autour du lieu – pas seulement l’abbaye mais aussi le village. Une vraie immersion.
Erwan Cifra et Arnoldas Matulis ont des langues des signes différentes. Comment travaillent-ils ensemble artistiquement ?
BB : D’abord, il faut rappeler qu’il n’existe pas une langue des signes universelle, contrairement à une croyance répandue. Chaque pays a sa propre langue mais il existe aussi des signes internationaux qu’Erwan et Arnoldas maitrisent, et ils pratiquent tous les deux le VV (Visual Vernacular) qui possède une capacité artistique à être compris internationalement. Le VV est un mode d’expression visuel, entre la langue des signes, le mime et les techniques cinématographiques, revendiqué par certains comme une langue Sourde artistique à part entière. Erwan y est très engagé. Le principe est de créer des récits sans utiliser les signes standards, seulement via des descriptions visuelles et les structures de langues communes à toutes les langues des signes. En théorie, le VV n’engage pas de déplacement scénique comme le mime, mais reste au même emplacement. Il se veut accessible à tous, mais peut-être la culture influence-t-elle la réception. Il faudrait demander aux artistes et au public Sourds.
Que représente la journée consacrée à la culture Sourde pendant le Banquet du livre d’été pour la communauté ?
BB : En Occitanie, notamment autour de Toulouse, la communauté Sourde est très présente. Dès qu’un événement s’annonce accessible en LSF, les gens sont motivés. Et ici, ce n’est pas juste une question de traduction : il s’est agi aussi d’inviter des artistes Sourds, des traducteurs Sourds, de reconnaître pleinement leur langue et leur art. C’est une forme d’ouverture plus profonde, où la langue des signes est considérée à égalité avec les autres langues, et où les artistes sont mis en lumière au même niveau que les autres.
Quel rapport la communauté Sourde entretient-elle avec le livre et la lecture ?
BB : C’est un sujet complexe. Depuis la fin du XIXe siècle, l’éducation des sourds en France a été orientée vers l’apprentissage de la parole, au détriment du développement linguistique global. Cela a entraîné une forte proportion d’analphabétisme chez les sourds de naissance. J’ai travaillé avec des jeunes sourds qui, encore aujourd’hui, peinent à lire ou écrire le français. Et même des adultes cultivés s’expriment souvent à l’écrit comme des personnes étrangères. Il y a des exceptions : certains sourds deviennent lecteurs grâce à des parcours particuliers, souvent avec un accompagnement fort. Mais souvent, la lecture est perçue comme inaccessible, voire comme un objet de rejet. Ce n’est pas toujours un choix conscient mais le résultat d’un vécu d’échec entrainé par l’inadaptation de l’enseignement du français pour les sourds et le manque de base linguistique due à l’absence d’apprentissage de la langue des signes.
Et est-ce que ce rejet peut évoluer ? Y a-t-il un désir d’accès au livre ?
BB : Il y a des personnes sourdes qui lisent, bien sûr. Mais celles qui ont réellement accédé à la lecture ont généralement rencontré quelqu’un qui les a soutenues dans ce parcours : orthophoniste, éducateur, parent impliqué… Le souci, c’est que la plupart des professionnels insistent encore sur l’oralisation comme priorité, en disant aux familles : “Votre enfant doit parler pour s’intégrer.” Et cela se fait souvent au détriment de l’acquisition d’une langue, qu’elle soit gestuelle ou écrite. Résultat : certains enfants n’ont ni langue des signes solide, ni français maîtrisé. C’est un frein immense.
Le livre, dans ce contexte, n’est donc pas perçu comme un objet habituel ?
BB : Non. Il y a une démocratisation du livre dans les écoles pour les entendants, avec des bibliothèques et des animations de lecture, mais ce n’est pas toujours le cas pour les enfants sourds. Et même si chacun peut avoir ses préférences, le rejet du livre est souvent lié à une mise en échec. Ce n’est pas une posture choisie, mais subie. Et, par exemple, quand il y a eu la visite de la librairie du Centre Culturel Les arts de lire accompagnée par la libraire, les personnes Sourdes présentes ont manifesté un grand intérêt. Cela dit, la littérature Sourde existe ! Pour les enfants, il y a une richesse de contes en langue des signes. Mais il faut y avoir accès.
Comment vois-tu l’évolution de la place de la culture Sourde dans les événements artistiques en France ?
BB : Les choses avancent dans les évènements artistiques. Quand on a commencé, il n’y avait presque rien au niveau de la poésie, il y avait du conte, du théâtre, mais trop peu. Heureusement beaucoup d’organisateurs se posent aujourd’hui la question de l’accessibilité, les initiatives se multiplient. Nous espérons que la présence d’artistes sourds sera de plus en plus valorisée.